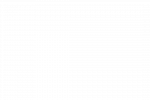Les femmes se mobilisent contre la violence conjugale en Turquie

Les femmes se mobilisent contre la violence conjugale en Turquie
Par Marie Jégo (Istanbul, correspondante)
Selon la plateforme Halte aux féminicides, 47 femmes ont été tuées en février, et 2 000 depuis 2010.
Chaque 8 mars, Beril, une jeune étudiante stambouliote, participe à la manifestation de défense des droits des femmes sur l’avenue Istiklal, au cœur d’Istanbul. Des rassemblements semblables ont lieu dans quatorze villes de Turquie sauf à Diyarbakir, dans le sud-est kurdophone, et dans les zones considérées comme sensibles où toute manifestation est interdite. Beril se fondra d’autant plus volontiers dans le cortège cette année que « les droits des femmes sont en recul au quotidien : nos tenues, notre comportement sont examinés sous toutes les coutures, le climat social est lourd parce que chacun se sent l’âme d’un procureur ».
Elle en a fait l’expérience. Visage poupon, la tête couverte d’un foulard à fleurs, pantalon collant et petite liquette, la jeune femme raconte comment, un soir de septembre 2017, elle et son compagnon se sont fait tancer vertement par un représentant des « Aigles de nuit », des volontaires qui patrouillent les rues le soir venu, pour avoir échangé un baiser passionné dans un parc.
Il y a plus grave. Dans une étude réalisée en janvier et février par l’université privée Kadir Has, 61 % des personnes interrogées désignent « la violence » comme le principal problème auquel les femmes turques sont confrontées. Alarmant, ce phénomène est en progrès constant. C’est contre ce fléau que les associations appellent à défiler.
Lois non appliquées
Selon la plateforme Halte aux féminicides, qui publie régulièrement des statistiques sur le sujet, près de 2 000 femmes ont été assassinées depuis 2010. Chaque année, la liste des victimes s’allonge : 237 femmes en 2013, 409 en 2017. Rien qu’en février, 47 femmes ont été tuées, le plus souvent par balles ou à l’arme blanche. Elles étaient 28 en janvier.
Les auteurs de ces assassinats sont, dans 39 % des cas, les conjoints ou ex-conjoints, et dans 24 % les pères, fils, beau-fils ou autres parents. La plupart du temps, la femme est tuée parce qu’elle a cherché la séparation ou le divorce, qui est pourtant légal. Il y a aussi les « crimes d’honneur » perpétrés par des proches sur des femmes accusées de mauvaise conduite.
Selon Gülsüm Kav, fondatrice de Halte aux féminicides, « ces meurtres pourraient être empêchés ». Les lois existent mais ne sont pas appliquées : « La police et la justice ne protègent pas assez les femmes. Elles ne sont pas prises au sérieux lorsqu’elles s’adressent aux policiers et aux juges. » Elle en est sûre, « ce problème est sociétal, éducationnel et culturel. Tant que nous n’avancerons pas sur ce terrain-là, il n’y aura pas de progrès ».
Lancé par Mustafa Kemal Atatürk en 1934 – date à laquelle les Turques reçurent le droit de vote, dix ans avant les Françaises –, le processus d’émancipation des femmes en Turquie file un mauvais coton. Peu présentes sur le marché du travail (28 %), absentes de la haute fonction publique, victimes de violences conjugales, elles souffrent.
« Trois enfants au moins »
Les associations déplorent les vues rétrogrades du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur), au pouvoir depuis 2002, sur le rôle des femmes dans la société. L’AKP, il est vrai, ne leur fait pas la part belle en politique. Le gouvernement ne compte qu’une seule ministre femme, Fatma Betül Sayan Kaya, bien sûr chargée de la famille. Sur 550 députés au Parlement, 79 seulement sont des femmes.
En 2016, le président Erdogan avait provoqué la fureur des féministes en déclarant que les femmes sans enfants étaient « incomplètes » et en recommandant la mise au monde de « trois enfants au moins ». Il convient aussi de ne pas laisser les femmes rire en public « au nom de la décence », avait souligné en 2014 Bülent Arinç, l’un des fondateurs de l’AKP, à l’époque président du Parlement. En 2016, un projet de loi en faveur d’une amnistie des violeurs prêts à épouser leurs victimes, poussé par l’AKP, a été abandonné après un tollé des associations de femmes.
Mais les islamo-conservateurs ont plus d’un tour dans leur sac. Ainsi le mariage précoce, qui constitue le frein le plus sérieux à l’éducation des femmes, est désormais favorisé par la reconnaissance du mariage religieux. Depuis l’automne 2017, les muftis – des chefs religieux qui sont aussi des fonctionnaires du Diyanet, le ministère du culte musulman – peuvent célébrer des mariages au même titre que les maires.
Cette nouvelle disposition risque d’accroître le nombre de mariages précoces. Le problème se pose de façon plus aiguë depuis que la Turquie a accueilli 3 millions de réfugiés syriens qui, confrontés à la pauvreté, sont parfois tentés de marier leurs fillettes à un prétendant aisé et âgé, contre rétribution.