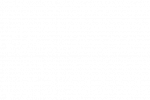A Juba, des archivistes au chevet de l’histoire du Soudan du Sud
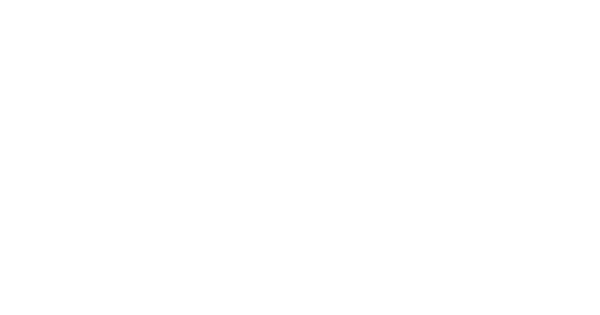
A Juba, des archivistes au chevet de l’histoire du Soudan du Sud
Par Florence Miettaux (Juba, Soudan du Sud)
Des centaines de documents ayant survécu aux années de guerre civile sont numérisés chaque jour afin de témoigner du passé du pays et construire son avenir.
C’était l’un des projets emblématiques lors de l’indépendance du Soudan du Sud, déclarée dans l’euphorie en juillet 2011 : établir au cœur de la capitale, Juba, les archives nationales du nouveau pays afin de préserver et célébrer son histoire. Mais comme d’autres projets de la jeune nation, celui-ci a flanché sous le poids de la guerre civile qui a éclaté en décembre 2013. Depuis, c’est avec des moyens réduits et grâce au dévouement de quelques archivistes passionnés que des progrès ont pu être accomplis.
« Nous ne pouvons pas abandonner, car ces documents, c’est l’histoire du Soudan du Sud, assure Youssef Onyalla, directeur des archives nationales. Il faut les préserver pour les générations à venir. » Il se rappelle des différentes phases de la sauvegarde des registres, depuis leur redécouverte à la fin de la guerre avec le Soudan, en 2005, jusqu’à aujourd’hui. « Ce n’est pas parfait, mais c’est quand même bien mieux qu’avant », sourit-il.
Et pour cause : les archives ont passé toute la période de la seconde guerre civile soudanaise (1983-2005) dans des locaux de fortune – la cave du bureau du gouverneur ainsi que la cuisine d’un collège de Juba. « Elles ont été mangées par les termites, inondées par la pluie, stockées sans aucune ventilation », raconte Becu Thomas, responsable de programme culturel à l’Unesco, qui a participé à la collecte des documents dès 2009. « Ils étaient en très mauvais état. Depuis dix ans, beaucoup a été accompli, mais beaucoup reste à accomplir », résume-t-il.
Plus de cent ans d’histoire
Les documents ont d’abord été transférés dans une tente, où le catalogage a commencé. Puis, en 2011, l’ensemble du fonds a été déménagé dans une maison du quartier de Munuki louée par le ministère de la culture. C’est là qu’elles sont pour l’instant conservées, dans des centaines de boîtes en carton disposées sur des étagères métalliques. Une atmosphère calme et solennelle règne dans ces rayons à travers lesquels la lumière filtre, stimulant la curiosité et l’imagination du visiteur.
Plus de cent ans d’histoire sont contenus dans ces cartons : les documents les plus anciens datent de la fin du XIXe siècle, quand l’administration coloniale anglo-égyptienne s’est installée au Soudan. Ce sont principalement des correspondances officielles, classifiées et numérotées en fonction de leur objet : la catégorie 58 contient des échanges à propos des « routes et communications », la catégorie 16 concerne les « frontières des districts », la catégorie 66 évoque les rapports entre groupes ethniques…
« C’est une source de savoir, quelque chose dont nous pouvons apprendre beaucoup, par exemple sur la façon dont les gouvernements précédents résolvaient les conflits », explique Opoka Musa, le doyen des archivistes. En poste depuis 1992, c’est un fin connaisseur de la collection, qu’il a commencé à lire « quand personne ne prêtait attention aux archives ».
Dans la pièce consacrée à la numérisation, des archivistes accompagnés de stagiaires de l’Université catholique de Juba scannent chaque jour, une à une, des centaines de pages jaunies, fragiles, parfois translucides, abîmées voire déchirées. L’état de certains documents atteste de l’urgence de la numérisation. Pourtant, selon Anna Rowett, du Rift Valley Institute, une organisation qui soutient depuis 2010 ces opérations, « seul un quart de la collection a été numérisé ». Elle estime qu’au rythme actuel, il faudrait « environ trois ans » pour venir à bout des centaines de milliers de pages restantes si le travail n’est pas de nouveau interrompu, comme en 2017 où aucune page n’a été scannée.
Un soutien extérieur primordial
Edward Jubara, directeur général des archives et antiquités au ministère de la culture, explique que son budget ne permet de payer que les salaires et le loyer. Le reste est financé grâce aux « partenaires » : les Etats-Unis ont payé les scanners en 2014, la Suisse finance la reprise de la numérisation, depuis début mars, et c’est la Norvège qui a payé, via l’Unesco, l’achat d’un groupe électrogène et d’une réserve de carburant d’un an, ainsi qu’une exposition et des programmes à destination du public organisés à Juba en novembre 2017.
C’est un fait : sans soutien extérieur, les archives n’en seraient pas là. Mais dépendre de pays donateurs les rend aussi vulnérables aux changements de priorités. Ainsi, le grand projet de construction d’un bâtiment consacré aux archives a été planifié dès 2011, avant d’être suspendu en 2014 au profit d’opérations d’urgence humanitaire. Au fil des ans, les archivistes ont tâché de continuer leur travail méticuleux « dans des conditions parfois difficiles », reconnaît pudiquement Edward Jubara.
« Les archives sont une institution fondamentale », affirme Jok Madut Jok, directeur du Sudd Institute, une organisation de recherche indépendante. Sous-secrétaire du ministère de la culture après l’accession à l’indépendance, il a conçu à l’époque d’ambitieux programmes de construction de la nation à travers les arts, la culture et la préservation du patrimoine. Promouvoir les archives était sa priorité. « Mais tout est parti en fumée », déplore-t-il en se remémorant l’explosion de violence de décembre 2013. Il reste convaincu que les archives contribueront à « construire la paix » en établissant « une histoire commune », « celle qui nous a conduits à lutter pour l’indépendance et a donné naissance à notre pays ».
Pour l’instant, il faut « assurer les activités d’urgence », indique Becu Thomas, qui espère voir un jour les archives conservées « conformément aux normes internationales ». Un horizon cher à Youssef Onyalla, qui insiste sur le besoin d’un « programme de conservation des documents les plus fragiles ». « Ce qui manque, c’est une loi pour réguler les droits d’accès aux archives et leur donner un meilleur statut », dit Edward Jubara. Il précise que la collection actuelle est incomplète : manquent tous les documents postérieurs à 1983. « Nous voulons tout archiver, y compris ce qui se passe actuellement, pour les chercheurs du futur », conclut-il.