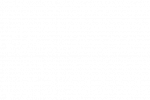Roman noir et noirceur du roman : nos idées (lumineuses) de lecture
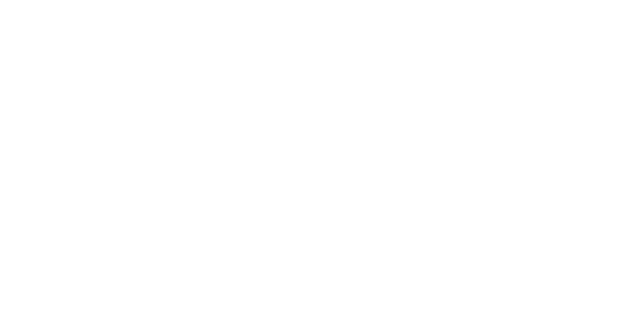
Roman noir et noirceur du roman : nos idées (lumineuses) de lecture
Chaque jeudi dans « La Matinale », « Le Monde des livres » propose ses coups de cœur de la semaine.
LES CHOIX DE LA MATINALE
John le Carré, Fanny Chiarello, Gabriel Tallent, Philippe Claudel et Christian Oster composent notre puzzle littéraire de la semaine.
POLAR. « L’Héritage des espions », de John le Carré
Comme il le raconte dans le très complet Cahier de l’Herne qui lui est consacré (272 p., 33 €), John le Carré, dans les années 1960, mettait la dernière main à ce qui deviendrait son gigantesque best-seller L’Espion qui venait du froid (1963). Il imaginait une opération de désinformation contre la Stasi menée par son double littéraire, George Smiley, avec l’aide de son second, Guillam.
C’est sur cette opération (nom de code « Windfall ») qu’il revient dans L’Héritage des espions. Plus d’un demi-siècle s’est écoulé mais l’histoire ne dort que d’un œil. Au moment où Smiley et Guillam coulent une retraite tranquille, elle les rattrape. Car si « Windfall » a été pour l’Occident « une manne de renseignements en or », elle s’est aussi soldée par de lourds « dommages collatéraux » : un excellent agent britannique et une jeune femme innocente morts au pied du mur de Berlin.
Pour quoi ? Un demi-siècle plus tard, les enfants des victimes demandent des comptes et le Carré remonte le passé avec ses deux héros. Qu’ont-ils à dire pour leur défense? Les intérêts supérieurs des années 1960 sont-ils audibles aujourd’hui? L’Héritage des espions est aussi celui de le Carré lui-même. Une réflexion sur l’histoire au moment où l’actualité a de nouveau, parfois, des parfums de guerre froide. Mais aussi une longue méditation sur le temps, la vieillesse et ce qui nous fait agir dans l’existence. Florence Noiville
« L’Héritage des espions » (A Legacy of Spies), de John le Carré, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Isabelle Perrin, Seuil, 320 p., 22 €.
NOUVELLES. « La vie effaçant toutes choses », de Fanny Chiarello
Exaspérée que l’on réduise ses précédents romans, Une faiblesse de Carlotta Delmont et Dans son propre rôle (L’Olivier, 2013 et 2015) à des « portraits de femmes », Fanny Chiarello a décidé de composer un livre autour de neuf de ces portraits.
Neuf récits, brillamment liés entre eux par un système de reprises et de micro-décalages, mettant en scène des femmes qui tentent d’échapper aux clichés attachés à leur genre, que ce soit la maternité, la tyrannie de la mode ou la dépendance en toutes choses à l’égard de leur conjoint. Le tissage thématique, les jeux d’échos et la récurrence des mêmes situations produisent un puissant effet de suffocation. Florence Bouchy
« La vie effaçant toutes choses », de Fanny Chiarello, L’Olivier, 240 p., 17,50 €.
ROMAN NOIR. « My Absolute Darling », de Gabriel Tallent
C’est un roman noir dans lequel on a du mal à entrer et, une fois dedans, presque envie de fuir. Parce que ce qui y est décrit est insoutenable et que l’écriture vient coller à ce malaise.
Une vieille maison délabrée au milieu des bois, des armes à feu omniprésentes, une violence quotidienne qui imprègne tout. Turtle (« tortue », un surnom qui en dit long sur la carapace que Julia, 14 ans, s’est forgée pour survivre) subit l’emprise de son père et ses viols dans un mélange de terreur et d’acceptation. Son échappatoire : ses fugues dans la nature sauvage. Jusqu’à une curieuse rencontre avec deux adolescents solaires et drôles, Brett et Jacob.
L’atmosphère de face-à-face oppressant entre le père et la fille tient le lecteur en apnée toute la première partie. Les phrases sont courtes, sèches et claquent comme des coups de fusil régulièrement tirés – pour supporter la tension du récit, la violence et la terreur dans lesquelles vit cette adolescente, il faut parfois poser le livre. Puis, lentement, comme dans un tunnel où la lumière perce par les interstices, le style narratif s’ouvre, respire, les phrases se font plus longues à mesure que l’adolescente s’éveille, s’autorise à rire et à aimer. Voici un roman poignant, qui brûle les doigts. Sylvia Zappi
« My Absolute Darling », de Gabriel Tallent, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Laura Derajinski, Gallmeister, « Americana », 464 p., 24,40 €.
ROMAN. « L’Archipel du Chien », de Philippe Claudel
Dans l’archipel imaginaire du Chien, sur une petite île volcanique, trois cadavres de migrants africains s’échouent sur le sable et mettent au jour le fond de l’âme des habitants. Faut-il leur offrir une sépulture digne ou dissimuler les corps ?
Parmi les personnages qui les découvrent (le Maire, le Curé, l’Instituteur…), l’un va endosser le rôle d’Antigone, l’autre, celui de Créon. Car c’est bien une tragédie grecque que signe Philippe Claudel. Elle nous happe dès le prologue par la voix d’un « narrateur extérieur-Coryphée » qui nous met en garde : cette île est notre tour d’ivoire, la lâcheté de ses habitants, notre aveuglement.
L’Archipel du Chien joue avec les codes du théâtre, de la parabole puis du roman policier quand, au milieu de l’intrigue, arrive un étrange Commissaire. Ce qu’il cherche, on l’ignore, mais un crime et un coupable sont trouvés, et la meute se déchaîne.
Certes, tous les genres littéraires ne sont pas maniés avec la même habileté ; mais, pris dans sa course, le roman touche à coup sûr son but : imprimer sur notre rétine des images cauchemardesques. Il n’y a pas une once d’espoir dans ce livre et quand le volcan se réveille, l’archipel est envoyé directement en enfer. Gladys Marivat
« L’Archipel du Chien », de Philippe Claudel, Stock, 288 p., 12,50 €.
ROMAN. « Massif central », de Christian Oster
Le narrateur s’appelle Paul et, autrefois, c’était un architecte. Voilà pour le secondaire. Pour l’essentiel, Paul sait juste qu’il a le cœur vide : il vient de quitter Maud après l’avoir dérobée à Carl Denver, et quand il apprend que celui-ci, qu’il a toujours craint, le cherche, il part chez un couple d’amis dans le Massif central.
Mais, même réfugié dans les montagnes, il semble à Paul que le regard de Denver reste braqué sur lui à la façon d’une caméra. Car, comme souvent chez le romancier, les absents sont omniprésents et inversement. Ainsi, tous ceux que Paul croise sur sa route sont menacés d’effacement. Tous fuient quelque chose, à commencer par eux-mêmes. A l’exception peut-être de Denver, dont« l’irréductible part de rage fondait la force de vivre ». Ce Denver qui apparaît finalement comme une sorte de double en négatif du narrateur.
Dans ce roman à la noirceur plus assumée que les précédents, Oster semble renouer avec les polars de ses débuts. Mais il ne dit en définitive pas autre chose que ce qui parcourt l’ensemble de son œuvre : « Parfois quitter (ou être quitté) tue. » Avril Ventura
« Massif central », de Christian Oster, L’Olivier, 10 p., 16,50 €.