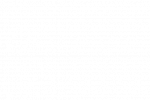Scandale du chlordécone aux Antilles : « L’Etat a fait en sorte d’en dire le moins possible »

Scandale du chlordécone aux Antilles : « L’Etat a fait en sorte d’en dire le moins possible »
La Guadeloupe et la Martinique sont contaminées pour des siècles par un pesticide. Nos journalistes Faustine Vincent et Stéphane Foucart répondent à vos questions.
La Guadeloupe et la Martinique sont contaminées pour des siècles par un pesticide d’une toxicité extrême, le chlordécone, utilisé massivement dans les bananeraies de 1972 à 1993.
La quasi-totalité des Antillais sont eux aussi contaminés, comme le révèle une étude de Santé publique France, dont les résultats seront présentés à la population en octobre.
Pourquoi sont-ils exposés aujourd’hui encore au pesticide ? Que risquent-ils ? Quand a surgi le scandale ? Comment l’Etat gère-t-il ce dossier ? Les journalistes du Monde Stéphane Foucart et Faustine Vincent ont répondu aux questions des internautes lors d’un tchat.
Comment explique-t-on le fait qu’on ne parle de ce scandale que maintenant ?
Faustine Vincent : Ce n’est pas la première fois que la presse parle de ce scandale. Les médias locaux l’évoquent d’ailleurs souvent. Mais le dossier semble chaque fois curieusement retomber dans l’oubli en métropole.
Il a toutefois resurgi après la parution d’un rapport controversé de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) en décembre, qui a suscité un grand émoi aux Antilles.
L’agence publique avait été saisie pour savoir si les limites maximales de résidus de chlordécone autorisées dans les aliments étaient suffisamment protectrices pour la population. La question est cruciale, car un changement dans la réglementation européenne en 2013 a conduit à une hausse mécanique spectaculaire des limites autorisées en chlordécone pour les volailles et les viandes.
Or, dans ses conclusions, l’Anses estime que ces nouveaux seuils sont suffisamment protecteurs. Selon l’agence, les abaisser serait inutile, et il est « plus pertinent d’agir par les recommandations de consommation pour les populations surexposées » au pesticide.
Cet avis a été perçu comme un « tournant » dans la façon dont les autorités gèrent le dossier. Le gouvernement est soupçonné de vouloir privilégier l’économie sur la santé, en permettant aux éleveurs de bœufs et de volailles de vendre leurs produits avec des taux de chlordécone plus élevés.
Les Etats-Unis ont interdit le chlordécone en 1977 et la France quasiment vingt ans plus tard. Comment expliquer un tel retard ? Ce décalage dans le temps est-il fréquent ?
Stéphane Foucart : Un décalage dans le temps, sans être fréquent, peut se produire lorsque des agences de sécurité sanitaire parviennent à des conclusions divergentes sur les dangers que représente[nt] un produit ou les risques — acceptable[s] ou non — pour la population.
En règle générale, un produit interdit dans un espace économique important – comme l’Union européenne ou les Etats-Unis – finit rapidement par être interdit ailleurs. Un décalage dans le temps de seize ans [le chlordécone a cessé d’être utilisé légalement aux Antilles en 1993] est un délai très long.
Cela dit, l’atrazine [un herbicide commercialisé par Syngenta] a été interdit en Europe au début des années 2000 et est toujours utilisé outre-Atlantique.
Pourquoi la population n’a pas été avertie précocement ?
Faustine Vincent : L’affaire a surgi au tout début des années 2000, quand un ingénieur sanitaire, Eric Godard, a donné un aperçu de l’ampleur du désastre en révélant la contamination des eaux, des sols, du bétail et des végétaux. Des mesures ont été prises, mais les autorités ont fait en sorte d’en dire aussi peu que possible afin de ne pas susciter la panique ni d’attiser la colère. Cette stratégie s’est révélée contre-productive : le soupçon est désormais partout, quand il ne vire pas à la psychose.
Depuis le rapport controversé de l’Anses publié en décembre, le gouvernement clame sa volonté d’être transparent. Il y a manifestement des ratés : un syndicat de l’Agence régionale de santé de Martinique a dénoncé en janvier les « pressions que subissent les agents pour limiter l’information du public au strict minimum », mais aussi les « manœuvres visant à la mise à l’écart du personnel chargé de ce dossier », dont l’expertise est pourtant « unanimement reconnue ».
Par ailleurs, en avril et mai, les habitants de la commune de Gourbeyre, en Guadeloupe, ont consommé de l’eau contaminée sans que les autorités les en avertissent. Le procureur de Basse-Terre s’est saisi de l’affaire.
Je vais à la Martinique bientôt pour un mois. Existe-t-il des risques sanitaires, même dans le cadre d’un séjour aussi bref ? Quelles précautions prendre ?
Stéphane Foucart : A priori, un séjour aussi bref ne pose pas de problèmes sanitaires particuliers, notamment pour une population d’adultes ou de femmes qui ne sont pas enceintes. L’un des risques documentés par les chercheurs du monde académique, consécutif à une exposition de quelques mois seulement, concerne l’exposition in utero au chlordécone, avec une probabilité accrue, plus tard dans la vie, de troubles cognitifs ou des scores inférieurs de motricité fine. Un résumé des principaux résultats scientifiques sur les effets du chlordécone est disponible sur le site de l’Irset.
Y a-t-il un danger pour la consommation des bananes antillaises que l’on trouve en vente en France métropolitaine ?
Stéphane Foucart : Non, le chlordécone ne « monte » pas jusqu’aux bananes. Celles-ci sont donc exemptes du produit. En revanche, les légumes-racines (ignames, patates douces) issus des zones contaminées présentent des résidus du pesticide.
Y a-t-il des recommandations particulières pour limiter la consommation de chlordécone lorsque l’on habite aux Antilles ?
Stéphane Foucart : Dans son rapport, l’Anses indique que les personnes les plus imprégnées par le chlordécone sont celles qui s’approvisionnent sur les circuits informels. Les consommateurs d’œufs, de volailles issues des zones contaminées, de produits de la mer pêchés à proximité des côtes et de produits de la pêche en eaux douces semblent plus exposés.
Qu’elles sont les répercussions sur la santé des habitants ? Y a-t-il des effets observables aujourd’hui ?
Faustine Vincent : Les études menées jusqu’ici sont édifiantes. L’une d’elles, publiée en 2012 par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), montre que le chlordécone augmente non seulement le risque de prématurité, mais qu’il a aussi des effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des nourrissons.
Cette enquête se poursuit actuellement avec les mêmes enfants, désormais prépubères, pour suivre leur évolution. Les résultats des observations effectuées lorsqu’ils avaient 7 ans sont attendus « d’ici la fin de l’année ou le début de l’année prochaine ».
Le pesticide est aussi fortement soupçonné d’augmenter le risque de cancer de la prostate.
La Martinique détient d’ailleurs le record du monde en la matière, avec 227,2 nouveaux cas pour 100 000 hommes chaque année. Le cancer de la prostate est deux fois plus fréquent et deux fois plus grave en Guadeloupe et en Martinique qu’en métropole, avec plus de 500 nouveaux cas par an sur chaque île.
D’autres études sont en cours pour mieux connaître les effets du chlordécone sur la santé.
Quelle est la responsabilité de l’Etat dans cette contamination ?
Faustine Vincent : L’Etat a autorisé l’utilisation du chlordécone après que la Commission des toxiques, qui dépendait du ministère de l’agriculture, a accepté la demande d’homologation du produit en 1972. Trois ans plus tôt, cette demande avait pourtant été rejetée en raison de la toxicité de la molécule, constatée sur des rats, et de sa persistance dans l’environnement.
En 1981, le produit a de nouveau été autorisé, alors que les preuves de sa toxicité s’étaient encore accumulées. Un rapport de l’Institut national de la recherche agronomique, publié en 2010 et retraçant l’historique du chlordécone aux Antilles, s’étonne : « Comment la commission des toxiques a-t-elle pu ignorer les signaux d’alerte : les données sur les risques publiées dans de nombreux rapports aux Etats-Unis, le classement du chlordécone dans le groupe des cancérogènes potentiels, les données sur l’accumulation de cette molécule dans l’environnement aux Antilles françaises ? Ce point est assez énigmatique car le procès-verbal de la Commission des toxiques est introuvable. »
On parle de la responsabilité de l’Etat et des producteurs locaux de bananes, mais qui produisait et commercialisait le chlordécone ?
Faustine Vincent : Le chlordécone était commercialisé par l’entreprise Laguarigue, à la Martinique. Le nom de son ancien directeur général est très connu aux Antilles. Il s’agit d’Yves Hayot, l’aîné d’une puissante famille béké (du nom des Blancs créoles, descendants des colons). Son frère est Bernard Hayot, l’une des plus grosses fortunes de France (300 millions d’euros), et patron du groupe Bernard Hayot, spécialisé dans la grande distribution.
Des associations et la Confédération paysanne ont déposé une plainte contre X en 2006 pour « mise en danger d’autrui et administration de substances nuisibles ». Le Monde a pu consulter le procès-verbal de synthèse qu’ont rendu en 2016 les enquêteurs de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique. Le document révèle que l’entreprise Laguarigue a reconstitué un stock gigantesque de chlordécone alors que le produit n’était déjà plus homologué. Or « au moins un service de l’Etat a été informé de cette “importation” », puisque ces 1 560 tonnes « ont bien été dédouanées à leur arrivée aux Antilles » en 1990 et 1991, précisent les enquêteurs.
La responsabilité de la société Laguarigue et de l’Etat se pose. Mais Yves Hayot ne sera pas inquiété par la justice : il est mort en mars 2017.
Compte tenu de la gravité du problème, y a-t-il eu des sanctions contre les responsables ?
Stéphane Foucart : Non. Pour l’heure, aucune sanction n’a été prononcée, l’instruction de la plainte déposée étant toujours en cours.
Comment jugez-vous cette affaire par rapport à l’interdiction du glyphosate, qui ne va finalement pas être inscrite dans la loi, même s’il est déjà classé cancérogène probable ?
Stéphane Foucart : Il existe des parallèles intéressants : en 1979, le chlordécone avait déjà été interdit depuis trois ans aux Etats-Unis, mais le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ne le classait que « cancérogène possible », estimant n’avoir pas assez de preuves pour le classer « cancérogène probable » ou « cancérogène avéré ». Aujourd’hui, le CIRC classe le glyphosate « cancérogène probable », mais les agences de sécurité sanitaire étant en désaccord avec cette opinion, les Etats ne l’interdisent pas. Une grande différence entre les deux substances est leur persistance : le chlordécone est bien plus persistant que le glyphosate et, surtout, il s’accumule dans les organismes, ce qui n’est pas le cas du glyphosate. Attention cependant : de nouveaux travaux sur l’animal sont en cours à l’Institut Ramazzini et suggèrent, de manière inattendue, que le glyphosate pourrait avoir de telles propriétés de bioaccumulation.