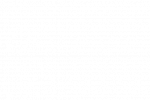Il faut sauver le soldat Merkel

Il faut sauver le soldat Merkel
Editorial. Alors qu’une partie de la droite allemande regarde davantage vers les « démocraties illibérales », la chancelière incarne une autre Europe et a toujours su, aux heures décisives, éviter la politique du pire.
Angela Merkel et Horst Seehofer, ministre fédéral de l’intérieur et président de la CSU, à Berlin, le 20 juin. / Kay Nietfeld / AP
Editorial du « Monde ». Angela Merkel laisse volontiers aux autres les mots qui frappent et les phrases qui claquent. Ce fut le cas lors du sommet franco-allemand de Meseberg, près de Berlin, le 19 juin. Ce jour-là, selon une répartition des rôles qui commence à devenir habituelle, ce n’est pas elle mais Emmanuel Macron qui a trouvé les formules destinées à marquer les esprits : « Ce sommet intervient à un moment de vérité pour l’Europe, a déclaré le président français. C’est aujourd’hui un vrai choix de société qui est en discussion, un choix de civilisation entre ceux qui disent que l’Europe est bonne à détricoter et ceux qui croient – comme nous – que nous pouvons faire avancer l’Europe en la rendant plus souveraine et plus unie. »
Ces mots, Mme Merkel aurait pu les reprendre tels quels pour les appliquer à son propre pays. Car l’Allemagne, ces jours-ci, est bel et bien à un « moment de vérité ». Les yeux rivés sur les élections régionales du 14 octobre, les conservateurs bavarois de la CSU cherchent à imposer à la chancelière une batterie de mesures qui, si elles étaient appliquées, reviendraient quasiment à fermer le pays aux demandeurs d’asile.
« L’islam ne fait pas partie de l’Allemagne »
Mais leur projet politique va au-delà. En janvier, le chef de file des députés CSU au Bundestag a prôné l’avènement d’une « révolution conservatrice », expression chère à l’extrême droite allemande depuis l’entre-deux-guerres. Depuis, le chef du gouvernement bavarois a imposé l’accrochage de crucifix dans tous les bâtiments publics du Land. Quant à Horst Seehofer, le président de la CSU, il a déclaré dans sa première interview en tant que ministre fédéral de l’intérieur, en mars, que « l’islam ne fait pas partie de l’Allemagne ».
Les choses sont aujourd’hui très claires. Une partie de la droite allemande regarde davantage vers Vienne, Budapest ou Rome que vers Paris ou Bruxelles. Ses alliés s’appellent Viktor Orban, le premier ministre hongrois, et Sebastian Kurz, son homologue autrichien, à la tête d’une coalition avec l’extrême droite. Son idéal est celui d’une Europe blanche, chrétienne et refermée sur elle-même. Le modèle vers lequel elle lorgne est celui de ces régimes d’un nouveau type, les « démocraties illibérales ».
Les apprentis sorciers de la CSU
Mme Merkel, elle, incarne une autre Europe. Elevée à l’est du rideau de fer, elle connaît trop le prix de la liberté pour pouvoir accepter que des murs ne s’élèvent à nouveau sur le continent européen. Bien que conservatrice et peu visionnaire, elle a toujours su, aux heures décisives, éviter la politique du pire.
En juillet 2015, elle a finalement fait le choix d’un compromis avec la France permettant d’éviter un « Grexit », une sortie de la Grèce de la zone euro. Deux mois plus tard, elle a refusé de fermer les frontières de l’Allemagne, au moment où des centaines de milliers de réfugiés fuyant le Moyen-Orient en guerre arrivaient par la route des Balkans. Dans les deux cas, l’aile dure de sa majorité le lui a reproché. Mais elle a tenu bon.
Face aux apprentis sorciers de la CSU, mais soutenue par la majorité de l’opinion, la chancelière allemande doit, aujourd’hui encore, ne pas céder. Usée comme jamais, fragilisée comme elle l’a rarement été au cours de sa longue carrière, elle est un rempart à la tête d’un pays qui ne peut basculer à son tour dans le populisme et le nationalisme, à moins d’enterrer définitivement le rêve européen. Quelle que soit l’importance des élections bavaroises, ce n’est pas à Munich que se décide l’avenir de l’Europe.