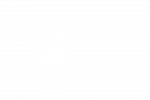Le dilemme des médecins algériens

Le dilemme des médecins algériens
Par Charlotte Bozonnet
Confrontés au manque de moyens dans le secteur de la santé en Algérie, un nombre croissant de praticiens choisissent de venir travailler en France.
Des internes en médecine manifestent à Alger, le 30 janvier 2018, contre le service civil obligatoire, une période de un à quatre ans qu’ils doivent à l’Etat après leurs études. / RYAD KRAMDI / AFP
Ils sont là sans qu’on n’y prête attention, maillon essentiel du système de soins français. Si une part croissante des médecins qui exercent en France avec un diplôme étranger sont roumains, les diplômés des universités algériennes les talonnent. Selon le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), ils étaient 4 404 au 1er janvier 2017 (+ 60 % en dix ans). Soit environ le quart des médecins nés à l’étranger exerçant en France. Si l’on y ajoute ceux qui, nés en Algérie, ont été diplômés en France, ce chiffre monte à 14 305 personnes.
Et encore, ces données ne concernent-elles que les praticiens inscrits au tableau de l’Ordre des médecins. Elles n’incluent pas ceux recrutés directement par les hôpitaux sous des statuts spécifiques. « Après l’instauration du numerus clausus dans les années 1970, on s’est retrouvé avec un manque chronique d’internes, d’où la volonté de faire venir des médecins étrangers », rappelle Victoire Cottereau, qui a fait sa thèse sur la question des « médecins migrants ».
« Une forte disposition à l’expatriation »
De nouvelles législations ont permis leur venue mais sous des statuts précaires : faisant fonction d’interne (FFI) et praticien attaché associé (PAA). « Ils ne sont pas inscrits au Conseil de l’Ordre des médecins. Ils sont officiellement sous l’autorité d’un titulaire mais en réalité, assument la même charge de travail », souligne Victoire Cottereau.
Payés jusqu’à deux fois moins que leurs collègues français, contraints de patienter des années pour passer les concours qui leur permettront d’obtenir un statut plein, nombre de médecins algériens font pourtant le choix de venir en France, pour travailler et se former. Dans un entretien au quotidien algérien francophone El Watan en août, l’économiste de la santé Ahcène Zehnati soulignait « une forte disposition à l’expatriation » des médecins algériens. « Si on prend les médecins nés en Algérie exerçant en France, le taux d’émigration est de 23,35 %. » Des chiffres qui varient selon les statuts et les spécialités mais témoignent d’une tendance : l’Algérie a du mal à retenir ses médecins.
L’exode ne date pas d’hier. Le docteur Hacène (les prénoms ont été modifiés) est arrivé en France au début des années 2000. Diplômé en médecine générale et pédiatrie, il avait travaillé pendant quatre ans dans un hôpital algérien proche de la frontière tunisienne, afin « de voir autre chose que la capitale, Alger ». Raison de son départ à l’époque : progresser en pédiatrie, se spécialiser. Mission difficile dans une Algérie en pleine « décennie noire », où les professeurs en médecine partaient un à un.
A cela s’ajoutait aussi la rémunération. « En quatre ans de travail, impossible de mettre un sou de côté. Le salaire était ridicule, il nous maintenait à peine la tête hors de l’eau », rappelle le médecin, qui débarque un jour en France avec un visa d’études, recommandé par un professeur de région parisienne. Rapidement l’homme a compris que sa venue était « gagnant-gagnant » : payé moins cher, disponible pour les gardes, sa présence était aussi à l’avantage de l’hôpital.
Contestation croissante
Aujourd’hui encore, installé en Normandie, mais visiteur régulier de l’Algérie, il observe les problèmes matériels, le manque d’accès à l’information médicale et la contestation croissante parmi les jeunes médecins. « On ne peut pas envoyer des gens travailler sans matériel à plus de 1 000 km de chez eux, sans leur assurer un minimum de conditions de vie », pointe-t-il en contestant que c’est pourtant la réalité.
Le pédiatre fait référence au mouvement des médecins « résidents » algériens, l’équivalent des internes en France, qui a récemment secoué l’Algérie, incarnant le ras-le-bol du personnel de santé. A partir de novembre 2017, et pendant près de huit mois, plusieurs milliers d’entre eux (ils sont 15 000 au total) se sont mis en grève pour dénoncer leurs conditions de travail et demander l’abrogation du service civil obligatoire : une période de un à quatre ans qu’ils doivent à l’Etat après leurs études, et pour laquelle ils sont souvent envoyés dans des zones reculées.
Les manifestants dénonçaient notamment des salaires extrêmement bas, l’absence de logements de fonction et des hôpitaux sans moyens ne leur permettant pas de remplir leur mission. Leur mouvement, parfois réprimé sans ménagement par les autorités, a été très dur, les grévistes allant jusqu’à ne plus assurer les gardes dans les hôpitaux.
Meriem, 37 ans, est, elle, arrivée dans l’Hexagone en 2015 après dix années comme généraliste, d’abord en cabinet puis dans un hôpital de périphérie près de Constantine. Elle n’a pas quitté l’Algérie pour des raisons professionnelles. « C’est quand j’ai commencé à travailler en France que j’ai pris conscience de la situation en Algérie, explique-t-elle. On n’a pas la moitié de ce dont on aurait besoin. Du coup, on prend mal en charge les patients. On le sait, mais on s’habitue. »
« L’offre de soins s’est beaucoup appauvrie »
Même réaliser une prise de sang ou une radio est problématique. « On s’appuyait uniquement sur l’examen clinique », se souvient-elle. Elle met en cause la médecine gratuite, entièrement financée par l’Etat qui n’y consacre plus les moyens nécessaires. « La situation dans les CHU est aussi catastrophique que dans les hôpitaux de périphérie, avec un vrai manque de moyens, un public agressif et un Etat qui ne soutient pas ses médecins », précise-t-elle.
Sara, urgentiste, avait 20 ans et deux années d’études derrière elle quand elle est arrivée en France, en 2000. Dans les statistiques, elle fait partie de ces médecins nés en Algérie mais qui ont suivi leur formation initiale en France. Il y a cinq ans, elle est retournée en Algérie dans le cadre d’un programme d’échanges : « On a trouvé des hôpitaux où les anesthésiques manquent pour soigner les plaies, où il est difficile de trouver un électrocardiogramme. Des services de réanimation où il n’y a qu’une machine à ventiler alors qu’il en faudrait une par patient. On a réchauffé des poches de sang en les mettant sous les aisselles ! Même l’hygiène est défaillante. Il y a eu une nette dégradation depuis les années 1980. »
La situation n’a en effet pas toujours été celle-ci. Dans les années 1980, rappelle Meriem à titre d’exemple, les greffes de rein étaient réalisées sans difficulté à l’hôpital public, « mais les anciens n’ont pas formé les jeunes. L’offre de soins s’est beaucoup appauvrie et c’est la population qui en souffre. Ceux qui ont les moyens vont dans le privé ou à l’étranger ». Du côté des médecins, la fuite des cerveaux se poursuit. « Beaucoup de mes amis, qu’ils soient médecins ou étudiants en médecine, voudraient partir », souligne Meriem, reconnaissant qu’elle-même aurait pu rentrer après quelques années : « Mais on se dit qu’ici au moins on peut être formé, et que le système de santé là-bas est dans un tel état qu’il faudrait des années pour voir une amélioration. »