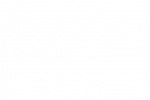La sélection littéraire du « Monde »

La sélection littéraire du « Monde »
Chaque jeudi, la rédaction du « Monde des livres » vous propose un choix de romans et d’essais à dévorer.
LES CHOIX DE LA MATINALE
Un scandale politico-sexuel au Royaume-Uni au cœur de l’époustouflant roman d’Alan Hollinghurst, une escale à Roissy avec une naufragée volontaire, une quête d’identité entre Paris et Dakar, une marcheuse qui arpente la Ghouta assiégée par les forces de Damas… quatre romans forts qui invitent au voyage. Et un manifeste sur les femmes et le pouvoir, qui nous ramène à l’Antiquité.
ROMAN. « L’Affaire Sparsholt », d’Alan Hollinghurst
L’affaire (fictive) donnant son titre au sixième roman d’Alan Hollingurst mêlait sexe et politique. De cela, presque tout le monde, au Royaume-Uni, se souvient. Les détails, en revanche, se sont vite brouillés. Le lecteur non plus n’en saura pas tout, tant l’auteur veille à en laisser une bonne partie dans l’ombre.
Les jeux avec l’ombre et la lumière font du reste la beauté de ce livre si travaillé par la peinture qu’il a quelque chose d’un tableau en cinq panneaux. Il s’ouvre à Oxford en 1940, quand un groupe d’amis distingue, dans une fenêtre en face, un somptueux jeune homme au cours de « ce bref intervalle entre le coucher du soleil et le black-out qui permettait de voir dans les logements des autres ». A la suite de cette apparition, tous, y compris l’hétérosexuel de la bande, voudront approcher ce David Sparsholt aux allures de dieu grec.
Dans les quatre parties suivantes, on s’attache surtout à Johnny, le fils de Sparsholt. C’est à travers lui qu’Alan Hollinghurst, l’un des plus puissants écrivains anglais contemporains, ausculte l’évolution de la société britannique, ses rapports de classes, son attitude à l’égard de l’homosexualité, au fil de ce grand roman sur le temps et ses effets qui est aussi un très beau texte du caché et du visible, dont la subtilité peut parfois désarçonner le lecteur, mais finit toujours par l’éblouir. Raphaëlle Leyris
ALBIN MICHEL
« L’Affaire Sparsholt » (« The Sparsholt Affair »), d’Alan Hollinghurst, traduit de l’anglais par François Rosso, Albin Michel, 608 p., 24,90 €.
MANIFESTE. « Les Femmes et le Pouvoir », de Mary Beard
C’est au tout début de l’Odyssée, d’Homère, qu’on trouve la première affirmation d’un monopole masculin sur la parole publique, dans cette injonction de Télémaque à sa mère : « Va ! rentre à la maison et reprends tes travaux, ta toile, ta quenouille… Le discours, c’est à nous, les hommes, qu’il revient » (traduction de Victor Bérard). Tel est le point de départ choisi par Mary Beard pour interroger à peu près trente siècles de domination masculine enkystée dans la tradition discursive même de l’Occident.
Elle jongle pour cela entre les références antiques et les événements politiques contemporains, dans un texte érudit, espiègle, accompagné d’une trentaine d’illustrations fort parlantes. On y voit ainsi, par exemple, comment la figure classique de Méduse, reprise dans le terrible et fameux tableau du Caravage (1596), a servi aux adversaires politiques de la première ministre britannique Theresa May ou de la chancelière allemande Angela Merkel pour tenter de les faire taire.
Au-delà du diagnostic, qui illustre dans la longue durée combien fut tenu pour évident le silence féminin, l’auteure montre que la tradition gréco-romaine comporte aussi des éléments pouvant subvertir ces codes – ou du moins contribuer à nous en faire prendre conscience. André Loez
PERRIN
« Les Femmes et le Pouvoir. Un manifeste » (« Women & Power. A Manifesto »), de Mary Beard, traduit de l’anglais par Simon Duran, Perrin, 126 p., 10 €.
ROMAN. « Je suis quelqu’un », d’Aminata Aidara
Estelle rencontre son père dans un café, à Paris. Il lui apprend l’existence et la mort du bébé que la mère de la jeune femme, Penda, a eu avec un autre, du temps où tous vivaient à Dakar. Et réveille ainsi des souvenirs. Au même instant, Penda balaye le sol d’un lycée de banlieue en songeant à ce qu’elle va écrire à Eric. L’amant inconstant, rencontré au Sénégal, la raison de son départ précipité pour Paris avec ses filles, onze ans plus tôt. Cet homme est le père de Jamal, qu’on lui a enlevé, dit-elle, une semaine après sa naissance. Puis, elle ouvre le coffre qui contient ce qui reste de son fils – il aurait 16 ans aujourd’hui.
« Le fils de l’Autre » est-il mort ou a-t-il disparu ? L’ouverture de l’admirable premier roman d’Aminata Aidara met le lecteur sur la mauvaise piste. Tout comme l’arbre généalogique en première page, qui décrit une famille dispersée entre le Sénégal, la France et l’Italie.
Je suis quelqu’un n’est pas qu’un récit à énigme, encore moins une saga familiale. Le secret n’est qu’une manière de mettre en branle une réflexion sur la double identité et les multiples quêtes que l’on reçoit en héritage : la recherche des origines, d’un lieu où revenir, et d’un art de vivre avec les injustices et les silences de l’Histoire.
C’est ce qu’explore l’écrivaine italo-sénégalaise de 34 ans, à travers la narration polyphonique, majoritairement épistolaire, portée par une langue souvent flamboyante, qui s’écoule le temps d’un été et d’un automne. Gladys Marivat
GALLIMARD
« Je suis quelqu’un «, d’Aminata Aidara, Gallimard, « Continents noirs », 368 p., 21,50 €.
ROMAN. « La Marcheuse », de Samar Yazbek
Avec Les Portes du néant (Stock, 2016), qui retraçait trois périlleux voyages clandestins, dans les zones de combats les plus violents de Syrie, Samar Yazbek livrait un témoignage d’une force d’évocation extrêmement puissante. Aujourd’hui l’écrivaine syrienne exilée va plus loin encore en renouant avec le roman, en mêlant l’absolu réalisme et le merveilleux.
Rima, la narratrice de La Marcheuse, est muette. Elle est aussi affublée d’une étrange manie : elle ne peut s’empêcher de marcher, ce qui lui vaut de vivre le poignet attaché à un meuble ou au bras de sa mère. On la dit folle, elle ne l’est pas. C’est autour d’elle qu’explose la folie. Elle va en prendre la mesure au cours d’un voyage qui la mènera au cœur de l’enfer de la Ghouta, près de Damas, enclave rebelle assiégée par l’armée d’Assad entre 2012 et 2018.
Dans un souterrain, minée par la faim et les sévices physiques, elle trouve une liasse de papier et un stylo bleu, et raconte ce qu’elle a vu, vécu et entendu. Jusqu’à son agonie, qu’elle décrit avec une confondante sobriété.
Ce texte à l’encre bleue est, comme le dit une expression arabe, d’une complexe simplicité. Rima s’autorise les digressions que lui imposent sa mémoire et son imaginaire, d’incessantes répétitions qui disent son étonnement face à la violence inouïe qu’elle découvre. Elle essaye de comprendre, cherche, tâtonne et fait naître en nous – nous, les lecteurs qui sommes gavés d’images et de mots – un regard neuf, le même effarement que le sien, la même colère que celle de Samar Yazbek. Eglal Errera
STOCK
« La Marcheuse » (« Al-Machâ’a »), de Samar Yazbek, traduit de l’arabe (Syrie) par Khaled Osman, Stock, « La cosmopolite », 304 p., 21 €.
ROMAN. « Roissy », de Tiffany Tavernier
Tous les jours, pas décidé, valise à roulettes, chemisier en soie et tailleur à pinces, elle traverse le terminal, mais jamais ne prend l’avion. Voilà huit mois que l’héroïne de Tiffanny Tavernier a perdu la mémoire, ayant oublié jusqu’à son identité, et qu’elle arpente l’aéroport de Roissy pour cacher aux quelque 700 caméras qu’elle y vit jour et nuit, en naufragée volontaire.
Comme pour vainement tenter de résorber cet abyssal trou de mémoire, ses yeux partout se nourrissent. La robe à smocks d’une fillette, le rire d’un couple en lune de miel, des bribes hétéroclites de conversation : tout est propice au bricolage d’une nouvelle identité par défaut, d’un nouveau rôle à jouer – moins de composition que de recomposition.
C’est que tout, dans Roissy, a éclaté en mille morceaux. Et précisément : le tout, les morceaux, voilà qui constitue ici le cœur de la réflexion. D’abord, la romancière construit le récit à l’image de son héroïne (et de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle lui-même, joyeux chaos bigarré), c’est-à-dire de bric et de broc. Un kaléidoscope d’anecdotes, de pages volantes du carnet d’un complotiste ou de flashs info lus sur les écrans de l’aéroport avec, parfois, une flamboyante déflagration de poésie, qui vient chahuter le récit.
Et puis, non contente d’avoir tout mis en pièces, Tiffanny Tavernier engage son lecteur à y remettre un peu d’ordre, avec cette question : de l’infiniment petit du « je » ou de l’infiniment grand de « l’immensité du monde », de quoi Roissy est-il au juste le puzzle ? Zoé Courtois
SABINE WESPIESER
« Roissy », de Tiffany Tavernier, Sabine Wespieser, 280 p., 21 €.