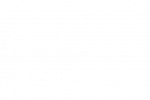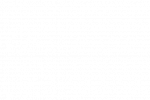Brexit : le meilleur accord perdant-perdant

Brexit : le meilleur accord perdant-perdant
Editorial. Même si elle a obtenu le feu vert du gouvernement à l’accord de rupture avec l’UE, Theresa May n’est pas pour autant au bout de son calvaire. Il lui reste à affronter le plus dur : la Chambre des communes.
Theresa May, au 10 Downing Street, à Londres, mercredi 14 novembre. / TOBY MELVILLE / REUTERS
Editorial du « Monde ». Ce n’est qu’une étape, et elle est incertaine. Il faut pourtant espérer que l’accord sur le Brexit conclu mardi 13 novembre entre la première ministre britannique, Theresa May, et le négociateur de l’Union européenne, Michel Barnier, puis approuvé mercredi par le gouvernement à Londres, constitue le début de la fin du cauchemar qui accapare toute l’énergie politique de la Grande-Bretagne depuis deux ans et demi.
Il faut d’abord rendre hommage à la ténacité de Theresa May. Rarement chef de gouvernement n’a pris autant de coups, subi autant d’humiliations, affronté autant de sarcasmes et de trahisons. Il faut croire que le sens du devoir de la fille de pasteur a été plus fort : cet accord impossible, Mme May a fini par le sortir de son chapeau. Dans son malheur, elle a aussi été servie par la courtoisie et la patience de son interlocuteur, Michel Barnier, qui, tout en négociant d’une position de force, a eu les égards nécessaires avec un pays qu’il respecte profondément. A une époque où les échanges publics d’invectives et de menaces entre dirigeants deviennent un mode de gestion des relations internationales, le maintien de ce savoir-faire européen a quelque chose de rassurant.
Pour autant, Theresa May n’est pas au bout de son calvaire. Si elle a réussi à surmonter mercredi cinq heures de « débats passionnés » avec les membres de son gouvernement, elle n’a pu éviter la démission de deux ministres, le ministre chargé du Brexit, Dominic Raab, et celui de l’Irlande du Nord, Shailesh Vara. Et il lui reste à affronter le plus dur : la Chambre des communes.
C’est là, devant des députés inévitablement déchaînés, qu’il lui faudra expliquer la triste réalité, ou comment, au bout du compte, le Royaume-Uni va se retrouver dans une situation pire que celle dont elle veut sortir. En recommandant aux électeurs de voter oui au référendum du 23 juin 2016 pour quitter l’Union européenne, les partisans du Brexit avaient un argument massue : « Take back control » – reprendre à Bruxelles le contrôle de l’accès au marché, de la circulation des biens et des personnes, des règles environnementales et sociales, parmi d’autres. En un mot, recouvrer la souveraineté nationale.
Remarquable unité des Vingt-Sept
A l’arrivée, sauf à couper tous les ponts et mettre en danger à la fois leur économie et l’union du royaume, les Britanniques continueront à se plier à un nombre important de règles européennes, comme celles de l’union douanière, mais en abandonnant le pouvoir de participer à leur élaboration. Ce compromis a été cruellement résumé par le titre qui barrait mercredi soir la « une » de l’Evening Standard, journal désormais dirigé par l’un des tories qui ont quitté Mme May, George Osborne : « L’UE reprend le contrôle. »
En acceptant cet accord, la première ministre fait voler en éclats les illusions d’un Brexit auquel elle-même, avant de prendre la tête du gouvernement, ne croyait pas. Avait-elle le choix ? Hormis l’option du Brexit dur (la sortie de l’UE sans accord), la pire hypothèse pour tout le monde, probablement pas. Les marchands d’illusions, ceux qui ont mené la campagne de 2016 sur de fausses promesses, feraient bien d’accepter à présent une autre réalité : celle de la remarquable unité dont ont fait preuve les Vingt-Sept dans cette négociation, alors que l’Europe est divisée sur tant d’autres sujets. Dans cette situation que Donald Tusk, le président du Conseil européen, qualifie à juste titre de « perdant-perdant », Londres n’obtiendra pas de meilleur accord.