Dix femmes qui pensent l’Afrique et le monde
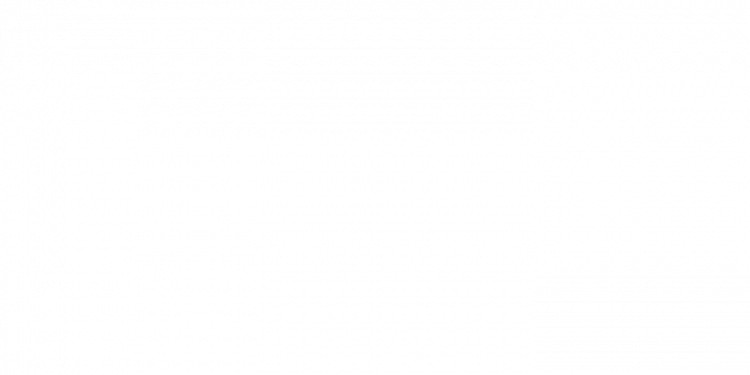
Dix femmes qui pensent l’Afrique et le monde
Par Séverine Kodjo-Grandvaux
Africaines ou afrodescendantes, elles explorent le passé colonial, esclavagiste, le racisme, le féminisme… Portraits.
Elles sont romancière, philosophe, artiste, féministe, chercheuse, militante, politologue, ou tout cela à la fois. Portraits de femmes, africaines ou afrodescendantes, qui vouent leur vie à décrypter le passé colonial, les traites négrières et la place des femmes dans cette mémoire douloureuse pour faire advenir un monde où les femmes noires auront toute leur place.
Chimamanda Ngozi Adichie, la conteuse
Chinua Achebe disait d’elle qu’elle a « le don des anciens conteurs ». Auteure de best-sellers (L’Hibiscus pourpre, L’Autre Moitié du soleil, Americanah) traduits dans trente langues, la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie est aussi bien reconnue de ses pairs, des critiques littéraires que des personnalités du monde politique ou du show-business. A seulement 41 ans, elle est considérée comme l’une des plus grandes plumes du continent, récompensée par de nombreux prix prestigieux. Elle profite d’une telle aura que ses propos sur le féminisme, le racisme, le sexisme, les migrations ou encore la situation post-coloniale sont largement repris et commentés.
Avec son franc-parler, Chimamanda Ngozi Adichie, qui partage sa vie entre les Etats-Unis et le Nigeria, où elle est née en 1977, refuse les étiquettes d’« écrivaine africaine », « afropolitaine ». Elle préfère se présenter comme une « féministe africaine heureuse qui ne déteste pas les hommes » (Nous sommes tous des féministes, Gallimard, 2015). Dans son œuvre, elle choie les détails et développe une analyse très fine qui déconstruit les stéréotypes accolés à l’Afrique et à ses habitants, aux Noirs, aux femmes, aux migrants et donne à voir, à rebours, les sociétés occidentales, comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne.
Chimamanda Ngozi Adichie : « Je suis féministe et noire mais je ne veux pas être seulement une porte-parole »
Durée : 01:09
Elle rejette également la qualification d’« afroféministe », rétorquant que les Africains n’ont pas besoin de termes spécifiques pour se penser ou définir leurs actions. Mais contrairement à Awa Thiam qui, en 1978, dans La Parole aux négresses, interrogeait déjà l’universalisme du féminisme occidental, Chimamanda Ngozi Adichie ne contextualise guère sa pensée : les conditions économiques et historiques qui ont produit le patriarcat ou le racisme qu’elle dénonce sont peu analysées. Et elle évacue rapidement la dimension culturelle en affirmant que « la culture ne crée pas les gens. Les gens créent la culture ». Tout le contraire de l’approche de Françoise Vergès qui, dans l’aire francophone, revient sur les spécificités du féminisme des Africaines et des afrodescendantes.
Tanella Boni, la résistante
Tanella Boni, philosophe, romancière et poétesse ivoirienne, en 2012 au salon du livre de Genève. / Ludovic Péron
« On résiste par les mots », affirme Tanella Boni, qui multiplie les actes de résistance. Philosophe, romancière – Prix Ahmadou Kourouma 2005 pour Matins de couvre-feu (Le Serpent à plumes) –, poétesse – médaille de bronze du prix Théophile-Gautier de l’Académie française 2018 pour Là où il fait si clair en moi (Bruno Doucey, 2017) –, auteure jeunesse, l’Ivoirienne de 64 ans invite à réenchanter un « monde qui se défait fil à fil ». Ses poèmes et ses travaux philosophiques interrogent la manière dont les femmes et les hommes peuvent l’habiter « en humains » et conserver, malgré la violence qui s’y déploie, leur dignité. Un thème qui, à l’instar de la question de la possibilité d’un monde pour tous, traverse l’œuvre multiforme de la vice-présidente de la Fédération internationale des sociétés de philosophie.
L’un de ses ouvrages principaux, Que vivent les femmes d’Afrique ? (éditions du Panama, 2008), questionne le concept de genre et la place des femmes d’Afrique dans la réflexion féministe, à la fois comme objet d’étude et comme auteures, et montre comment l’« insécurité féminine » peut être un levier d’action et de pensée pour des femmes qui multiplient les « stratégies de résistance et de révolte ». Pour l’enseignante de l’université Félix-Houphouët-Boigny, à Abidjan, les Africaines propagent de nouvelles « formes d’invention ou de réinvention de la manière de participer aux affaires publiques » (revue Diogène 2007/4, n° 220) et donc de concevoir la citoyenneté, notamment en investissant le religieux.
Tanella Boni questionne le politique à travers la place des exclus – les femmes, les migrants, les pauvres… – d’un monde qui « fabrique des zombies » (Diogène 2012/1, n° 237), ces « humains [qui] se transforment peu à peu en ombres flottantes, sans volonté, supportant des violences inouïes ». Avant de souligner leur capacité à réinventer le monde car ils sont « “in-tuables”, comme le suggère cet adage qui a cours dans les rues d’Abidjan : “Cabri mort n’a pas peur du couteau” ».
Ken Bugul, la résiliente
Mariètou Mbaye, romancière francophone sénégalaise, plus connue sous son nom de plume, Ken Bugul. / Antoine Tempé
« Celle dont personne ne veut », ken bugul, en wolof. Le pseudonyme que s’est choisi Mariètou Mbaye sur les vives recommandations des Nouvelles Editions africaines lors de la parution de son premier roman, Le Baobab fou (1984), reflète une grande partie de sa vie. Née en 1947 d’un père âgé de 85 ans, elle a été délaissée par sa mère quand elle avait 5 ans, battue et internée à la demande de l’homme qu’elle aimait – un Parisien des beaux quartiers – lorsqu’elle vivait en France, puis rejetée par sa famille à son retour au Sénégal. Mais Mariètou Mbaye aurait aussi pu choisir un nom qui traduise l’incroyable force et l’insatiable désir de liberté qui l’ont toujours portée. Car, si sa vie a été faite de souffrance, elle révèle une résilience à toute épreuve et une indépendance chevillée au corps et à la plume.
Toute sa vie, elle s’est libérée de l’emprise des hommes et des catégories, africaines ou occidentales, du prêt-à-penser. Figure incontournable de la littérature en Afrique, Ken Bugul est l’auteure, entre autres, d’un triptyque autobiographique. Le Baobab fou, au parfum de scandale, évoque le destin d’une Africaine arrivée en Occident qui découvrira drogue et alcool, sexe et prostitution. Cendres et braises (L’Harmattan, 1994) dénonce les violences conjugales. Quant à Riwan ou le chemin de sable, Grand Prix littéraire d’Afrique noire 1999, il bouscule les idées sur la condition des femmes en Afrique. Ken Bugul y narre son retour au pays, le rejet des siens, et son mariage avec celui qui la sauvera, un serigne (guide spirituel) dont elle deviendra, à 32 ans, la vingt-huitième épouse et qui l’encouragera à écrire.
Bien avant qu’on ne parle d’« afroféminisme », les romans de Ken Bugul questionnent la condition féminine et l’importance de penser les identités comme des identités de relation, qui ne doivent pas se couper de leur source. Son œuvre est aussi une réflexion sur l’assimilation, l’acculturation et la nécessité de garder le lien avec ses racines afin de ne pas être une pâle copie des autres et de devenir « une personne quasi irréelle, absente de ses origines », car la modernité n’est pas là.
Nadia Yala Kisukidi, l’afrocentrée
Maîtresse de conférence à l’université Paris-VIII, Nadia Yala Kisukidi est, à 40 ans, l’une des très rares universitaires français à consacrer un séminaire à la philosophie africaine, ou plus largement à ce qu’on appelle la philosophie africana, qui intègre les réflexions et productions théoriques des diasporas (Caraïbes, Etats-Unis, Amérique du Sud, Europe…). Face à une absence quasi systématique de références non occidentales dans les travaux scientifiques et les enseignements universitaires, cette spécialiste de Bergson a organisé avec ses collègues Matthieu Renault, Farah Chérif Zahar, Guillaume Sibertin-Blanc et Orazio Irrera, un séminaire de recherche et pédagogique sur les « archives non européennes de la philosophie », questionnant la façon dont s’est construite cette discipline en France et le corpus sur lequel elle repose. Une manière de poursuivre le travail amorcé à la fin des années 1980 par V. Y. Mudimbe qui a pointé la prédominance d’une « bibliothèque coloniale » dès lors qu’il s’agit de penser « l’idée d’Afrique ».
Travaillant à la croisée de « la problématique noire telle qu’elle se pose en France et en Europe dans un contexte d’impensé colonial et racial » et de la question africaine, afin de compliquer la notion de diaspora, Nadia Yala Kisukidi, née d’une mère franco-italienne et d’un père congolais (RDC), se démarque des approches identitaires. Dans son ouvrage Espérance noire (Editions Amsterdam, à paraître en 2019), elle cherche, explique-t-elle au Monde, à « ressaisir la question noire dans un spectre de questionnements oniriques, non essentialistes et selon un mode symbolique » et s’interroge sur le « statut du nom “noir” » en sondant la fécondité politique et théorique de son usage. « Je me situe dans une aporie, détaille-t-elle, celle de la nécessité d’abandonner le mot “noir”, du fait de sa dimension essentialiste, et la nécessité de son maintien car, paradoxalement, c’est aussi un rempart contre la race ». Ce qui l’amène à relire Cheikh Anta Diop et à retravailler la notion d’afrocentricité.
Koyo Kouoh, la curatrice
Koyo Kouoh, commissaire d’exposition camerounaise, installée à Dakar. / DR
L’objectif est clair : « penser un commissariat [d’exposition] décolonial » et « de manière plus poussée, [évoquer] le refus même de le penser dans un espace théorique qui a, avant tout été défini par l’Occident, ou réfléchir sur les conséquences de la dominance masculine et des transgressions misogynes existant dans un champ professionnel marqué, entre autres paradigmes, par les hiérarchies de genre et de race ». Pour la 6e session de la RAW Académie, intitulée « Cura » et qui aura lieu de mars à mai 2019, Koyo Kouoh propose d’envisager de nouvelles manières de donner à voir et à penser avec les artistes africains. Dans un contexte postcolonial où perdurent les tentations hégémoniques, il importe plus que jamais de ne pas oublier que concevoir une exposition est « une manière d’écrire et de ré-écrire des histoires, de lire le présent et d’imaginer tous les futurs possibles ».
A 51 ans, la Camerounaise est l’une des plus importantes curatrices africaines. Elle a notamment collaboré aux Documenta de 2007 et de 2012, à la Biennale de Dakar, aux Rencontres de Bamako. Son travail explore la matrice coloniale au-delà de la seule histoire européo-africaine (« Still (the) Barbarians », 2016), le rapport que les femmes africaines entretiennent à leur corps. Lequel peut être un outil politique, de domination ou de résistance, un lieu de crime lorsqu’il est violé, maltraité ou tué (« Body Talk », 2014). Les questions de genre, de féminisme, de sexualité sont auscultées, repensées.
Installée à Dakar depuis 1996 après une enfance passée au Cameroun et une adolescence en Suisse, Koyo Kouoh dirige la RAW Material Company (raw signifie « brut » en anglais et « pionnier » en wolof), qu’elle a conçue comme un centre d’exposition et d’expérimentation, une fabrique où l’on produit du savoir, et où alternent manifestations culturelles, résidences d’artistes, d’écrivains ou de commissaires d’exposition, conférences, débats où chacun est invité à réfléchir au-delà des disciplines. Une « manière d’être, de vivre et de penser avec et à travers l’art et les artistes ».
Seloua Luste Boulbina, la philosophe
A la lecture de L’Afrique et ses fantômes. Ecrire l’après (Présence africaine, 2015), on comprend à quel point, chez Seloua Luste Boulbina, vie personnelle et quête intellectuelle sont liées. Née en France d’une mère française et d’un père algérien, avant de grandir dans l’Algérie nouvellement indépendante, la philosophe, chercheuse associée au Laboratoire du changement social et politique de l’université Paris-Diderot, questionne l’après-colonisation et ses résidus – physiques, intellectuels, psychologiques… – des deux côtés de la Méditerranée. Et distingue le postimpérial du postcolonial.
Le premier concerne les anciennes métropoles et nécessite qu’elles sortent du colonialisme, autrement dit qu’elles se dépouillent de leur mentalité et de leurs réflexes de colon qui font qu’elles mettent, sur leur propre territoire, les afrodescendants en situation de minorité. Le second est l’affaire des ex-colonisés qui doivent surmonter le traumatisme du passé colonial, sortir de l’emprise et « restaurer les subjectivités niées ». Car, rappelle-t-elle, l’indépendance n’a été que l’événement du processus de décolonisation, lequel n’est toujours pas achevé et nous oblige, au Nord comme au Sud, à sonder nos géographies et cartographies mentales et intellectuelles. Dès lors, dit-elle dans Les Miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs (Presses du réel, 160 pages, 15 euros), l’approche décoloniale devient un travail sur soi, une exigence épistémique et éthique.
Directrice de programme au Collège international de philosophie entre 2010 et 2016, Seloua Luste Boulbina est, selon le philosophe Achille Mbembe, l’auteure de « l’un des projets critiques sans doute les plus fertiles dans le paysage intellectuel français contemporain ». Passionnée de littérature et d’art contemporain, elle s’appuie sur ceux-ci pour étayer ses réflexions en ce qu’ils sont des lieux où les imaginaires se construisent et se déconstruisent et des laboratoires d’expérimentation de nouvelles rationalités.
Léonora Miano, l’inclassable
L’auteure camerounaise Léonora Miano, à Dakar 2016. / ANTOINE TEMPE
Léonora Miano écrit constamment. Au point que, lorsque l’un de ses livres paraît, elle en a toujours d’autres, en stock, déjà achevés. Auteure d’une œuvre dense – récompensée entre autres par le Goncourt des lycéens 2006 pour Contours du jour qui vient (Plon) et par le prix Femina 2013 pour La Saison de l’ombre (Grasset) – qui emprunte les formes du roman, du théâtre ou de conférences, elle questionne sans relâche les sociétés du « Nord » ou celles du « Continent ». Leurs tabous et leur part d’ombre, les relations hommes-femmes et la manière dont ces sociétés construisent leurs liens à l’autre, fréquenté depuis cinq siècles, marqués par la barbarie de l’esclavage et de la colonisation.
Léonora Miano dérange. Elle ne plaît guère à ceux qui aimeraient croire que la France ait fait « œuvre de civilisation » en Afrique ou qui, plus nombreux, ne perçoivent pas leur propre racisme en l’accusant de communautarisme parce qu’elle écrit sur les siens, les Subsahariens ou les « Afropéens » – terme qu’elle a largement aidé à diffuser en France –, que la société française a vite fait de réduire à leur seule couleur de peau. Pourtant, la native de Douala (Cameroun), âgée de 45 ans et installée en France depuis l’âge de 19 ans, n’écrit pas sur les « Noirs », encore moins emploie-t-elle ce mot. Au contraire, elle déconstruit méticuleusement l’invention européenne de la race et montre comment, pour arriver à qualifier d’autres de « Noirs », il a fallu d’abord se considérer comme « Blanc ». Procédant ainsi, elle écrit, à rebours, sur l’Occident, et lui renvoie une image peu flatteuse.
Refusant toute assignation identitaire, Léonora Miano « habite la frontière » (Habiter la frontière, L’Arche, 2012), où « les mondes se touchent », se rencontrent. Celle qui conçoit la pratique littéraire comme « une philosophie de vie », un « moyen d’entrer en relation avec les autres » (L’Impératif transgressif, L’Arche, 2016), invite ceux qui ont été dépossédés d’eux-mêmes à tracer leur voie, à définir leurs propres finalités, loin des injonctions. C’est là l’art d’être indiscipliné et de conquérir sa liberté afin d’être soi. Un « impératif transgressif » universel.
Olivia Umurerwa Rutazibwa, la politologue
Vous êtes-vous déjà demandé à partir de quels présupposés l’on pouvait considérer qu’il était bon d’envoyer en Afrique de jeunes gens occidentaux, à peine la vingtaine, sans expérience, afin de dire aux populations locales – dont ils ne parlent pas la langue – ce qu’elles devaient faire pour se « développer » ? Selon la politologue belgo-rwandaise Olivia Umurerwa Rutazibwa, ce n’est là que l’une des expressions des relations racialisées qui perdurent entre le Nord et le Sud.
Enseignante-chercheuse à l’université de Portsmouth, au Royaume-Uni, Olivia Umurerwa Rutazibwa interroge les politiques internationales dans une perspective décoloniale, consistant à déconstruire les mythes vivaces concernant l’Afrique et l’Occident, à ne plus imposer le silence aux pensées du Sud et à opter pour des stratégies anticoloniales.
A travers ce triple impératif, elle questionne les politiques d’aide au développement. Et note que ces dernières rejouent l’idée d’une « mission civilisatrice » et perpétuent « un statu quo colonial », reposant sur le mythe de nations supérieures auxquelles échoit un droit d’ingérence. Olivia Umurerwa Rutazibwa constate que ni les politiques ni les études sur l’aide et le développement ne s’interrogent sur l’origine des relations asymétriques entre nations et ne perçoivent en quoi la traite et la colonisation ont produit ce « besoin » d’aide. Une approche décoloniale démontrant que le projet de la Modernité est inséparable de celui de la colonialité et qui repositionne le débat. Il ne s’agit pas de « jeter le bébé avec l’eau du bain » et de renoncer à l’aide. Il faut au contraire en faire un outil anticolonial en la pensant non pas comme un acte généreux de nations riches, mais comme une façon de « réparer » l’histoire en « restituant ». En un mot, de rendre justice.
Autre manière de rendre justice : ne plus nier les épistémologies locales – ce qui amène, par exemple, l’enseignante-chercheuse à conceptualiser la notion rwandaise antécoloniale d’« agaciro » pour penser autonomie et estime de soi – afin de démultiplier les approches pour construire, selon l’utopie zapatiste, un monde dans lequel plusieurs mondes sont possibles. Un monde non pas universel mais pluriversel.
Maboula Soumahoro, la militante
En 2017, les colonnes des journaux français ont vu fleurir la notion de « charge mentale » pour désigner le fait que les femmes, outre leurs préoccupations professionnelles, doivent sans cesse penser en parfaites gestionnaires à la bonne organisation du foyer et de la famille. Le retour en force de cette notion, longtemps cantonnée à la sphère féministe, a permis à un large public de penser de nouveau les réalités du quotidien des Françaises. De toutes les Françaises ? Pas sûr.
Dans une tribune publiée dans Libération le 1er juin 2017, l’universitaire et militante Maboula Soumahoro a rappelé que si les Afropéennes et Africaines vivant dans l’Hexagone avaient certes le poids de cette charge mentale sur leurs épaules, elles devaient aussi porter celui de ce qu’elle a nommé la « charge raciale ».
« La notion de charge raciale, écrit-elle, permet de faire toute la lumière sur le système qui impose au groupe dominé racialement de gérer et de rassurer le groupe dominant. C’est-à-dire qu’il revient aux dominés de ne pas faire état de leur subalternité afin de ne pas déranger les dominants. Et même lors des discussions autour de cette inégalité, le groupe dominant doit pouvoir garder son confort, son privilège, sa centralité. »
Maboula Soumahoro, qui est née en France en 1976 au sein d’une famille originaire de Côte d’Ivoire, rappelle combien les obstacles se dressent sur le chemin des femmes « racisées ». Maîtresse de conférences en civilisation du monde anglophone à l’université de Tours, enseignante à Sciences Po et à Bennington College, dans le Vermont, Maboula Soumahoro traque les traces de l’histoire de l’esclavage et de la colonisation dans la construction des identités collectives et individuelles, de la citoyenneté et du politique, dans une France qui oscille entre racisme et aveuglement. Elle est, en outre, à l’origine du Black History Month (« mois de l’histoire des Noirs ») en France, qui met en valeur les cultures issues de la diaspora africaine.
Françoise Vergès, la décolonisatrice
La politologue et auteure Françoise Vergès, à Dakar en 2016. / Antoine Tempé
La vie de Françoise Vergès est faite de mouvements et de géographies divers qui démultiplient son regard et l’amènent non pas à fragmenter les réalités et à les opposer, mais au contraire à les lier pour épaissir et complexifier les analyses historicistes. Née à Paris en 1952, elle a passé son enfance à La Réunion, son adolescence à Alger, puis a vécu en France, aux Etats-Unis, s’est déplacée en Union soviétique, au Salvador, au Chili pour soutenir les femmes face à la dictature, a enseigné à Londres, se rend régulièrement en Afrique pour ses activités de chercheuse. Politologue, titulaire de la chaire Global South(s) à la Fondation Maisons des sciences de l’homme, à Paris, Françoise Vergès est spécialiste des questions liées à la traite négrière – de 2009 à 2012, elle a présidé le Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage –, au genre ainsi que des études post- et décoloniales.
Privilégiant une approche intersectionnelle et liant le colonialisme et le racisme au capitalisme, Françoise Vergès appelle, dans Le Ventre des femmes (Albin Michel, 2017), à « dénationaliser le féminisme » français afin de prendre en compte les contre-récits et les « voix dissonantes ». Elle reproche aux féministes de l’Hexagone d’occulter la spécificité de la condition des Africaines et des afrodescendantes. Leur histoire, rappelle-t-elle, est celle de la traite négrière et de la colonisation, périodes pendant lesquelles elles ont été massivement violées et où on leur a arraché leurs enfants pour les donner aux maîtres des plantations. Celle de femmes qui, dans les années 1970, à La Réunion, ont été avortées et stérilisées, sans même en avoir été informées, sur incitation des autorités françaises.
Pour Françoise Vergès, l’histoire de ces femmes est révélatrice d’une « colonialité républicaine » qui a forgé la France actuelle. Une France qui refuse de voir à quel point elle a « racisé » une partie des siens, et continue de les minorer. Françoise Vergès est, par ailleurs, membre fondatrice du collectif Décoloniser les arts.












