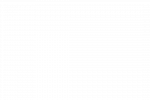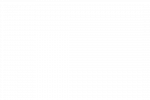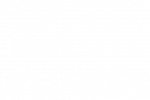Avec leur départ de Syrie, les Etats-Unis prennent de court leurs alliés

Avec leur départ de Syrie, les Etats-Unis prennent de court leurs alliés
Par Gilles Paris (Washington, correspondant)
Donald Trump a décidé brusquement de mettre fin à la présence de forces spéciales américaines, contre l’avis de sa propre administration.
DELIL SOULEIMAN / AFP
Donald Trump a comblé des adversaires des Etats-Unis et frappé de stupeur certains de leurs alliés, mercredi 19 décembre, en décidant brusquement de mettre fin à la présence des forces spéciales dans le nord-est de la Syrie. Ce retrait pourrait être achevé d’ici un mois et il a déjà commencé, selon un communiqué de la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, publié dans la matinée, sans toutefois apporter la moindre précision chiffrée.
Le président a justifié une décision qui a manifestement pris de court sa propre administration en déclarant de bon matin sur son compte Twitter : « Nous avons vaincu l’Etat islamique [EI] en Syrie, ma seule raison d’y être pendant la présidence Trump. » « Nous avons gagné. (...) Il est temps que nos troupes rentrent à la maison. Nos garçons, nos jeunes femmes, nos hommes, ils rentrent tous, et ils rentrent maintenant », a-t-il ensuite confirmé dans une vidéo, publiée dans la soirée.
Peu convaincu de longue date de l’intérêt de s’investir militairement sur place, le président des Etats-Unis a toujours circonscrit les ambitions américaines à la lutte contre le groupe djihadiste. Alors que celle-ci a enregistré, le 14 décembre, un nouveau succès avec la prise, par les milices kurdes, de Hajin – dernière localité aux mains de l’EI, près de la frontière avec l’Irak, dans la vallée de l’Euphrate –, le Pentagone et le département d’Etat n’ont cessé de militer pour le maintien sur place de ce contingent de 2 000 membres des forces spéciales déployé sans le moindre mandat international.
« Se débarrasser [de l’EI] ne signifie pas que vous dites aveuglément : “Bon, on s’en est débarrassé”, et que vous vous en allez, pour ensuite vous interroger sur le fait qu’il réapparaît », avait assuré, en septembre, le secrétaire américain à la défense, James Mattis.
Dissonances
Donald Trump, à la Maison Blanche, le 18 décembre. / EVAN VUCCI / AP
L’envoyé spécial du président chargé de la coalition internationale mise sur pied pour lutter contre les djihadistes n’a pas dit autre chose, le 11 décembre, au département d’Etat. « On peut considérer que les Américains resteront sur le terrain après la défaite [de l’EI], jusqu’à ce que nous ayons tous les éléments en main pour faire en sorte que cette défaite soit durable », a assuré Brett McGurk. Il a même jugé toute autre politique « téméraire », ajoutant que « toute personne ayant examiné un conflit comme celui-ci ne pourrait qu’être d’accord avec ça ».
Le 17 décembre, l’envoyé spécial de Washington pour la Syrie, James Jeffrey, a tenu le même discours devant l’Atlantic Council, un cercle de réflexion de Washington, sans évoquer une seule fois l’hypothèse d’un retrait précipité.
En septembre, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, avait rappelé une autre justification du maintien de ces forces spéciales en Syrie. « Nous ne partirons pas tant que les troupes iraniennes resteront à l’extérieur des frontières iraniennes, ce qui vaut également pour les milices iraniennes » déployées en Syrie à la faveur de la guerre civile, avait-il assuré en marge de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU). Interrogé sur ces dissonances, un haut responsable de l’administration a défendu une « prérogative » présidentielle.
Un précédent, le retrait d’Irak ordonné par Obama
Le Monde
La décision de Donald Trump rappelle un précédent pour lequel il n’avait pourtant pas eu de mots assez durs : le retrait d’Irak ordonné par Barack Obama en 2011, jugé précipité. Ce retrait, conforme à l’engagement du président démocrate, avait alors privé les Etats-Unis d’influence sur le gouvernement dirigé par Nouri Al-Maliki. Les dérives sectaires de ce premier ministre chiite avaient contribué à la renaissance du djihadisme dans les provinces sunnites du pays et à l’avènement de l’EI, tout d’abord en Irak, puis en Syrie, à la faveur de la guerre civile. L’un des « faucons » républicains du Congrès, Lindsey Graham, sénateur de Caroline du Sud, furieux de cette décision précipitée, ne s’est d’ailleurs pas privé d’établir cette comparaison peu flatteuse, mercredi, en dépit de sa proximité avec le président.
Dans une équation régionale particulièrement complexe, les forces spéciales américaines ne se sont pas limitées strictement à la simple mission d’éradication des djihadistes. Elles ont également joué un rôle stabilisateur en tenant à distance les forces du régime de Bachar Al-Assad et leurs alliés iraniens, ainsi que celles de la Turquie. Leur présence sur place a protégé en effet les forces locales à dominante kurde qui se sont portées au premier rang de la bataille contre l’EI, comme encore à Hajin, vendredi. Or, la Turquie considère ces dernières comme une extension du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qu’elle combat militairement à l’intérieur de ses frontières.
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’était vanté, lundi, d’avoir désormais le feu vert de Washington pour que « les groupes terroristes soient chassés de l’est de l’Euphrate », après un entretien téléphonique avec son homologue américain, le 14 décembre. « Nous pouvons enclencher nos opérations en Syrie à n’importe quel moment à partir des territoires qui correspondront à nos projets », a-t-il averti.
Déception israélienne
Des véhicules de la coalition soutenue par les forces américaines dans la ville de Manbij, dans le nord de la Syrie, en mai 2018. / DELIL SOULEIMAN / AFP
Le retrait des forces américaines témoigne en fait d’un renoncement à toute stratégie syrienne. Le président n’est pas le premier à reculer sur ce dossier. L’inertie de son prédécesseur avait permis à la Russie de faire un retour spectaculaire au Levant, en 2015. Après la décision de mercredi, le président Vladimir Poutine y sera plus que jamais en position d’arbitre.
L’autre grand bénéficiaire de cette décision est le dirigeant syrien Bachar Al-Assad. Lundi, James Jeffrey a assuré que Washington souhaitait « un régime qui soit fondamentalement différent », tout en indiquant ne pas vouloir se « débarrasser d’Assad ».
Ces attentes risquent d’être considérablement déçues s’il ne reste plus à Washington et à ses alliés européens, pour peser sur une issue politique satisfaisante à la guerre civile, que le levier de la reconstruction dans un pays qui aura besoin de centaines de milliards de dollars pour se relever de ses ruines.
Le retrait américain de Syrie ajoute enfin une note discordante à la stratégie offensive de Washington visant l’Iran. Donald Trump abandonne en effet un terrain sur lequel l’influence de Téhéran s’est faite plus pesante au cours des dernières années. Cette même influence contre laquelle les Etats-Unis entendent pourtant lutter.
La tonalité du communiqué laconique publié mercredi par le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, à propos « d’une décision américaine », a témoigné de sa déception. Il a précisé que le gouvernement allait étudier les conséquences de ce désengagement en ajoutant qu’Israël « saura se défendre » contre toute menace venant de Syrie.