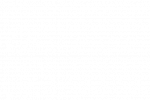« Gilets jaunes » : « L’usage de la violence est toujours un calcul risqué »

« Gilets jaunes » : « L’usage de la violence est toujours un calcul risqué »
Propos recueillis par Charlotte Chabas (Propos recueillis par)
Pour Xavier Crettiez, professeur de science politique, ce qui se déroule chaque samedi n’est plus vraiment, en raison des violences, une manifestation « au sens traditionnel ».
Acte XVIII des « gilets jaunes » à Paris : affrontements violents et incendies sur les Champs-Elysées
L’acte XVIII des « gilets jaunes », samedi 16 mars, a été le théâtre de nouvelles violences sur les Champs-Elysées, à Paris, dont le niveau d’intensité a rappelé des scènes vues début décembre 2018, au plus fort du mouvement social.
Pour Xavier Crettiez, professeur de science politique à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, spécialiste de la radicalisation et de la violence politique, « s’il n’y a pas de prise de distance entre les “gilets jaunes” et les casseurs, la condamnation populaire va être de plus en plus forte ».
Avez-vous été surpris par cette résurgence de violences après dix-huit semaines de mobilisation ?
Tout me surprend dans ce mouvement des « gilets jaunes ». Sur le papier, il avait toutes les caractéristiques pour ne pas durer, notamment du fait du manque de ressources idéologiques, organisationnelles ou financières. Mais nous sommes nombreux à avoir sous-estimé la puissance de la ritualisation de l’action collective, à quel point elle galvanise ceux qui y participent.
Ce que je ne m’explique pas dans l’épisode de samedi, c’est qu’on savait qu’il allait y avoir un regain de violences. On savait que des ultras avaient appelé à venir à Paris, que des black blocs étaient attendus de Belgique. Ce sont des professionnels de l’émeute, qui viennent se greffer au mouvement des « gilets jaunes » de manière ponctuelle et opportuniste. C’est une addition surprenante et hétéroclite, mais qui semble aujourd’hui acceptée, voire saluée par les « gilets jaunes » qui manifestent chaque semaine.
Au vu de ce qu’on voyait sur les réseaux sociaux, il y a donc eu soit une très forte défaillance de la part de la police, soit une stratégie pour dégrader l’image des « gilets jaunes » auprès de l’opinion publique, en les associant à l’image de casseurs. Dans les deux cas, c’est très risqué pour le gouvernement.
On continue à parler de manifestations pour évoquer les actes hebdomadaires des « gilets jaunes ». Ce terme est-il toujours approprié ?
Ce qui se déroule chaque samedi n’est plus une manifestation au sens traditionnel. Historiquement, on estime que la première manifestation de l’histoire française remonte à 1909. En soutien au militant libertaire espagnol Fransisco Ferrer, le parti socialiste et Jean Jaurès avaient alors transformé des émeutes en manifestations, en créant un service d’ordre. L’idée était d’impressionner la bourgeoisie en défilant dans le calme. C’était une mise en scène organisée, il y avait un cortège, un début, une fin, une mise à l’écart des éléments perturbateurs.
Or, chez les « gilets jaunes », il y a précisément un refus de cette pratique traditionnelle de la manifestation. Tout est fait pour s’affranchir de ces règles institutionnalisées. On ne dépose plus de demande d’autorisation car on ne veut plus se montrer dans une position où on échange avec l’Etat. Ce qui est novateur dans ce mouvement, c’est cette volonté de couper avec tous les codes classiques de la manifestation. Cette suppression du cadre génère forcément du désordre.
Mais la durabilité inédite du mouvement le distingue aussi d’une émeute, qui est souvent un événement spontané mais sporadique. Il faudrait inventer un nouveau terme, pour ce nouveau mode d’action.
Quel rôle jouent les forces de l’ordre dans ces violences ?
Je pense que la violence est déconnectée des finalités initiales du mouvement des « gilets jaunes ». Elle est surtout la conséquence du face-à-face immédiat avec les forces de l’ordre, devenues objet de détestation et incarnation d’une violence étatique. Il faut rappeler que la répression policière du mouvement des « gilets jaunes » est d’une ampleur inédite. Il suffit de regarder le nombre de blessés depuis le début du mouvement pour s’en rendre compte. Or beaucoup de « gilets jaunes » n’avaient jamais manifesté auparavant. La découverte de la force de la répression a été une surprise. Etre gazé ou visé par des tirs de grenade de désencerclement, cela provoque une forme de radicalisation.
Peut-on sortir de cette logique d’affrontement entre manifestants et policiers ?
La violence crée une forme d’addiction, ça génère de l’adrénaline. Ces mobilisations hebdomadaires sont devenues un rendez-vous où l’on se lâche, où l’on vit intensément. J’entendais un « gilet jaune » dire qu’il participait à la manifestation parisienne parce qu’il voulait dire à ses petits-enfants qu’« il y était ». Avoir le sentiment de faire l’Histoire, ça galvanise, ça donne un statut. Renoncer à ce statut est douloureux, et sortir de la logique jusqu’au-boutiste aussi.
D’autant que, pour l’heure, le mouvement ne parvient pas à trouver d’autres débouchés que la rue, puisqu’il ne parvient pas vraiment à se structurer et à proposer autre chose, comme la formation d’un parti qui fasse l’unanimité dans les rangs.
Les violences ne sont pas rares dans les mouvements sociaux. Pourquoi celles-ci choquent-elles autant ?
On a effectivement connu bien pire par le passé. Le niveau de violence n’a rien à voir avec des manifestations de sidérurgistes dans les années 1990, ou avec des démonstrations de force de factions d’extrême droite ou d’extrême gauche dans les années 1960-1970.
Mais nous vivons dans une société plus sensibilisée à la violence. Paradoxalement, la société est devenue moins violente, nous y sommes moins confrontés dans notre quotidien. Du coup, les images de violences nous choquent encore plus. Or, jamais un mouvement social n’a été aussi médiatisé, aussi visible. Ses acteurs eux-mêmes sont constamment en train de se filmer, de se diffuser sur les réseaux sociaux. Cette survisibilité inédite donne la sensation d’un Paris à feu et à sang.
Comment le mouvement des « gilets jaunes » en est-il arrivé à être autant associé à une image de violences ?
Au début du mouvement, la violence était acceptée car perçue comme l’expression d’un désespoir profond, entendable pour l’opinion publique. Une majorité comprenait que ces gens étaient poussés à bout par une violence plus importante encore, celle de leur condition sociale. Cette empathie s’explique aussi par le fait qu’il s’agissait d’une détresse de personnes blanches, souvent rurales, d’un certain âge, ou encore de familles. De telles violences auraient été nettement moins bien acceptées si elles avaient été commises par de jeunes hommes issus de l’immigration dans les quartiers.
Mais l’usage de la violence est toujours un calcul risqué : à un moment cela devient contre-productif. Le seuil de légitimation de la violence d’un mouvement social est toujours multifactoriel. Dans le cas des « gilets jaunes », la durabilité et la récurrence des actes ont contribué à provoquer une lassitude de l’opinion, qui s’est progressivement retournée contre le mouvement. S’il n’y a pas de prise de distance entre les « gilets jaunes » et les casseurs, la condamnation populaire va être de plus en plus forte.