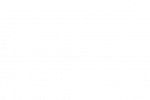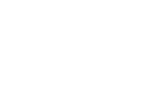« Le régime algérien met en danger le pays pour se sauver »
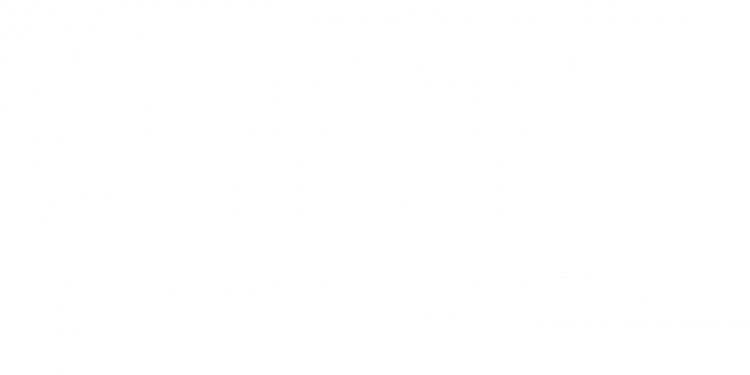
« Le régime algérien met en danger le pays pour se sauver »
Propos recueillis par Madjid Zerrouky
Le spécialiste de droit international Mouloud Boumghar estime que le régime ne cherche qu’à gagner du temps au risque de faire dégénérer la situation.
Professeur de droit public et spécialiste de droit international et des droits de l’homme,
Mouloud Boumghar estime qu’avec la proposition d’empêchement d’Abdelaziz Bouteflika, le régime ne cherche qu’à gagner du temps au risque de faire dégénérer la situation.
Comment interprétez-vous la demande d’un recours à un empêchement du président Bouteflika par l’armée, aujourd’hui soutenue par des pans entiers du régime ?
Mouloud Boumghar : Nous sommes encore face à une manœuvre anticonstitutionnelle malgré une apparence de légalité. De quel droit, le chef d’état-major de l’armée peut-il enjoindre le Conseil constitutionnel à se réunir ? C’est un abus de pouvoir et ce sont des forces anticonstitutionnelles qui sont à la manœuvre avec comme seul objectif sauver le régime en provoquant un empêchement. Pour organiser une nouvelle élection au bout d’un processus qu’elles veulent contrôler.
Là, on ne change pas le régime, on change la tête, ou les têtes. D’ici là, les méthodes de l’administration vont-elles cesser ? Ces institutions issues de fraudes électorales qu’elles organisent vont-elles changer ? Le vrai problème est que les institutions politiques ont été détournées de leur fonction quotidienne et que ce sont ces forces dites « occultes » qui gouvernent le pays.
Avec les délais prévus par l’article 102 de la Constitution – l’empêchement –, le régime peut gagner 135 jours pour prolonger artificiellement le mandat de Bouteflika avec le président du Conseil de la nation, un proche issus du sérail, à sa place. Le régime veut gagner du temps, ce qu’il fait depuis le début de la contestation.
C’est-à-dire ?
Récapitulons le déroulé des événements avec les lettres d’Abdelaziz Boutedlika, ou du moins celles qui sont écrites en son nom. Le 3 mars, le message, c’est « Elisez-moi en cours de mandat pour un nouveau mandat ». Le 11 mars : plus d’élection. « Je reste » au-delà du terme du mandat présidentiel actuel pour tout changer.
Le régime a donc alors choisi l’annulation pure et simple du scrutin du 18 avril et la prorogation du quatrième mandat pour conduire un processus de transition contrôlé par le pouvoir. Personne n’a réagi alors que cette mesure était une violation flagrante de la Constitution. Ni le Conseil constitutionnel, ni le gouvernement, ni le Parlement. Le chef d’état-major, Gaïd Salah, a-t-il lui-même réagi ? Non. Il a même été reçu par Abdelaziz Bouteflika.
Le président Bouteflika (à gauche) a reçu le chef d’état-major, Gaïd Salah, mercredi 27 juin. / Ramzi Boudina / REUTERS
Ont été annoncées la constitution d’un gouvernement de « compétences nationales » et la convocation d’une conférence nationale dite inclusive pour piloter une transition. Il n’y a pas eu de gouvernement, pas plus de conférence nationale.
Les walis (« préfets ») ont pourtant reçu pour instruction d’identifier des figures qui émergent dans le mouvement de contestation pour les amadouer. Apparemment, cela n’a pas marché.
Ces mesures ont été accueillies comme une provocation par le mouvement populaire qui les a rejetées. Tout comme il avait rejeté la proposition du 3 mars, quand Bouteflika demandait à ce qu’on l’élise en promettant lui-même de réformer le régime !
L’application de l’article 102 de la Constitution apparaît pourtant comme un moyen de sortir de la crise par une voie constitutionnelle…
L’application de l’article 102 est une vieille revendication d’une partie de l’opposition. Mais c’est un empêchement à quelques semaines du terme du mandat présidentiel. Cela n’a aucun sens juridique et aucun sens constitutionnel. Le président est malade depuis longtemps ? Pourquoi toutes les institutions de l’Etat l’ont-il dans ce cas laisser piétiner la Constitution depuis des années, puis le 11 mars ? Le Conseil constitutionnel n’a pas jugé utile il y a quelques semaines de vérifier la possibilité d’un empêchement. L’état de santé d’Abdelaziz Bouteflika l’autorisait hier à présider le pays mais plus aujourd’hui ?
Les mêmes qui l’ont soutenu expliquent – à l’image du porte-parole du Rassemblement national démocratique (RND) au pouvoir – que des forces anticonstitutionnelles se sont accaparées le pouvoir des années. Sans préciser lesquelles. Une telle déclaration a-t-elle donné lieu à une réaction de M. Gaïd Salah ? A la création d’une commission d’enquête parlementaire ? Sommes-nous dans la Constitution, donc, ou en dehors ? Ils ont maintes fois piétiné et dévitalisé le texte fondamental. Ils cherchent aujourd’hui à l’instrumentaliser sans tenir compte de l’esprit du texte ni du contexte.
Accepter aujourd’hui le 102, c’est se retrouver avec une prorogation du quatrième mandat. Sans Bouteflika mais avec le même régime.
Et si Abdelaziz Bouteflika démissionnait ?
Si le président démissionne, cela crée de fait une situation anormale. La Constitution ne prévoit pas une démission à un mois de la fin d’un mandat. Pas plus qu’elle ne prévoyait l’annulation d’une élection présidentielle. Il n’est pas dans la logique d’une Constitution de prévoir des violations de ladite Constitution !
On cherche délibérément à compliquer la situation pour l’opposition et agiter le spectre de la violence.
Justement, que répondez-vous à ceux qui disent que c’est la moins mauvaise des solutions pour éviter une rupture violente ?
C’est le régime qui a créé une crise institutionnelle qu’il double d’une crise constitutionnelle. Et il y a une différence entre une transition brusque et une transition violente. On joue sur les mots pour agiter le spectre du chaos et de la violence.
Les gens ont une conscience aiguë du danger de la violence. C’est le régime, le haut commandement militaire et Gaïd Salah inclus, qui met en danger le pays pour se sauver.
Il faut que l’armée arrête de se considérer au-dessus de tous et comme la dépositaire de la souveraineté nationale. Le dépositaire de la souveraineté nationale, c’est le peuple. L’armée n’est d’ailleurs pas contestée par la rue en tant qu’institution – l’un des slogans scandés est même « armée et peuple sont frères ».
Il y a dans ce mouvement populaire des gens qui se battent pour un « Etat civil ». Dans le sens où l’armée ne doit plus se mêler de politique alors que le commandement militaire est un pilier du régime. Une transition politique est possible si des propositions consensuelles sont trouvées entre les organisations politiques de l’opposition, les syndicats autonomes, les associations… Il faut ensuite contraindre l’armée à les accepter pacifiquement. Il ne faut pas tomber dans le piège de la violence ou d’un scénario « à la vénézuélienne ».
Mais il ne faut pas s’enfermer non plus dans le débat constitutionnel si on veut créer les conditions d’un changement. On peut sortir du cadre constitutionnel actuel. Car il faut une rupture pour changer le régime. Une rupture pacifique. Dans un tel cas, il n’y aurait pas de vide. La police continuerait de travailler, la justice de travailler, l’armée, les services publics… L’Etat ne va pas s’effondrer du jour au lendemain. Mais l’appareil sécuritaire ne doit pas s’y opposer. Le consensus doit bien entendu l’inclure, mais il doit s’abstenir d’intervenir.
Pensez-vous du coup qu’il faut se donner du temps avant d’engager une transition ?
Le temps est compté pour enclencher un processus de transition. L’horizon idéal serait la date du terme du mandat actuel, le 27 avril. Plus la situation actuelle perdure, plus il y a un risque de dérapages et de provocations malgré la conscience des manifestants.
Il faut faire très attention et préserver cette atmosphère, toute cette ambiance fraternelle qui est née. Car ce n’est pas rien dans le contexte algérien alors que le régime a tout fait, pendant des années, pour installer la méfiance au cœur de la société.