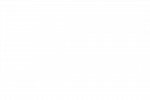Au Bénin, climat de « psychose » chez les militants des droits humains

Au Bénin, climat de « psychose » chez les militants des droits humains
Par Christophe Châtelot (Cotonou, envoyé spécial)
Au moins quatre personnes sont mortes lors des violences post-électorales, selon Amnesty International, qui dénonce une répression aux « proportions inquiétantes ».
A Cotonou en mars 2019, avant les législatives du 28 avril, à l’issue desquelles le parti de Patrice Talon a raflé la totalité des sièges du Parlement béninois. / YANICK FOLLY/AFP
Appelons-le Rodrigue. Le jeune homme, web-militant engagé dans la défense des droits humains, a pris la fuite. Quitté son pays, de peur d’être arrêté par la police, comme des dizaines d’autres l’ont été pour avoir contesté, dans la rue ou sur Internet, l’organisation et le résultat des élections législatives controversées du 28 avril ou dénoncé ce qu’ils considèrent comme une dérive autoritaire du régime de Patrice Talon.
Dès le début de la campagne électorale, Rodrigue a changé ses habitudes. « L’augmentation de la tension dans Cotonou était palpable, raconte-t-il. Des militants, des web-activistes subissaient des pressions. Comme j’étais très actif et connu sur les réseaux, je recevais des commentaires menaçants, du genre : “Ton tour viendra” ou “Quand on viendra te chercher, tu parleras moins”. » Le jeune homme ne dort plus deux soirs de suite au même endroit. « Je ne quittais plus mon sac avec un minimum d’affaires et tous mes papiers, pour décamper si besoin », raconte-t-il au téléphone depuis son lieu d’exil dans un pays frontalier.
« Et puis, dimanche [5 mai], un ami bien informé m’a appelé : ton nom est sur la liste. Je suis parti immédiatement de Cotonou », explique-t-il. Rien ne dit que cette liste de personnes recherchées pour délit d’opinion par la police existe. Ni, le cas échéant, que le nom de Rodrigue y figure bien. Mais que les militants des droits humains y croient dur comme fer traduit leur désarroi. « Il y avait une pratique démocratique depuis trente ans. On n’avait pas peur de critiquer le pouvoir, c’était normal. Aujourd’hui, on ne peut plus parler », dénonce le jeune homme.
Réticence des familles
Les faits lui donnent raison. Dans un communiqué publié mardi 14 mai, Amnesty International, l’une des rares voix audibles actuellement au Bénin pour la défense des libertés fondamentales, a dénoncé une répression aux « proportions inquiétantes ». L’ONG a ainsi documenté la mort de quatre personnes. Aucun bilan officiel n’a été fourni par les autorités béninoises, ni les décès, ni les blessés.
Le nombre de victimes, selon plusieurs sources, est probablement plus lourd de quelques unités que celui argumenté par Amnesty. La constitution des dossiers se heurte en effet aux réticences des familles. « Il y a une psychose généralisée, explique Renaud Agbodjo, avocat de l’ancien président Boni Yayi devenu opposant acharné à Patrice Talon. Les gens se disent que si l’un de leurs parents est mort ou blessé, alors ils sont complices et qu’ils risquent des ennuis judiciaires ou, par exemple, de perdre leur emploi s’ils sont fonctionnaires. » « Nous sommes également sous pression et hésitons à nous saisir des dossiers », confie un autre avocat qui rappelle que le système d’aide juridictionnelle pour les prévenus n’est pas encore opérationnel.
L’opposition, quant à elle, prompte à dénoncer bruyamment l’illégalité de son éviction du nouveau Parlement, n’est pas montée au créneau sur ce sujet. A l’exception d’un appel lancé vendredi pour aller prier dans les églises, mosquées ou temples du pays pour les victimes. Celles-ci se retrouvent donc seules et souvent désemparées face à leur drame et la puissance publique.
« A Cotonou, confirme pourtant Amnesty international, les forces de sécurité ont procédé à des arrestations arbitraires, y compris un blessé grave. » Un homme qui avait eu l’avant-bras arraché par l’explosion d’un projectile lancé par la police ou l’armée, appelée en renfort pour mater les manifestations des 1er et 2 mai, a ainsi été extrait de force du Centre hospitalier universitaire pour être emprisonné quelques jours seulement après son amputation. « C’est d’autant plus inhumain que les conditions de détention et de surpopulation sont terribles dans les prisons béninoises », rappelle Me Agbodjo.
Arsenal juridique
Selon des chiffres obtenus le 13 mai au tribunal de première instance de Cotonou, « une cinquantaine de personnes » ont été mises derrière les barreaux dans les jours qui ont suivi les violences post-électorales, arrêtées généralement sans convocation préalable par la justice, parfois tirées de chez elles au milieu de la nuit ou menottées en pleine lumière au détour d’une rue. « 95 % d’entre elles ont été inculpées », affirme Renaud Agbodjo. « La plupart pour attroupement illicite portant atteinte à la sûreté nationale », précise le parquet. On ignore combien d’arrestations ont eu lieu en province depuis le début de la crise, ni à Cotonou au cours de la semaine écoulée.
L’arsenal juridique au service de cette répression a été renforcé depuis l’élection, en 2016, de Patrice Talon : pénalisation du délit d’« attroupement sans autorisation préalable », de celui d’« appel à la haine » prévu dans un nouveau Code du numérique, loi sur le renseignement qui, au nom de la protection de la sûreté nationale, affranchit la police d’un certain nombre de contraintes légales. « L’opposition dénonce un soi-disant Etat policier, mais elle a voté les lois utilisées aujourd’hui lorsqu’elle siégeait dans le précédent Parlement », souligne la présidence béninoise. La question, semble-t-il, n’est pas tant la nature des textes que leur utilisation discrétionnaire. « Comme par hasard, souligne Me Agbodjo, seulement les opposants ou les activistes de la société civile critiques à l’égard du pouvoir sont poursuivis alors qu’on ne compte plus les appels à la haine dans le camp des supporters du pouvoir. »