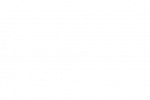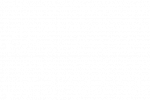En Algérie, la situation politique est dans une impasse totale

En Algérie, la situation politique est dans une impasse totale
Par Madjid Zerrouky
Depuis le 9 juillet, le mandat du chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah, a officiellement expiré. Le face-à-face se durcit entre les manifestants et l’armée.
Manifestation contre le pouvoir à Alger, le 5 juillet 2019, lors du vingtième vendredi de mobilisation. / Ramzi Boudina / REUTERS
Analyse. Un 21e vendredi de protestation contre le régime. Ce 12 juillet, la grande manifestation hebdomadaire des Algériens était aussi la première depuis l’expiration, trois jours plus tôt, du délai d’intérim de quatre-vingt-dix jours à la tête de l’Etat, assuré par le président de la Chambre haute, Abdelkader Bensalah. « Vide constitutionnel, félicitations ! », avaient scandé les étudiants défilant par milliers dans les rues, le 9 juillet, alors que l’Algérie basculait dans l’inconnu. Ils sont encore descendus en masse dans plusieurs villes algériennes ce vendredi.
En vertu de l’article 102 de la Constitution algérienne, le mandat de M. Bensalah est donc arrivé officiellement à son terme. Elu par les deux Assemblées après la démission d’Abdelaziz Bouteflika, il devait assumer l’intérim pendant quatre-vingt-dix jours, le temps d’organiser une élection présidentielle. Laquelle, prévue le 4 juillet, n’a jamais eu lieu, faute de candidats.
Début juin, anticipant le crash institutionnel à venir, le Conseil constitutionnel avait trouvé la parade : la mission du chef de l’Etat intérimaire étant « l’organisation de l’élection présidentielle », il resterait donc en fonction, jusqu’à ce que scrutin s’ensuive. Mais dans les faits, depuis le 9 juillet, la couverture légale des responsables de l’Etat a disparu. Plus de président, un président intérimaire en situation d’illégalité, une autorité publique sans légitimité…
Une agressivité nouvelle
Le gouvernement nommé par l’ancien président quarante-huit heures avant sa démission continue pourtant de faire mine de gouverner. Les quatre mandats d’Abdelaziz Bouteflika – qui avait fait réviser la Constitution pour se maintenir à vie dans ses fonctions – ont depuis longtemps, il est vrai, vidé la Loi fondamentale algérienne de toute substance.
Le pouvoir n’ayant pas attendu ce mois de juillet pour s’adosser à une base constitutionnelle douteuse ou de pure forme, la « voie constitutionnelle » sur laquelle s’arc-boute depuis début avril le chef de l’état-major de l’armée, en exigeant la tenue d’une élection « le plus tôt possible », avait peu de chances d’être audible par la rue.
Confronté à la pression des manifestants, le général Ahmed Gaïd Salah – véritable homme fort du pays depuis la démission de M. Bouteflika – n’aura pas eu « son » président dans les délais qu’il souhaitait, ni selon les normes de légitimation de l’institution militaire, qui dirige le pays depuis 1962.
En découle une agressivité nouvelle. Alors que la répression à l’égard des manifestants s’accentue, le chef d’état-major a réitéré, mercredi 10 juillet, son soutien au président par intérim et mis en garde ceux qui s’opposent à l’armée avec des termes jusqu’ici jamais utilisés. En s’en prenant notamment à l’un des principaux cris de ralliement des marches, l’exigence d’un Etat civil.
« La diabolisation du débat démocratique »
« Des slogans mensongers, aux intentions et objectifs démasqués comme réclamer un Etat civil et non militaire. Ce sont là des idées empoisonnées qui leur ont été dictées par des cercles hostiles à l’Algérie et à ses institutions constitutionnelles », a-t-il asséné. Plutôt que de dépassionner le climat politique, le général Gaïd Salah s’évertue à le tendre.
« Ce genre de discours ne contribue nullement à l’apaisement de la situation, il compromet toute solution ou dialogue, estime Saïd Salhi, vice-président la Ligue algérienne des droits de l’homme. La diabolisation du débat démocratique (…) n’augure en rien une solution démocratique et l’avènement de la nouvelle République démocratique, sociale, pluraliste et civile. »
Le 3 juillet, le chef de l’Etat par intérim avait pourtant dévoilé une nouvelle approche du pouvoir pour régler la crise. Abdelkader Bensalah avait invité la classe politique et la société civile à engager un dialogue et s’était engagé à respecter ce qui en découlerait : des garanties quant à la transparence dans l’organisation d’un futur scrutin ; la composante, le fonctionnement et les moyens alloués à une instance électorale indépendante…
Une « main tendue » qui n’a pas suscité l’adhésion espérée d’une partie de l’opposition, regroupée au sein du Forum national pour le dialogue, réuni près d’Alger le 6 juillet. Ce regroupement de partis et d’associations à dominante nationaliste et islamiste est le courant a priori le plus accommodant de l’opposition. Lui aussi souhaite se diriger vers une élection présidentielle assez rapidement et ouvrir la discussion avec les autorités. Mais en exigeant quelques préalables, comme des mesures d’apaisement et la libération des détenus d’opinion.
Une situation inédite
Depuis un mois, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées et mises en détention, la majorité pour avoir porté un drapeau berbère pendant les manifestations ou pour avoir critiqué le chef d’état-major comme l’ancien moudjahid (combattant de la guerre d’indépendance) Lakhdar Bouregaâ, incarcéré à 86 ans pour « outrage à corps constitué et atteinte au moral de l’armée ».
En optant pour une gestion sécuritaire du mouvement après avoir échoué à imposer son agenda politique, le chef d’état-major personnifie aujourd’hui aux yeux des manifestants le système qu’ils veulent mettre à bas. Pire, il apparaît à l’opposition comme celui qui cherche à faire perdurer la crise. Il se retrouve ainsi en première ligne. Une situation inédite en Algérie.
En balayant la vitrine politique du régime, son vieux président, ses partis dits majoritaires comme le FLN, sa centrale syndicale ou son Parlement, le soulèvement populaire a réduit un pouvoir qui jusqu’ici marchait sur deux jambes à sa seule expression brute : l’armée.
Depuis l’indépendance, le système algérien s’est historiquement appuyé sur son appareil sécuritaire pour réprimer toute expression autonome de la population, mais en déléguant à une façade civile la redistribution de la rente et le fonctionnement de l’Etat ou la définition d’un projet de société. Aujourd’hui, à travers le général Gaïd Salah, l’état-major de l’armée cumule toutes les fonctions. Privé de sa capacité à se relégitimer, tout en refusant pour l’instant une solution politique, le régime semble en revenir à une gestion purement sécuritaire des événements. Une impasse et un saut périlleux dans l’inconnu.