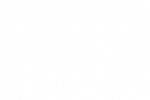La fin du déni sur l’Algérie dans les musées français

La fin du déni sur l’Algérie dans les musées français
Par Roxana Azimi
Les expositions consacrées à l’histoire coloniale se multiplient, signe que le temps commence à faire son œuvre sur un sujet qui demeure inflammable.
Lorsque Françoise Cohen prend en 2018 les rênes de l’antenne de l’Institut du monde arabe à Tourcoing, elle n’a aucun doute : cette institution, qui peine à s’ancrer en territoire chti, doit s’adresser à l’importante communauté algérienne locale. « Une évidence », confie-t-elle. C’est ainsi que naît l’exposition « Photographier l’Algérie », qui s’est achevée le 13 juillet. L’idée n’étant pas de dresser une histoire de l’Algérie par la photographie, mais de convoquer des regards différents sur ce pays.
Au hasard du calendrier, quelques mois plus tôt, la Piscine, à Roubaix, proposait un « printemps algérien » avec une rétrospective sur l’œuvre du peintre orientaliste Gustave Guillaumet, « L’Algérie de Gustave Guillaumet », témoignage implacable des débuts de la colonisation, et une galerie de portraits de l’émir Abd Al-Kader, figure mythique de la résistance anticoloniale au XIXe siècle.
Lors d’une exposition de l’antenne de l’Institut du monde arabe à Tourcoing en novembre 2018. / FRANCOIS LO PRESTI / AFP
Rien d’opportuniste dans cette conjonction d’événements nordistes programmés bien avant que ne surgisse, en février, le soulèvement anti-Bouteflika. Plutôt le signe d’un intérêt croissant des musées hexagonaux pour l’histoire coloniale de la France en Algérie, après quarante ans de dénégation et de silence.
Sur les doigts d’une main
Cette prise de conscience remonte à 2003 avec les célébrations de l’année de l’Algérie en France. En 2004, l’année où trente historiens français et algériens ont collaboré à l’ouvrage La Fin de l’amnésie, l’historien Benjamin Stora et l’écrivain Laurent Gervereau orchestraient l’exposition « Photographier la guerre d’Algérie » à l’Hôtel de Sully, à Paris. Malgré la présence d’images inédites, les lacunes furent nombreuses, notamment sur le quotidien des pieds-noirs ou les fractures violentes au sein du nationalisme algérien.
L’émir Abd Al-Kader (1808-1883), à Damas en 1852. / AFP
Un tournant s’est opéré en 2012 avec « Algérie 1830-1962 » au Musée de l’armée, aux Invalides, récit dépassionné de la présence militaire française en Algérie, de la conquête à l’indépendance, qui n’élude aucune atrocité commise d’un côté comme de l’autre. « On n’est pas allé jusqu’à montrer une baignoire ou une gégène, mais il était hors de question de ne pas parler de la violence des actions de l’armée française », précise le lieutenant-colonel Christophe Bertrand, commissaire de l’exposition. Autre moment clé, l’exposition « Made in Algeria », en 2016 au Mucem, à Marseille, illustration implacable mais non aride de l’usage de la cartographie dans l’expansion française en Algérie.
Ce rattrapage est allé de pair avec l’émergence, dans les années 2000, en France, d’artistes d’origine algérienne comme Adel Abdessemed, Zineb Sedira ou Kader Attia. Jusqu’alors, les acquisitions d’œuvres d’artistes algériens se comptaient sur les doigts d’une main. Le Musée d’art moderne de la ville de Paris avait ainsi acheté en 1964 et en 1969 deux gravures d’Abdallah Benanteur. Après, rien ou presque. Même constat au Centre Pompidou, qui n’a acquis dans les années 1980 que deux artistes algériens, Hamid Tibouchi et Salim Le Kouaghet. Ce black out, explique toutefois Alice Planel, spécialiste de la diaspora artistique algérienne, est d’ordre plus esthétique que politique. « Les artistes des années 1950-1960 étaient intéressés par l’art informel et travaillaient dans une forme de peinture qui leur semblait radicale, mais dont les Français n’avaient plus envie », explique-t-elle. Aujourd’hui, le monde de l’art n’hésite plus à embrasser les questions post-coloniales soulevées par la diaspora artistique algérienne.
« Sans rien taire des fureurs »
Le temps a-t-il fait son œuvre ? Probablement. Au Musée de l’armée, les chefs militaires qui avaient fait la guerre ont été remplacés par d’autres qui ne l’ont vécue que par procuration. Les témoins vieillissants ont fait place à de jeunes historiens qui n’ont pas de comptes à régler ni de partition idéologique à défendre. « Les jeunes chercheurs ne s’encombrent pas du passé, admet Benjamin Stora. Ils ne sont pas nés en Algérie, ils n’ont pas de lien physique. C’est plus léger à vivre. » « On peut raconter l’histoire plus calmement, factuellement », renchérit Hélène Orain, directrice du Musée de l’histoire de l’immigration qui veille à « dépassionner les sujets sans rien taire des fureurs ».
Des suspects algériens sont arrêtés peu après l'explosion d'une bombe dans une rue de Constantine, le 24 août 1955, durant la guerre d'Algérie. / AFP
Malgré ces avancées, la mémoire reste éclatée, le sujet inflammable. Au point qu’à peine élu maire de Montpellier en 2014, Philippe Saurel a illico enterré le projet pourtant avancé du Musée de l’histoire de la France et de l’Algérie. Crainte de se trouver sous les feux croisés des pieds-noirs et de la communauté algérienne qui ont pris souche dans la ville ? Sans doute. Pour déminer le sujet, Florence Hudowicz, conservatrice de la collection, avait pourtant proposé de concevoir, non pas un parcours permanent à haut risque, mais des expositions temporaires. En vain. Un centre d’art contemporain, le Moco, a été créé en lieu et place et la collection de 1 100 objets a rejoint le Mucem. Qui a opportunément choisi de ne pas les mettre au placard.
Depuis quatre ans, le musée phocéen s’est attaché à « faire parler » ce fonds lors de séances baptisées « La voix des objets », accueillant à chaque fois une centaine d’auditeurs. « Ce sont des moments très émouvants de partage d’émotion, une forme de catharsis, observe Florence Hudowicz. A minima, c’est une prise en charge de la parole dans un lieu policé, le musée, où les gens se respectent et se parlent sans se déchirer. » « Cela apporte de la sérénité au débat, conforte Jean-François Chougnet, patron du Mucem. L’objet nous ramène au réel, on ne peut pas raconter n’importe quoi face à lui. »
« Chaque mot brûle »
Mais de tels objets capables de faire consensus sont rares. D’autant que, comme le souligne Benjamin Stora, « l’histoire visuelle coloniale est inégalitaire, les Algériens n’ont pas produit autant d’images que les colons ». L’exposition de Tourcoing ne présentait ainsi qu’un seul photographe algérien, le pionnier Mohamed Kouaci. Le musée avait toutefois lancé un appel à témoignages pour faire remonter des images que détiennent les familles algériennes installées de longue date dans le Nord, pour les besoins d’un documentaire diffusé pendant l’exposition. Seules une quinzaine de personnes se sont prêtées au jeu.
« Ce n’était pas évident d’établir un lien de confiance, de les faire parler hors du cercle familial », se souvient Françoise Cohen. Les plaies sont partout encore vives. Immigrés algériens, pieds-noirs, chibanis, harkis, tous ont un sentiment de trahison et d’abandon. Aussi la rédaction des cartels accrochés dans les expositions dédiées à l’Algérie se révèle-t-elle toujours périlleuse. « Chaque mot brûle, admet Florence Hudowicz. Il faut toujours avoir en tête une justesse et une justice, une vue surplombante pour que les textes soient lus par tout le monde et que personne ne se cabre, tout en évitant de surjouer la réparation. »
Photographie datée du 10 novembre 1954 prise dans les rues d’Oran lors de la fête du Mouloud, qui célèbre la naissance du prophète Mahomet. / AFP
Pas simple non plus de mobiliser des historiens algériens pour des projets bilatéraux. « On a voulu s’appuyer sur des historiens algériens en 2012, mais c’était compliqué pour des raisons politiques », avance Christophe Bertrand. L’exposition « Made in Algeria » n’a pas non plus été reprise en Algérie. Malgré le lent travail de mémoire de part et d’autre, les comptes ne sont pas soldés. Pour Benjamin Stora, « il faut continuer le travail, en sachant qu’on ne va pas régler cette histoire compliquée par une seule grande exposition, mais par une multitude d’événements. »