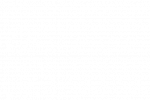Abattoirs : « La protection animale doit devenir aussi importante que l’hygiène »
Abattoirs : « La protection animale doit devenir aussi importante que l’hygiène »
Propos recueillis par Perrine Mouterde
Après la révélation de maltraitance animale, Laurent Lasne, président du Syndicat des inspecteurs en santé publique vétérinaire, reconnaît une « faille » des services.
Vigan : "on a encore du mal à faire le lien entre les vidéos chocs et le steak dans notre assiette"
Durée : 05:00
Après la révélation de nouveaux cas de maltraitance animale, le doute, sinon l’opprobre, est jeté sur les 263 abattoirs que compte la France. D’autant que le cas de l’abattoir intercommunal de Soule à Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques), théâtre de scènes filmées par l’association L214, intervient après ceux d’Alès et du Vigan (Gard).
Pour faire la lumière sur ces pratiques, le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, a ordonné des inspections spécifiques sur la protection animale dans l’ensemble des abattoirs de boucherie. En France, un peu plus d’un millier d’agents travaillent à l’inspection de ces établissements. Laurent Lasne, président du Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire (SNISPV), reconnaît une « faille » des services.
Comment sont inspectés les abattoirs français ?
Laurent Lasne : Le service d’inspection des abattoirs a trois objectifs. D’abord, repérer les maladies contagieuses qui n’ont pas été détectées en élevage avant la mise à mort ; ensuite, assurer la sécurité du consommateur en contrôlant la qualité de la viande qui est mise sur le marché ; enfin, s’assurer du respect des bonnes pratiques en matière de protection animale.
Au quotidien, les équipes techniques, sous l’autorité d’un vétérinaire inspecteur, ont donc plusieurs missions. La première consiste à voir tous les animaux vivants avant leur abattage. Cela ne prend pas forcément beaucoup de temps : les animaux sont regroupés, l’agent les voit tous en même temps et repère si certains sont souffrants. C’est l’inspection ante mortem. L’inspection post mortem est, elle, très consommatrice en effectifs : les techniciens examinent chaque carcasse et chaque organe pour repérer tout signe anormal.
Ces deux missions sont obligatoires. Le reste du travail consiste, de façon aléatoire, à inspecter l’hygiène générale de l’établissement, la façon dont sont triés les déchets, et à aller voir ce qui se passe au niveau de l’étourdissement et de la saignée.
Le contrôle relatif à la protection animale n’est donc pas systématique ?
Il n’y a pas de fréquence déterminée. En moyenne, les inspecteurs contrôlent entre une fois par semaine et une fois par mois la façon dont l’abattage se déroule. Il y a une concurrence entre les missions : les inspecteurs n’ont pas de marge de manœuvre sur les deux premières, donc le temps restant est utilisé pour les autres. La mission de contrôle du respect de la protection animale peut être une variable d’ajustement.
Les cas de cruauté envers les animaux comme à Soule sont-ils rares ?
Ils sont difficiles à quantifier mais oui, ils restent exceptionnels. Les images diffusées par l’association L214 sont réelles mais pas représentatives de ce qui se passe tous les jours dans les abattoirs. Elle ne garde que le pire de ce qu’elle filme pour servir son propos, qui est de décourager les gens de manger de la viande.
Comment expliquer cette défaillance des services d’inspection ?
Il y a eu une faille des services d’inspection, mais le problème se trouve d’abord du côté de l’entreprise d’abattage, qui n’a pas appliqué les bonnes pratiques [selon la réglementation, l’animal ne doit être mis à mort qu’après étourdissement]. Pourquoi ne l’a-t-elle pas fait ? Sans doute en raison d’impératifs de rentabilité économique. Quand on augmente la cadence, on travaille moins bien. Cet établissement a probablement été débordé par un afflux de commandes conjoncturel avant Pâques.
Il y a aussi un aspect sociologique, lié à la formation des ouvriers d’abattoirs. Ils ont longtemps été recrutés sur leurs capacités physiques à porter des charges lourdes, à supporter le froid, des conditions difficiles… Leur sensibilité à la protection animale n’est pas le premier critère de recrutement. L’été, avec le pic de commandes lié aux barbecues, les entreprises recrutent des intérimaires, dont des étrangers qui parfois ne maîtrisent pas très bien le français. La première préoccupation de l’employeur, c’est de les former pour qu’ils soient productifs, pas de les former à la protection animale.
Est-ce que cette situation évolue ?
Oui, mais lentement. En vingt ou trente ans, on a constaté une véritable révolution culturelle au niveau de l’hygiène. Les abattoirs en ont fait une priorité, ils ont compris que c’était un impératif pour vendre leurs produits. Cette révolution n’est pas totalement accomplie concernant le bien-être animal, même si la médiatisation de cette question, grâce au travail des associations, peut permettre une prise de conscience des acteurs du secteur.
Aujourd’hui, il faut que la protection animale devienne pour les abattoirs un enjeu aussi important que les conditions sanitaires, mais aussi que les conditions de travail de l’ouvrier. On ne peut pas demander à un ouvrier de dépasser la durée légale du travail, de travailler douze heures d’affilée pour faire face à un afflux de commandes, et exiger qu’il respecte les règles de protection animale.
L’abattoir de Soule a des certifications « Bio » et « Label rouge ». Ce ne sont pas des garanties supplémentaires ?
En théorie, si. La protection animale est inscrite dans leur cahier des charges. Mais les entreprises qui délivrent ces certifications sont encore moins présentes que les services vétérinaires dans les abattoirs.
Quelles sont les pistes pour améliorer l’inspection ?
La première, c’est la mise en place de caméras au niveau des postes de saignée dans tous les abattoirs. Les images pourraient être visionnées en différé par les services vétérinaires et permettraient de mettre le doigt sur certaines pratiques. C’est une hypothèse qui a été formulée par la direction générale de l’alimentation. Mais cette solution nécessiterait des effectifs pour analyser les images et soulèverait sans doute des questions concernant le droit du travail.
La seconde, que nous défendons, est la mise en œuvre de comités d’éthique dans les abattoirs. Jusqu’à présent, ces entreprises étaient un peu des boîtes noires. Elles ne sont pas glamour, se trouvent en province, dans les périphéries des sous-préfectures… Les seuls qui y vont, ce sont les services vétérinaires. On pourrait imaginer des comités incluant des représentants des éleveurs, des bouchers, d’associations de défense des animaux, des mairies, de la société civile… Cela permettrait aux abattoirs d’avoir un œil extérieur, de se rendre compte des questions et des attentes de l’opinion. Ce type de comités d’éthique existe déjà dans les laboratoires qui pratiquent des expériences sur les animaux, dans le secteur de la recherche biomédicale humaine, etc.
Le ministre de l’agriculture a annoncé des inspections spécifiques dans tous les abattoirs. Est-ce que cela sera efficace ?
Une vingtaine d’agents vont passer chacun un ou deux jours dans une dizaine d’abattoirs. C’est bien, mais ils n’y seront pas avant les fêtes de Pâques ou lorsqu’il y a des bataillons d’intérimaires. L’inspection est un travail du quotidien, qui nécessite des moyens. Or les effectifs des services vétérinaires ont diminué de 20 % en dix ans.