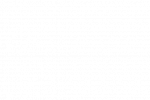Syrie : le terrible jeu de dupes des grandes puissances à l’ONU

Syrie : le terrible jeu de dupes des grandes puissances à l’ONU
Editorial. On n’attendait pas grand-chose des conversations sur la Syrie à l’occasion de la réunion d’automne de l’Assemblée générale de l’ONU. On a été servi au-delà de toute espérance.
Sergey Lavrov, le ministre russe des affaires étrangères, lors du Conseil de sécurité de l’ONU du 21 septembre portant sur la situation en Syrie. | TIMOTHY A. CLARY / AFP
Editorial. Des sources crédibles font état de près de 500 000 morts. Le nombre de blessés dépasse les 2 millions. Sur les 22 millions de Syriens, pas moins de la moitié sont considérés comme des « personnes déplacées », à l’intérieur ou à l’étranger. Des villes de plus de 100 000 habitants ont été rasées dans les bombardements. Le flot des malheureux qui fuient les combats autour de la deuxième agglomération du pays, Alep, ne tarit pas.
Les images sont cauchemardesques : celles de parents, nouveau-nés dans les bras, émergeant des décombres des dernières frappes aériennes. Les camps de réfugiés aux frontières débordent, en Jordanie comme en Turquie : la machine à fabriquer les djihadistes de demain tourne à plein.
On s’épargnera les adjectifs censés provoquer l’indignation ou le désespoir. Ils ne servent à rien. Cinq ans déjà que la Syrie est dans la guerre. Elle y reste. Des tonnes de bombes, de barils d’explosifs lestés de clous, d’obus chargés au chlore vont continuer à tomber sur des villes assiégées – tuant, aveuglant, mutilant, arrachant la peau, les yeux, la vie. On n’attendait pas grand-chose des conversations sur la Syrie à l’occasion de la réunion d’automne de l’Assemblée générale de l’ONU. On a été servi au-delà de toute espérance.
Régression
Américains et Russes, qui « parrainent » ces pourparlers, ont constaté l’échec du cessez-le-feu qu’ils avaient conclu le 9 septembre. Il a tenu moins de dix jours. Un précédent arrêt des combats négocié en février avait duré près de deux mois. On régresse.
Américains et Russes s’invectivent sur la responsabilité des uns et des autres dans la reprise des combats. Les premiers prétendaient avoir assez d’influence sur le Qatar, l’Arabie saoudite, voire la Turquie, pour qu’ils cessent d’appuyer et isolent les factions djihadistes au sein de la rébellion syrienne. Il n’est pas sûr que Washington s’en donne vraiment les moyens.
Les Russes, eux, devenus le bras armé aérien du régime de Bachar Al-Assad, qu’appuie au sol une immense soldatesque de mercenaires iraniens, libanais, irakiens et afghans, promettent de faire pression sur Damas. Hypocrisie : les Russes ne peuvent pas ignorer que la « stratégie » de Bachar Al-Assad est de reconquérir l’ensemble du pays par la guerre – quitte à créer des générations de djihadistes dans une partie de la population, ce qui est le cadet des soucis de Damas.
Les guerres syriennes ne se réduisent pas à un affrontement binaire entre, d’un côté, Damas, et, de l’autre, les formations djihadistes. Elles sont multiples. L’Iran veut garder et conforter son point d’appui dans le monde arabe qu’est la Syrie. Le Hezbollah libanais veut rester en Syrie, lui aussi, pour développer au besoin un deuxième front contre Israël. Les milices afghanes et irakiennes, chiites, obéissent à Téhéran. La Turquie, maintenant présente sur le terrain, combat les Kurdes. Saoudiens et Qataris entendent, par rébellions islamistes interposées, contenir la poussée de l’Iran au Machrek. Esprits simples et clairs, bienvenue au Moyen-Orient.
L’appel de Hollande sur la Syrie à l’ONU : « Ça suffit ! »
Durée : 01:04
L’action combinée des Etats-Unis et de la Russie reste l’unique chemin pour arriver à un arrêt des combats en Syrie, avant d’envisager un front commun contre les djihadistes. Mais il faut que Moscou et Washington affrontent au préalable, l’un et l’autre, leurs protégés locaux, pour les forcer à respecter un cessez-le-feu. Il en va de leur crédibilité dans cette affaire. Et de la vie des Syriens.