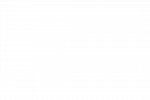En Ethiopie, dernier train français pour le désert, avant l’arrivée des convois chinois

En Ethiopie, dernier train français pour le désert, avant l’arrivée des convois chinois
Par Emilienne Malfatto, Emeline Wuilbercq
Les 781 km de ligne, construits au siècle dernier, relient Addis-Abeba au petit poste de Galilée, à la frontière de Djibouti. Pour combien de temps encore ?
Elles sont mortes depuis longtemps. Mangées de poussière et d’herbes folles, après avoir parcouru des centaines de milliers de kilomètres. A la gare de Dire Dawa, dans l’est de l’Ethiopie, les locomotives ne sont plus que des fantômes et Kadra use de synonymes pour exprimer son spleen. « Tristesse, mélancolie, nostalgie… Pauvres cheminots ! »
La quarantaine charpentée, les cheveux retenus dans un foulard lilas, l’Ethiopienne fait visiter la gare. En français. Ici, c’est la langue officielle. Les vieux cheminots en bleu de travail se fendent d’un « bonjour Mesdemoiselles » cérémonieux, généralement suivi d’éloges sur « la France », avec le « r » joliment roulé. Puis viennent les reproches. « Pourquoi vous nous avez abandonnés ? Vous êtes partis comme des voleurs. »
Savon de Marseille et pétanque
L’ancienne ligne reliant Addis-Abeba à Djibouti, 781 km qui courent des hauts plateaux à la mer Rouge, a été construite par les Français entre 1897 et 1917, sous le règne de l’empereur Ménélik II.
Il y a quelques mois, Abdoulaziz Ahmed Houssein, représentant du directeur général du Chemin de fer, a envoyé « une lettre » à l’ambassade de France à Addis-Abeba. Pour demander un soutien, des pièces détachées, quelque chose. Il n’a pas reçu de réponse. Paris, qui vend des Airbus à l’Ethiopie – le premier de douze A350 commandés en 2009 a été livré cet été – a perdu tout intérêt pour ce tortillard, certes romantique, mais franchement dépassé.
Le chemin de fer, autrefois l’une des principales entreprises éthiopiennes, ne gagne plus d’argent depuis des années. Privé de subventions gouvernementales, il survit grâce au loyer des « logements des cheminots » – plus de 250 à Dire Dawa, selon le directeur. Et un peu grâce aux recettes engrangées avec les billets : 155 birrs le trajet, soit 6 euros pour le tronçon qui subsiste de 207 km entre Dire Dawa et Galilée, à la frontière avec Djibouti, et que les convois parcourent deux fois par semaine. « Le train a la capacité de continuer encore trente, cinquante ans », veut croire M. Houssein. Dans son bureau à deux pas de la gare il a accroché au mur, de travers, un vieux cliché du chemin de fer. Lui aussi est mélancolique.
« Tout Dire Dawa est triste à cause du train. » Assis à une table de l’Alliance française, qu’il dirige, « Monsieur Joseph » se rappelle le temps des dancings, de l’eau de Cologne et du savon de Marseille. Le temps du train. La ville s’est développée avec lui au début du siècle dernier. Les maisons des cheminots ? « Longtemps, on pensait qu’elles étaient réservées aux Blancs », glisse Monsieur Joseph. L’« hôpital du chemin de fer » s’appelle encore Faransaï Hopital, « l’hôpital français ».
« Ça marche au pifomètre »
Mais l’Hexagone a filé à l’anglaise. Dès 1959, Paris et Addis-Abeba se partagent la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien (CFE). Puis, en 1977, à l’indépendance de Djibouti, la France se retire pour céder ses parts à son ancienne colonie. La CFE sera rebaptisée Compagnie du chemin de fer djibouto-éthiopien en 1981. Le train est alors déjà détérioré par les années, les conflits et une certaine désaffection des pouvoirs publics.
Aujourd’hui, Dire Dawa n’est plus qu’une grosse bourgade qui vit de souvenirs. Dans le quartier qui va de l’Alliance française à la gare, les cafés sont peuplés de messieurs chenus et dignes, casquette sur la tête, le pli marqué au pantalon poussiéreux. Des personnages qui ne dépareraient pas aux terrasses de Marseille, surtout quand ils jouent à la pétanque, un autre legs français.
A 73 ans, dont trente-deux passés sur les rails, Monsieur Joseph a le verbe sarcastique. Si le train roule encore sur une partie de la ligne, « ça marche au pifomètre ». Il ne lui donne pas un an, « même pas six mois » quand le nouveau train circulera. Inauguré le 5 octobre, le train chinois, comme disent les cheminots en grimaçant, ne sera opérationnel qu’après la période d’essai, début 2017.
Un projet à 3,4 milliards de dollars (3 milliards d’euros). Mais il faut compter en yuan, car c’est une pièce de plus au puzzle de la Chinafrique, une perle supplémentaire au collier que Pékin enfile en acquérant des points d’appui le long de ses voies commerciales.
A bord du nouveau train qui relie Addis-Abeba à Djibouti
Durée : 02:15
« Le français » roule au diesel, « le chinois » sera électrique. L’ancien ne dépasse plus 40 km/h, le nouveau roulera à 120 km/h avec des convois de 3 500 tonnes de marchandises. « Le chinois » désenclavera l’Ethiopie, sans accès à la mer, et dont 90 % des importations passent par Djibouti. Qui en retour accédera plus largement au marché immense et émergent que constituent les 94 millions d’Ethiopiens. Les deux pays, en pleine intégration économique, doivent pour l’instant se contenter d’une route en très mauvais état.
« Les Chinois n’aiment pas les ouvriers »
Mais ici, le train chinois, on le regarde de travers. « C’est de la terre », insulte ultime en Ethiopie. « Les Chinois n’aiment pas les ouvriers », lâche un vieil homme en bleu de travail. Les Asiatiques sont-ils seulement conscients du savoir-faire de ces hommes chevronnés, traités comme de simples manœuvres ?
Cette nuit-là, à la gare, on charge les sacs de maïs, de blé ou de khat. Les marchandes somalies drapées dans leurs voiles colorés sortent de l’ombre comme des fantômes et se hissent dans les sept wagons du convoi. A l’intérieur, la nuit est plus noire encore pour les 300 passagers : il y a longtemps que l’éclairage électrique a disparu, saboté, dit-on, par les contrebandiers qui planquaient la marchandise dans les fauteuils, le plafond, les essieux, avant de se détourner, eux aussi du vieux train français.
La ligne de 781 km qui relie la capitale éthiopienne à Djibouti circule à 40 km/h. | Emilienne Malfatto
Les marchandes s’étalent sur les banquettes, leurs sacs en oreiller ou en repose-pieds. Habituées du train, elles y font un peu la loi, la loi du pousse-toi-de-là-que-je-m’y-mette. Elles roupillent. Parlent fort. Café du commerce, version ferraille.
Le wagon-bar est juste là, d’ailleurs. Un jeune homme en marcel vend des sodas flashy. L’eau, c’est seulement pour le khat, qui s’arrose une fois par heure. Ses petites feuilles au goût amer se consomment fraîches, car elles sont périssables. Les Kényans, les Djiboutiens, les Yéménites sont de gros consommateurs des feuilles de cet arbuste aux propriétés psychotropes.
Dehors, le jour se lève. Les épines acérées des acacias griffent les wagons. Une secousse. C’est encore un passager qui a tiré la sonnette d’alarme pour descendre où ça l’arrange. Personne ne se plaint. Ça permet de se dégourdir les jambes. De soulager les vessies pleines de limonade. Et de voir de plus près antilopes et dromadaires.
C’est un train d’aventures. Jadis, « on chantait, on dansait, on buvait du tedj », l’hydromel local, se rappelle un ancien cheminot. Des voyageurs s’entassaient sur le toit, il y avait des wagons pleins d’expatriés : « des Italiens, des Grecs, des Libanais, des Français. » Aujourd’hui, l’aventure est ailleurs. L’Ethiopie, après la terrible famine de 1984, a connu l’une des plus fortes croissances économiques du continent en attirant les investisseurs étrangers et en ouvrant des usines où la main-d’œuvre est jusqu’à dix fois meilleur marché qu’en Chine. Mais le miracle est fragile : des tensions ethniques ont récemment refait surface, rappelant que le pouvoir – qui ne se partage pas – est exercé par une minorité de Tigréens sur une majorité d’Oromos et d’Amharas. L’état d’urgence a été décrété, dimanche 9 octobre, pour une durée de six mois, après une semaine de violences dans la région Oromia.
« On a oublié un flic ! »
Un arrêt plus long. La pause déjeuner. Des gamins et des femmes proposent de la nourriture dans des sachets en plastique. On repart les doigts poisseux de riz ou d’injera, cette galette de teff que les Ethiopiens mangent, littéralement, à toutes les sauces. Le train s’arrête au bout de quelques centaines de mètres. Marche arrière. « On a oublié un flic ! », expliquent, goguenards, des passagers.
Il y en a quatre, dans le train, en treillis bleu nuit et kalachnikov. Plutôt débonnaires, les policiers sont là pour que tout se passe bien. Et, en vérité, tout se passe bien. Même les pillards, qui attaquaient autrefois les convois, ont perdu leur intérêt pour ce tortillard. Et la guerre de l’Ogaden, qui a fait rage dans ces contrées désertes entre l’Ethiopie et la Somalie dans les années 1970, est loin. « On en avait une peur inouïe », se rappelle Monsieur Joseph. Les bombes, les ponts qui sautent… « On en a eu, des morts. »
Le train traverse des villages perdus dont les habitants s’agglutinent près des rails. De lourds ballots posés à leur côté, d’anciens sacs d’aide humanitaire sur lesquels s’effacent les sigles des agences onusiennes. Les voiles des femmes font des taches de couleur sur le paysage sable, monochrome. Ces petites localités n’existaient pas il y a cent ans, elles sont nées grâce au train. Lui survivront-elles ? Le train chinois, lui, ne s’y arrêtera pas.
Les voyageurs arrêtent le train à l’endroit où ça les arrange en tirant sur le frein d’urgence, ce qui donne l’occasion à d’autres voyageurs de s’engouffrer dans les wagons. | Emilienne Malfatto
Ça repart. Les heures s’étirent. Tout le khat est brouté. A force d’avoir somnolé, les passagers n’ont plus sommeil. Il faut tuer le temps, le terminus est encore loin. Une marchande volumineuse compte sa liasse de billets verts qui sentent les épices. Ça parle argent, combien donner aux douaniers postés à la frontière.
Au loin, on aperçoit les rails du train chinois. Il suit un tracé parallèle. Va-t-il tuer le tortillard français ? Pour l’heure, le voilà arrivé au bout de sa ligne, à Galilée, petit poste frontière planté entre des collines rocailleuses. Ce n’est qu’une brève halte, le train fait demi-tour et va dormir à Dewelé, à quelques kilomètres. Certains passagers passeront la nuit avec lui, sur ses banquettes de bois dur. Il n’y a de toute façon pas d’hôtel à Dewelé. Au petit matin, les wagons disparaîtront et les habitants se réapproprieront les rails. Car c’est là que bat le cœur de ce hameau minuscule, où l’on boit le café et l’on échange les derniers ragots, entre les deux lignes de métal qui disparaîtront sans doute sous le sable lorsque passeront, à toute vitesse, les convois chinois.