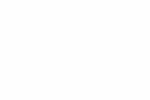« La littérature africaine s’ouvre au monde, parle au monde en étant ancrée dans le continent »

« La littérature africaine s’ouvre au monde, parle au monde en étant ancrée dans le continent »
Propos recueillis par Séverine Kodjo-Grandvaux (contributrice Le Monde Afrique, Douala)
Le critique congolais Boniface Mongo-Mboussa, programmateur du pavillon africain au Salon du livre de Genève, dresse un panorama des lettres francophones et anglophones.
Pendant cinq jours, du mercredi 26 au dimanche 30 avril, le Salon du livre et de la presse de Genève proposera pour sa 31e édition plus de deux mille animations réparties sur les différentes scènes de ce rendez-vous littéraire international.
Parmi celles-ci, le Salon africain qui remettra, vendredi, le prix Kourouma, dont Le Monde Afrique est partenaire. Grâce au travail méticuleux et passionné de la romancière suisse Pascale Kramer et du critique congolais Boniface Mongo-Mboussa, diverses rencontres seront proposées avec des romanciers, des essayistes, des poètes, des auteurs jeunesse du continent, mais aussi de Haïti et d’Europe sur le thème « Mélancolique Afrique », aux antipodes des clichés habituels.
Expliquez-nous ce thème de la mélancolie ?
Boniface Mongo-Mboussa J’ai été marqué par un essai de Bernard Mouralis, L’Europe, l’Afrique et la folie, publié en 1993 [chez Présence africaine], dans lequel il revient sur la manière dont l’Afrique est vue par les écrivains occidentaux. Dans leurs romans, l’Afrique est rayonnante, festive. En parallèle, Bernard Mouralis analyse la relation à la mélancolie d’écrivains tels que Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran Damas et Frantz Fanon. Ce livre n’est pas assez connu. On pense souvent que la mélancolie n’est pas le propre de l’Africain, alors que c’est le propre de l’homme, comme l’a démontré Aristote. Mon hypothèse, c’est que ce rire excessif de l’Afrique dont on parle toujours n’est peut-être que l’autre face de la mélancolie.
Alain Mabanckou au Collège de France, Leïla Slimani prix Goncourt, Gaël Faye Goncourt des lycéens… 2016 a été une année faste pour la littérature africaine en France. Assiste-t-on à la fin de la distinction discriminante entre littérature française et francophone ?
Vous êtes optimiste, mais il faut savoir raison garder. L’arrivée d’Alain Mabanckou au Collège de France a été un événement majeur. Mais j’ai bien peur que l’enthousiasme ne retombe. Attendons de voir ce qui va se passer ces dix prochaines années. Il y a déjà eu des cycles comme celui-là où l’on a eu l’impression que les auteurs africains étaient pleinement intégrés au paysage littéraire français : Tierno Monénembo et Williams Sassine étaient accueillis par Bernard Pivot à « Apostrophes » en 1979 et on s’est exclamé que la littérature africaine était enfin reconnue. Mais rien n’a véritablement changé. En France, on a toujours l’impression que les francophones, c’est les autres. Ce problème ne se pose pas seulement à l’Afrique. Le Suisse Charles Ferdinand Ramuz, aujourd’hui publié dans la collection « La Pléiade », a eu énormément de mal à intégrer le monde littéraire français.
Que faire alors ?
Si l’on veut que la réception de la littérature africaine change en France, il faut que la situation change sur le continent. C’est lorsqu’il y aura un marché africain du livre, avec une vie littéraire, des éditeurs, des rencontres… que les auteurs africains seront reconnus à leur juste valeur à l’extérieur. C’est ce qui s’est passé en Amérique latine.
Conserver des collections africaines a-t-il encore un sens ?
Les collections spécifiques permettent, hélas, à l’Afrique d’exister. Le continent se demande peu si ses auteurs sont vendeurs. Pourtant, cette question commerciale est cruciale. Qu’est-ce qui fait que les livres africains n’arrivent pas à circuler comme biens matériels ? Même les grands auteurs africains ont du mal à figurer parmi les meilleures ventes. Les prix remportés par les Africains ne sont pas des succès de librairie. Gaël Faye est une exception. Mais, paradoxalement, c’est un auteur français. Il est venu du monde de la musique et était déjà connu avant de publier. C’est aussi un métis. Pour toutes ces raisons, il appartient à l’univers français. C’est un cas à méditer.
Comment se porte la littérature africaine de langue française ?
Quand on fait le bilan des indépendances, le seul élément de fierté que nous puissions avoir, c’est notre littérature. Dans les années 1930-1940, l’Africain était encore l’objet de discours produits exclusivement par les autres. Depuis, il s’est approprié le discours sur lui-même. On peut marcher la tête haute. Pendant longtemps, on a dit qu’il s’agissait d’une littérature engagée parce que, et il faut bien le reconnaître, c’est le seul discours audible, critique, dans l’espace intellectuel. Si les intellectuels jouaient leur rôle critique, les écrivains ne seraient pas contraints d’avoir un discours politique. Mais, depuis quelque temps, une littérature intimiste, avec Bessora par exemple, est de plus en plus présente. On assiste à l’arrivée assez importante des femmes dans l’espace littéraire. Et c’est une littérature qui s’ouvre au monde, parle au monde, tout en étant ancrée dans le continent. Dans Rendez-vous avec l’heure qui blesse, Gaston-Paul Effa s’intéresse à un maire d’origine antillaise qui a été interné à Buchenwald. Avec Filles de Mexico, Samy Tchak nous emmène en Amérique latine. Et récemment des écrivains prennent la parole au travers d’essais : Felwine Sarr avec Afrotopia ou encore Gaston-Paul Effa avec Le dieu perdu dans l’herbe. Et l’on a dorénavant une littérature qui s’interroge sur elle-même.
Côté anglophone, ce secteur semble plus dynamique…
Ah oui ! Il n’y a qu’à penser à la foire de Hararé ou au dynamisme du Nigeria où il y a une vie littéraire très importante. Le monde anglophone nous donne des leçons. Il y a un marché du livre avec des éditeurs comme Heinemann, installé en Grande-Bretagne mais qui avait un bureau au Nigeria et qui a fait connaître Chinua Achebe. Un Nigérian publié chez lui est lu en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Australie parce qu’il existe un marché structuré autour d’éditeurs. Ce qui n’existe pas en Afrique francophone. Ken Bugul et Mariama Ba, par exemple, ont d’abord été publiées au Sénégal. Elles ont ensuite été traduites en anglais et leurs œuvres étaient connues en Afrique anglophone. Mais pour les lire dans l’espace francophone, il aura fallu que Pierre Astier les publie en France, au Serpent à plumes. Ce qui manque, ce sont de véritables politiques culturelles. Il y a encore en Afrique des pays sans bibliothèques nationales, sans médiathèques ni librairies.
Certains critiques avancent que des auteurs comme Dinaw Mengestu, Chimamanda Ngozi Adichie, voire Imbolo Mbue participent à un renouveau des lettres américaines. Qu’en pensez-vous ?
Oui ! Ils apportent un vent nouveau. C’est la mentalité anglo-saxonne : ces écrivains sont intégrés à la vie littéraire américaine comme auteurs. Ce qui n’est pas le cas en France, qui pense être le pays de la littérature par excellence. André Gide se demandait ce que Jorge Luis Borges pouvait apprendre aux auteurs français !
La littérature africaine reste cloisonnée : anglophone, lusophone, francophone et, au sein de l’espace francophone, le Maghreb est à part. Est-ce encore pertinent ?
Anglophones et francophones restons prisonniers de notre histoire et vivons dans des mondes parallèles. On ne se traduit même pas nous-mêmes ! On lit le Nigeria via la France. Et on ne connaît pas la littérature lusophone. Là encore, il manque des maisons d’édition comme les éditions Clé au Cameroun pour faire ce travail. Quant au Maghreb, nous entretenons un rapport hypocrite avec lui. Dans les années 1950, avec Frantz Fanon en Algérie, on a cru qu’on avait une communauté de destin face à l’occupant colonial. Mais tant que perdureront le racisme et cette relation condescendante, voire méprisante, du Maghreb envers l’Afrique noire héritée de la traite arabo-musulmane, aucun dialogue culturel ne pourra émerger. La relation n’est pas saine. Nos intellectuels, y compris musulmans, doivent affronter cette question.
Avec les éditions Zulma en France et Mémoire d’encrier au Canada, Boubacar Boris Diop a lancé la collection « Céytu » pour traduire en wolof des œuvres du patrimoine littéraire mondial, d’Aimé Césaire et de J. M. G. Le Clézio. En quoi cette initiative est-elle importante ?
Elle est importante en ce qu’elle pose peut-être les bases d’une future littérature africaine. L’avenir des littératures africaines se fera peut-être dans ses langues. Mais une littérature n’existe que si elle est lue. Qui lit ces ouvrages ? Boubacar Boris Diop a écrit en wolof Doomi Golo, mais il a fini par traduire son roman en français. On revient toujours au même problème, celui d’une véritable politique publique littéraire.
En octobre 2016, les Ateliers de la pensée organisés à Dakar et à Saint-Louis par Achille Mbembe et Felwine Sarr ont invité romanciers et spécialistes de la littérature à penser le renouveau de la pensée critique africaine. En quoi les lettres y contribuent-elles ?
Quand on fait le bilan de l’Afrique postcoloniale, on se rend compte que la littérature s’est penchée sur toutes les grandes questions : celle du statut de la femme, de la polygamie, des dictatures, des traditions, du cosmopolitisme, de la parole et de la palabre… Prenons ce dernier cas, par exemple : le philosophe camerounais Jean-Godefroy Bidima dans son essai La Palabre : une juridiction de la parole s’appuie sur le roman de Guy Menga La Palabre stérile pour penser le vivre-ensemble contemporain. Marcien Towa a construit sa réflexion de Négritude ou servitude ? sur le travail de Senghor. Et sur le génocide des Tutsi au Rwanda, outre les textes produits hors du continent, les écrits africains sont ceux des romanciers comme Boubabar Boris Diop et Tierno Monenembo. La littérature a réussi à introduire l’imaginaire africain, le penser africain, le parler africain dans le monde. Les philosophes doivent s’appuyer sur ce travail qui, par ailleurs, contribue à décoloniser les esprits et les imaginaires pour penser le continent.
Vous êtes l’un des rares critiques africains. Comment l’expliquez-vous ?
C’est un problème typiquement africain. On fonctionne selon le schéma « l’Africain produit, l’universitaire occidental théorise ». On ne peut pas se contenter de produire de la fiction, il faut aussi avoir un regard critique sur cette fiction et l’on doit arriver à comprendre que sans critique littéraire, il n’y a pas de littérature.
Avez-vous repéré de jeunes auteurs prometteurs ?
Marius Nguie a écrit un roman remarquable, Un Yankee à Gamboma. C’est l’un des meilleurs romans parus ces dix dernières années qui revient sur les prémices de la guerre civile au Congo et évoque la fascination de l’uniforme sur les jeunes enfants, les amitiés complexes… Kouam Tawa, qui écrit des haïkus africains, a beaucoup de talent. Il a un tempérament de poète très fin.
Quels sont vos derniers coups de cœur ?
Le Médecin qui voulut être roi, de Guillaume Lachenal, un ouvrage remarquable qui revient sur la place de la médecine coloniale dans les imaginaires. Le dieu perdu dans l’herbe, de Gaston-Paul Effa sur l’animisme, pour les perspectives qu’il ouvre. Et Le Soleil sans se brûler de Théo Anannisoh car, pour la première fois en Afrique, un auteur fait de la fiction à partir d’un autre auteur. Dans ce roman biographique, Théo Anannisoh se sert de l’expérience de Sony Labou Tansi pour méditer sur sa place dans le monde. Ce livre, qui plus est publié par une maison tunisienne, Elyzad, est tellement important qu’il a suscité Théo Anannisoh, Sony Labou Tansi, Amela et moi… de Bernard Mouralis.