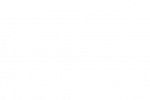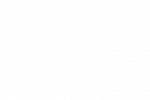Dans le sud de la Tunisie, les jeunes chômeurs de Tataouine défient l’Etat

Dans le sud de la Tunisie, les jeunes chômeurs de Tataouine défient l’Etat
Par Frédéric Bobin (El-Kamour (Sud de la Tunisie), envoyé spécial)
Des manifestants réclamant des emplois et la mise en place d’un fonds de développement régional sont installés à El-Kamour, à côté d’un site pétrolier qu’ils contrôlent désormais.
C’est un campement de tentes de toile battues par le vent du Sahara où, au loin, chaloupent des dromadaires. « On continuera jusqu’au bout, on passera même le ramadan ici sous une température de 50 degrés », assure Jamel Diffalah, barbe sombre et foulard blanc noué au front. Ici, à El-Kamour, morceau brûlé de désert du sud tunisien, à égale distance des frontières libyenne et algérienne, mûrit une crise sociale qui fait vaciller la Tunisie.
Né à Tataouine, le chef-lieu du gouvernorat, un mouvement de jeunes chômeurs réclamant des emplois a fini par établir sa ligne de front à El-Kamour, à 120 km au sud-ouest. De cette station de pompage, nœud stratégique d’un oléoduc souterrain, on peut fermer d’un tour de main le pétrole saharien de la Tunisie. Et c’est bien ce que font les protestataires depuis lundi 22 mai, le jour où tout a basculé.
Un drapeau tunisien est planté sur un cône de cailloux, pauvre mémorial blanchi par le soleil. Anouar Sakrafi, un manifestant, est mort là, percuté par un pick-up de la garde nationale (gendarmerie). En cette matinée du 22 mai, les convois de la garde nationale et de la police pensaient faire place nette en quelques heures. Ce camp de fortune où, au fil des semaines, se radicalisaient les esprits, faisait peser une menace sur le secteur des hydrocarbures, devenue insoutenable aux yeux du gouvernement de Tunis. Mais l’intervention a tourné au drame et à la débâcle pour l’Etat, qui a dû retirer la police et la garde nationale.
A Tataouine, les échos des affrontements d’El-Kamour ont jeté instantanément dans les rues la foule qui a incendié les sièges de la police et la garde nationale. La situation s’est depuis apaisée ; seuls des débris de barrages de bois, de tôle et de pneus brûlés témoignent de la poussée de fièvre. Mais la ville est désormais désertée de toute force de l’ordre.
Les locaux et les véhicules de la garde nationale tunisienne, le 23 mai 2017, Tataouine, après avoir été incendiés. | FATHI NASRI / AFP
« Ce sera la mort ou la richesse »
A El-Kamour, l’armée campe toutefois à proximité de la station, discrètement. Le face-à-face avec les manifestants, plus que jamais résolus à rester sur place, est plutôt bon enfant. « L’armée est neutre, elle est nette, ce n’est pas comme la garde nationale », dit Jamel Diffalah. Du reste, les militaires ne cherchent pas à rouvrir la vanne que les manifestants ont fermée. Les jeunes chômeurs de Tataouine conservent ainsi entre leurs mains la carte maîtresse du robinet du pétrole tunisien.
Sur le sol caillouteux s’étalent des matelas, des bouteilles d’eau et un jeu de cartes. Sous la tente de Jamel Diffalah, on exhibe une détermination sans faille. La phrase revient en boucle, elle est le slogan du mouvement. « Ar-rakh la » (« On ne lâche rien ! »). Ils ne veulent rien « lâcher » de leurs revendications : la création de 1 500 emplois dans les compagnies pétrolières, 3 000 dans les sociétés dites « de l’environnement, de plantations et de jardinage » – destinées à réhabiliter les abords des sites de production – et la mise en place d’un fonds de développement régional doté d’un budget annuel de 100 millions de dinars (40 millions d’euros).
Aux côtés de Djamel Diffalah, technicien informatique, il y a Youssef Abdelatif, ingénieur en géologie, et Sofiane Abid, licencié en comptabilité. Depuis la fin de leurs études, ils n’ont jamais trouvé d’emploi en rapport avec leur formation. A Tataouine, le taux de chômage des diplômés frôle les 58 %, l’un des plus élevés du pays. Le handicap est d’autant moins compris que le gouvernorat de Tataouine concentre l’essentiel des réserves nationales d’hydrocarbures. « Tataouine est à la fois la région la plus riche et la plus pauvre de la Tunisie », résume Sofiane Abid. Alors, « ce sera la mort ou la richesse », annonce Souf Fraïss, visage enroulé dans un chèche.
Ghouma Derza ne décolère pas : « Pourquoi cet usage de la force contre nous ? On n’est pas des terroristes, on n’a pas de kalachnikov. On demande juste du travail. » Ghouma Derza n’a pas terminé ses études de droit à Tunis. Il ne s’y sentait pas à l’aise : « On y considère les jeunes du sud comme des gens pas civilisés, presque comme des barbares. » Ghouma Derza n’a jamais trouvé d’emploi fixe. A 37 ans, il n’est toujours pas marié. « C’est difficile quand on n’a pas de situation économique stable », grince-t-il. Aussi vivote-il de petits boulots. Il a travaillé dans une épicerie. Et aussi dans la contrebande, seule activité vraiment florissante de cette région frontalière avec la Libye.
« La confiance est brisée »
Ghouma Derza ramenait de la frontière des cargaisons d’essence libyenne – bon marché – vendues ensuite au marché noir. Il pouvait gagner 900 dinars par mois (350 euros), trois fois plus que son salaire de l’épicerie. Depuis un an, les autorités tunisiennes, confrontées au danger terroriste, ont resserré leur contrôle de la frontière et la contrebande en souffre, privant la population d’une précieuse soupape économique.
Alors, quand Ghouma Derza voit toutes ces sociétés pétrolières employer si peu de jeunes de Tataouine – moins de 10 % des emplois reviennent aux locaux –, il en éprouve « une grande injustice ». Et comme les « promesses de l’Etat non tenues » n’ont pas manqué depuis la révolution, « la confiance est brisée », précise-t-il. L’entêtement des jeunes chômeurs de Tataouine se nourrit de cette « confiance » évanouie.
A El-Kamour, ils sont toujours plusieurs centaines à camper. Le soir, quand la canicule fait relâche, des véhicules arrivent de Tataouine en renfort. Des blessés du 22 mai reviennent, pieds ou mains bandés. Quand un pick-up de manifestants croise sur les pistes ensablées un camion de l’armée, on se klaxonne amicalement et on lève la main en signe de salut. « L’armée est notre amie » sourit Sofiane Abid. Tant que la vanne du pétrole reste fermée, bien sûr.