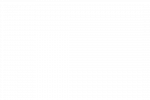A l’hôpital Saint-Louis, le recours à l’ambulatoire « oblige à être plus efficient »

A l’hôpital Saint-Louis, le recours à l’ambulatoire « oblige à être plus efficient »
Par Charlotte Chabas
Le gouvernement veut que, d’ici à cinq ans, 70 % des patients sortent de l’hôpital le jour même de leur opération. Cette mue bouleverse les organisations.
Elle marche péniblement, entourée d’un côté par son mari, de l’autre par ses deux enfants. Emmitouflée dans un large manteau de lainage brun, elle se présente à la porte d’accueil de l’unité de chirurgie ambulatoire de l’hôpital Saint-Louis, à Paris. « Il est 11 heures, c’est trop tôt, vous aviez rendez-vous à 13 heures », explique patiemment la secrétaire.
Un de ces petits contretemps — « accueillir, accompagner, rassurer », répète la secrétaire comme un mantra lénitif — qui fait partie de « tout ce qui est inquantifiable dans le travail hospitalier ». Et risque pourtant de gripper l’organisation millimétrée de la journée de ce service particulier, dans ce lieu où « encore plus qu’ailleurs, il faut tout anticiper », résume Michelle, brancardière dans l’unité depuis son ouverture, voila près de trois ans.
Dans cette mécanique de précision se joue, pour une part, l’avenir du système de santé français. La prise en charge dite « en ambulatoire » — c’est-à-dire avec une sortie du patient le jour même de son intervention chirurgicale — est un remède préconisé depuis les années 1990. Notamment dans une perspective de réduction des coûts : exit les dépenses liées aux frais d’hébergement et au personnel de nuit.
Objectif de 70 % en chirurgie en 2022
Ce « virage ambulatoire », la ministre de la santé, Agnès Buzyn, a rappelé qu’il constituait une priorité pour le gouvernement, rehaussant au passage à 70 % les objectifs de prise en charge en chirurgie d’ici à cinq ans. Aujourd’hui, un peu plus de cinq patients sur dix sont ainsi traités, avec des secteurs plus en pointe comme la chirurgie gynécologique, vasculaire, urologique, digestive ou encore dentaire.
Ces chiffres seront au cœur des réflexions des 7es journées nationales de chirurgie ambulatoire, qui se tiennent les 10 et 11 janvier. Car cette mue hospitalière à marche forcée bouleverse les organisations et nécessite la mise en place de nouvelles méthodes de travail pour le personnel. « Si on est obtus, on fait pas d’ambu », résume Julie Garnon, cadre de santé de l’unité de l’hôpital Saint-Louis.
Derrière ce type de prise en charge se joue un débat plus large : si l’on cherche à réduire le coût d’une hospitalisation, cela signifie-t-il forcément en réduire la qualité ? Pour Julie Garnon, « le contre-exemple le plus évident vient de la maternité ». A 2 240 euros la nuit, le séjour y est vite coûteux. « Parce que les mères exprimaient le désir de rentrer plus tôt chez elles, logique sociale et logique économique se sont conjuguées », analyse la cadre, qui rappelle combien les séjours en maternité ont été réduits en quarante ans — sans hausse des complications ou de mortalité pour autant.
« Cela ne doit pas être tabou de dire qu’on peut alléger le nombre d’actes sans remettre en cause notre travail », résume celle qui rappelle qu’un « bilan de santé coûte en moyenne 40 euros ». « On dit juste qu’ils ne sont pas toujours tous nécessaires dans tous les cas », reprend-elle.
« On ne laisse rien derrière nous »
Dans ce service parisien, il aura fallu un peu de temps avant que les équipes ne se fassent à cette nouvelle organisation. Le bloc opératoire commun a été abandonné au profit, depuis un an et demi, d’une salle réservée deux jours par semaine à la pratique de la chirurgie ambulatoire, où six spécialités sont pratiquées. Un tiers des opérations réalisées par Saint-Louis le sont désormais en ambulatoire.
Loin d’être rutilante et suréquipée, la petite aile du service paraît modeste pour accueillir tous les espoirs de l’hôpital du futur. Mais ceux qui travaillent là disent leur satisfaction d’évoluer dans un « service dynamique », « moins routinier ». « L’esprit d’équipe est plus fort car l’interdépendance est bien plus importante », souligne Julie Garnon.
Pour qu’un patient sorte dans les temps, il faut que le médecin soit passé, ait signé les documents nécessaires, délivré son compte rendu dans un délai satisfaisant. « Le patient n’est plus fait pour patienter », plaisante une aide-soignante, qui avoue apprécier qu’il n’y ait « plus autant de passe-droit dans l’équipe, chacun [devant] faire son boulot ».
Surtout, « on rentre chez soi le soir avec la satisfaction d’avoir achevé notre travail, explique un infirmier du service. En partant, on ne laisse rien derrière nous de mal fait, ou de pas fait du tout. Rien à refiler salement à celui qui prend le relais, c’est un luxe dans un monde hospitalier où tout le monde écope en permanence le navire. » Le rythme de travail, qui épouse la journée des patients, empiète aussi moins sur la vie personnelle. « Cela rend le service attractif », reconnaît Mme Garnon.
Des freins pratiques ou médicaux
La journée connaît, bien sûr, des pics d’activité, mais les emplois du temps de chacun sont anticipés au maximum pour éviter l’embouteillage. Chaque vérification médicale est ritualisée pour s’assurer des bonnes conditions d’hospitalisation et de suivi — l’appel du lendemain d’opération est obligatoire. « Cela tire vers le haut la prise en charge », affirme le docteur François Desgrandchamps, du service d’urologie. Lui dit se sentir « meilleur chirurgien » depuis l’ouverture du service, car « l’ambulatoire oblige à être plus efficient à tous les niveaux ».
Certaines difficultés demeurent, néanmoins. Parfois de l’ordre du pratique : le bloc n’est pas situé au même étage que le service, ce qui complique la tâche de l’équipe soignante. « Il faudrait concevoir les bâtiments en fonction de ce besoin », explique Michelle, l’une des brancardières.
D’autres freins sont médicaux. Certaines techniques ne sont pas toujours souhaitables : « En urologie, l’utilisation du laser par exemple est parfois à éviter, car le taux de réopération peut être plus important qu’avec d’autres méthodes », explique le Dr Desgrandchamps. « Le séjour va coûter moins cher, mais risque de se répéter », dit celui qui affirme que le monde médical « doit réfléchir à ces problématiques et établir des consignes claires destinées à l’ensemble de la profession ».
« Ce petit plus qui prend du temps »
L’argument économique (la réduction des coûts), utilisé pour promouvoir la chirurgie ambulatoire, peut toutefois apparaître un peu simpliste. Dans certains services, le personnel a constaté que la charge de travail avait été augmentée du fait du développement de l’ambulatoire.
La nuit, les lits étaient auparavant occupés à la fois par des patients aux pathologies lourdes — ceux qui ont besoin d’une prise en charge plus importante — et des patients plus légèrement touchés. Avec le développement de l’ambulatoire, ces derniers rentrent désormais chez eux le soir même, et les lits ne sont plus occupés que par des patients « lourds » et plus nombreux qu’avant.
« Le ratio d’un poste infirmier pour douze lits est forcément bouleversé quand on modifie le système », argue le chef du service d’urologie, pour qui l’ambulatoire ne rimera pas nécessairement avec réduction d’effectifs, contrairement aux idées reçues. Notamment parce qu’il faut aussi prendre en compte un souci commun : continuer de garantir une bonne prise en charge de tous les patients.
« Aujourd’hui, toutes les études montrent que la grande majorité des patients sont satisfaits », souligne le Dr Desgrandchamps. Mais il y a toujours « les autres ». Ce contingent évalué dans les études autour de 20 % des patients qui, interrogés, ont exprimé « un besoin le soir même de leur sortie d’hôpital ». De l’aide à la maison, un repas déjà préparé, ou juste un petit mot rassurant… « ce petit plus qui prend du temps », résume le chirurgien. « Même s’il n’y a pas d’acte à faire payer pour autant », résume-t-il.
Le spécialiste estime que « le rôle des autorités est désormais d’organiser cet après-hôpital pour lever le dernier frein de l’ambulatoire ». Faute de quoi, dit-il, on risque d’entretenir « la crainte d’un désengagement progressif du service public ».