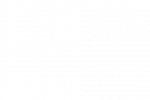« Chimamanda Ngozi Adichie se trompe au sujet de l’afroféminisme »

« Chimamanda Ngozi Adichie se trompe au sujet de l’afroféminisme »
Par Boris Bertolt
Pour le chercheur camerounais Boris Bertolt, on ne peut analyser l’oppression des femmes noires en Europe sans intégrer le facteur racial.
Tribune. Le 28 janvier, au cours d’une interview au quotidien Libération, la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, auteure du roman à succès Americanah, répondant à une question sur ce qu’elle pense de l’afroféminisme, a réagi en ces termes : « Je ne le comprends pas. Si on parle d’afroféminisme, alors parlons d’euroféminisme. Souvent, nous rajoutons des étiquettes pour parler des choses africaines, comme si on avait besoin d’une sorte de justification. » Certes, les femmes africaines n’ont rien à justifier, mais cela n’empêche pas qu’elles puissent revendiquer des spécificités et se détacher du féminisme eurocentrique, marxiste puis libéral.
L’afroféminisme prend ses racines dans l’expérience vécue par les femmes noires en Europe. S’il partage avec le féminisme noir (black feminism) américain le projet intellectuel et politique de donner un sens à l’oppression des femmes noires, il tire sa spécificité du contexte européen, et particulièrement français. L’afroféminisme rend compte de l’oppression des femmes noires dans une société qui, au nom de la République, rend invisibles les catégories raciales. Or, en dépit du discours public sur l’égalité, la race demeure en France, comme dans la plupart des sociétés occidentales, la « bête » qui structure, régule et matérialise les rapports de classe, les imaginaires et les relations de genre.
Le féminisme universel, un vœu pieux
Si le féminisme noir a permis de rendre compte de la spécificité de l’oppression des femmes noires aux Etats-Unis, l’afroféminisme ouvre des pistes d’analyse et de compréhension de la condition de la femme noire en France. Il articule les liens entre la race, le genre et la classe sociale dans le contexte européen. Le point central de l’analyse étant que la structure de l’oppression des femmes noires ne saurait être comprise dans la société française sous les seuls prismes du patriarcat et du sexisme, mais doit intégrer le facteur racial. Il s’agit donc d’une approche intersectionnelle dans l’analyse des inégalités de genre.
Dans sa réaction, Chimamanda Ngozi Adichie tente d’uniformiser la condition de la femme en voulant prêcher pour un « féminisme universel ». Un vœu pieux. Cela aurait été possible si la modernité occidentale tant célébrée ne s’était pas caractérisée par son ambivalence dans son rapport avec les peuples qualifiés à une certaine époque de « primitifs » ; si les valeurs de la Révolution française s’étaient appliquées dans les colonies au même titre qu’en métropole. Mais non. La colonie, dont la race aura été l’instrument majeur de régulation de l’organisation sociale et politique, a évolué en marge des beaux principes de la modernité et des Lumières.
Le corps de la femme noire a été à la fois un terrain d’expérimentation de la virilité du colon blanc, de différenciation par rapport à la « pureté » de la femme blanche, et le marqueur de la sauvagerie des hommes noirs. Contrairement à la femme blanche, qui bien qu’opprimée demeurait supérieure aux hommes noirs, les femmes noires se situaient au bas de l’échelle de la hiérarchie sociale. Elles souffraient d’une triple oppression : celle de l’homme blanc, celle de la femme blanche et celle de l’homme noir. Dès lors, même si elles ont été sous l’emprise du patriarcat blanc, la « blancheur » des femmes européennes rend historiquement leur expérience de l’oppression différente de celle des femmes noires.
Des corps racialisés et sexualisés
On ne saurait aujourd’hui rendre invisible le facteur racial dans la construction de la mécanique de l’oppression des Noires. S’il faut reconnaître que le féminisme occidental aura permis l’amélioration du statut de la femme de manière générale dans les sociétés occidentales, la couleur de la peau, qui construit toujours les hiérarchies sociales, les formes d’oppression et d’exclusion dans les sociétés occidentales, rend les expériences des femmes noires différentes de celles des femmes blanches.
En France, la formation dans le discours public d’un « racisme décomplexé » permet d’illustrer la continuité dans les représentations autour de l’altérité. D’ailleurs, l’auteure d’Americanah reconnaît qu’en dépit de la misogynie affichée de Donald Trump, de nombreuses femmes blanches ont voté pour lui parce qu’il a fait appel à leur « identité blanche ». On peut dans une certaine mesure penser que, pour les femmes blanches, la conservation des privilèges liés à la couleur de la peau est au-dessus de la lutte contre le patriarcat.
Dès lors, l’afroféminisme prend tout son sens parce qu’il porte sur des corps racialisés et sexualisés. Etre femme noire en France, c’est vivre l’oppression liée à sa couleur de peau, mais également celle du patriarcat blanc et noir. Un féminisme adapté à cette réalité ne saurait être de trop.
Boris Bertolt est chercheur en criminologie à l’Université du Kent.