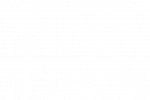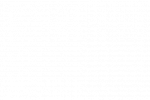« Il y a une détérioration persistante de l’Etat de droit au Guatemala »

« Il y a une détérioration persistante de l’Etat de droit au Guatemala »
Propos recueillis par Angeline Montoya
Le chef de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala, Ivan Velasquez, appelle la communauté internationale à se mobiliser, alors que le pays est appelé aux urnes pour la présidentielle du 16 juin.
Ivan Velasquez, chef de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala, en mai 2018 à Guatemala. / JOHAN ORDONEZ / AFP
La liste des ennemis du juriste et diplomate colombien Ivan Velasquez est au moins aussi longue que celle de ses soutiens. « Fais-le, et si ça te fait peur, fais-le en ayant peur », a-t-il tweeté en mai 2018. Ce procureur, qui a enquêté sur le narcotrafiquant Pablo Escobar, sait de quoi il parle. En tant que magistrat auprès de la Cour suprême de son pays, il a mis au jour la relation entre des parlementaires et les organisations paramilitaires, un scandale dit de la « parapolitique ». Menacé de mort, devenu la bête noire du président Alvaro Uribe – qui a dirigé la Colombie entre 2002 et 2010 et est impliqué dans des dizaines d’enquêtes pour paramilitarisme –, Ivan Velasquez a quitté son pays en 2012.
En 2014, il est nommé à la tête de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (Cicig). Cette instance a été mise en place en 2007 par le biais d’un accord entre les Nations unies et le gouvernement guatémaltèque. Ses missions, en collaboration avec le ministère public : désarticuler les forces parapolicières et les organisations clandestines de sécurité qui opéraient pendant la guerre civile (1960-1996), renforcer les institutions judiciaires et lutter contre la corruption. En douze ans de travail, la Cicig a identifié 60 structures criminelles et fait mettre en examen par le parquet général 680 personnes – dont 310 ont été condamnées.
En 2017, la Cicig s’est attaquée au frère et au fils du président actuel, Jimmy Morales, pour blanchiment d’argent, puis a demandé la levée de l’immunité du chef de l’Etat lui-même, soupçonné de financement illégal pour sa campagne. La réponse ne s’est pas fait attendre. M. Velasquez a été déclaré persona non grata et, le 7 janvier, le président a annoncé la fin de l’accord entre le gouvernement et la Cicig. Malgré tout, cette dernière continue son travail. Ivan Velasquez ne peut toujours pas rentrer au Guatemala.
Joint par téléphone à Bogota, il appelle la communauté internationale à agir pour défendre l’Etat de droit dans le pays centraméricain, où la présidentielle doit se tenir le 16 juin.
Dans quelles conditions travaillez-vous actuellement ?
Le non-renouvellement de visas de fonctionnaires, la désobéissance du président Morales aux ordres de la Cour constitutionnelle et l’ambiance délétère que tout cela génère limitent notre travail. Mais depuis l’étranger, je suis en contact quotidien avec mes collaborateurs, qui continuent à enquêter, à proposer des réformes juridiques et à remplir leur mandat, car l’accord entre la Cicig et le gouvernement, n’en déplaise à M. Morales, est toujours en vigueur, comme l’a établi la Cour constitutionnelle.
Quel a été le moment crucial à partir duquel le président Morales, qui soutenait pleinement la Cicig lors de sa prise de pouvoir en 2015, a décidé de retirer son soutien ?
Cela a été l’enquête sur son fils et son frère. Pendant toute l’année 2016 et jusqu’en août 2017, la relation avec le président était excellente. Il avait demandé le renouvellement du mandat pour 2017-2019 de manière anticipée, et avait annoncé qu’il ferait de même pour la période 2019-2021. Deux jours après que nous avons lancé une enquête contre lui, il a annoncé mon expulsion et m’a déclaré persona non grata.
Quand vous êtes arrivé au Guatemala en 2014, aviez-vous conscience de l’ampleur de la corruption ?
Non. Lors de mes conversations avec divers acteurs du pays, je voyais bien des signes de corruption, mais je ne me rendais pas compte de l’ampleur du problème. La corruption au Guatemala n’est ni épisodique ni conjoncturelle, mais systémique.
C’est ce que vous avez appelé la « capture de l’Etat » ?
En effet, c’est l’idée que l’Etat s’est converti en un instrument au bénéfice particulier de personnes qui le dominent. Un Etat qui oublie sa responsabilité vis-à-vis du peuple, et se met au service de ceux qui l’ont capturé, validant des lois qui les favorisent, le tout à travers des réseaux politico-économiques illicites. Ce sont des structures criminelles dont le but est de chercher à faire croître le pouvoir de ceux qui s’enrichissent de manière illégale et de garantir leur impunité.
Au centre du mandat de la Cicig figure la désarticulation de ce que l’on a appelé les « corps illégaux et les appareils clandestins de sécurité ». Les réseaux que nous avons identifiés en sont la version actuelle. Ils passent par des entreprises tout à fait légales pour blanchir l’argent obtenu de la corruption. C’est cette structure complexe de réseaux et de sous-réseaux qui tient l’Etat captif.
Vous avez fait tomber le président précédent, Otto Pérez Molina, et sa vice-présidente, Roxana Baldetti, en 2015, impliqués dans un scandale de fraude douanière. Vous vous attaquez maintenant au président en exercice… Que pensez-vous du reproche que l’on vous fait d’avoir enquêté sans prendre en compte les temps politiques ?
On nous dit qu’on aurait dû y aller plus graduellement, qu’on n’aurait pas dû affronter tous les ennemis à la fois. Mais la justice ne peut pas mesurer les temps politiques, sinon il s’agit d’une justice sélective. Il y aura toujours une excuse pour ne pas enquêter, pour retarder une investigation : une élection, une prise de fonctions… La seule chose que nous devons prendre en compte, c’est l’avancement de l’enquête. Et si l’enquête est suffisamment avancée, alors nous devons présenter ses résultats au parquet pour qu’il prenne les dispositions légales qui s’imposent.
Si l’on veut mener une lutte frontale contre la corruption, on ne peut pas faire la différence entre les personnes, cela ne mènerait qu’à du favoritisme. En tant que commission internationale, la Cicig n’a aucune relation avec les acteurs nationaux, elle est totalement neutre.
Un manifestant hostile à Ivan Velasquez, devant le siège de Commission internationale contre l’impunité au Guatemala, en août 2018 à Guatemala. / JOHAN ORDONEZ / AFP
Sans la Cicig, est-ce que le ministère public est en état de continuer seul les enquêtes en cours ?
Au-delà des enquêtes que le parquet est en mesure de mener, la question se pose du manque de volonté du gouvernement d’impulser les réformes nécessaires pour que le système judiciaire soit renforcé et puisse lutter efficacement contre la corruption et l’impunité.
Par exemple, en 2016 [lors d’un discours à l’occasion du neuvième rapport sur le travail de la Cicig], le président Morales avait soutenu une réforme de la Constitution qui permettait une plus grande indépendance de la justice, et avait demandé aux parlementaires de l’approuver. Mais il s’est lui-même chargé d’y mettre un frein un an plus tard, soutenant cette fois qu’il s’agissait de l’expression d’une ingérence étrangère. Cela a pour but de garantir l’impunité qui était en vigueur dans le pays avant l’arrivée de la Cicig.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Il faut un engagement fort des Guatémaltèques attachés à la lutte contre la corruption. La participation citoyenne est indispensable. Les derniers sondages montrent que la Cicig a 70 % d’opinions favorables. Les moyens de communication aussi ont leur rôle à jouer, mais les médias indépendants se sont vus étranglés économiquement par le pouvoir.
Qu’attendez-vous de la communauté internationale ?
Le moment vécu par le Guatemala est d’une grande complexité, non seulement au sujet de la corruption, mais de la défense de l’Etat de droit. Si la communauté internationale est vraiment engagée dans la défense de la démocratie, elle doit regarder vers le Guatemala et ne pas attendre, pour intervenir, d’arriver à des situations aussi graves que celles qui ont lieu dans d’autres pays de la région. Ce qui se passe au Guatemala est une détérioration persistante de l’Etat de droit, qui peut conduire à des gouvernements autocratiques risquant d’affecter la stabilité de toute la région.
Comment ce qui se passe au Guatemala peut-il avoir un impact dans le reste de la région ?
Si un gouvernement se met à flirter avec des méthodes autoritaires sans que cela prête à conséquence, d’autres pays peuvent être tentés de faire la même chose. En 2017, 1 400 tonnes de cocaïne sont passées par le Guatemala, selon le département d’Etat américain, et seulement 13,6 tonnes ont été saisies.
Dans la mesure où l’Etat de droit et la démocratie sont en déliquescence, où la justice devient un instrument de manipulation de puissants secteurs, on voit le développement de deux phénomènes : le développement sans frein des organisations de narcotrafic, et l’aggravation de la migration, due à l’augmentation de la pauvreté et de l’insécurité. Les Etats-Unis sont les premiers concernés par ces deux phénomènes. Pour les éviter, la communauté internationale doit se mobiliser.
En Colombie, vous avez mis au jour le phénomène de la « parapolitique ». Pensez-vous que l’inimitié que vous porte depuis lors l’ex-chef de l’Etat colombien Alvaro Uribe a eu une influence sur celle du président Jimmy Morales à votre égard ?
Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c’est que l’ex-président Uribe a toujours suivi de près ma situation au Guatemala. A de multiples occasions, à travers des messages sur Twitter, il a applaudi les mesures que le gouvernement de Jimmy Morales a prises contre moi depuis 2017.