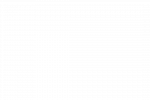Alain Mabanckou : « La durée de vie d’une dictature dépend de l’ampleur de notre silence »

Alain Mabanckou : « La durée de vie d’une dictature dépend de l’ampleur de notre silence »
Propos recueillis par Joan Tilouine
Entretien croisé avec les écrivains Alain Mabanckou et Abdourahman Waberi. Le Franco-Congolais et le Djiboutien expliquent leur vision de l’intellectuel engagé.
Le 10 mai, l’écrivain franco-congolais Alain Mabanckou publie une lettre ouverte à François Hollande l’alertant sur la situation au Congo-Brazzaville. Le professeur invité au Collège de France y dénonce les élections truquées, les arrestations arbitraires, les violences à l’encontre d’opposants exercées par le régime de Denis Sassou-Nguesso, au pouvoir depuis trente-deux ans. Et pointe le silence de la France.
Pour Le Monde Afrique, Alain Mabanckou discute avec l’écrivain djiboutien Abdourahman A. Waberi du rôle de l’intellectuel africain face à des régimes autoritaires.
Dans votre lettre ouverte à François Hollande, vous qualifiez le Congo comme une « république bananière » dirigée par un « tyran ». Qu’est-ce qui vous a poussé à l’écrire ?
Alain Mabanckou La multitude de lettres que m’envoient de jeunes Congolais. Dans leurs missives transparaît un profond désespoir, comme si leur horizon était bouché à jamais. La lettre d’un Congolais de 19 ans m’a particulièrement ému :
« Vous ne pouvez pas rester dans votre confort, dans les applaudissements qu’on vous fait en Europe alors que nous autres, au Congo, nous sommes en train de mourir à cause du silence des gens. »
Le jeune homme soulignait le silence des intellectuels du Congo, qui est pourtant un terreau d’écrivains. On peut citer Emmanuel Dongala, Wilfried N’Sondé, Maxime N’Debeka et bien d’autres. Mais nous restions muets et sourds aux cris de la jeunesse. Ce n’était plus supportable. Ce jeune compatriote m’a décidé.
Abdourahman A. Waberi Cette lettre est puissante et a déclenché un débat, en France et au Congo, où elle a provoqué des réactions grotesques de la part du régime. Ce qui a fait bouger les lignes et affaibli un peu plus cette dictature et sa fiction du discours officiel.
Que ce soit à Djibouti, au Congo ou dans d’autres dictatures africaines, il s’agit pour l’intellectuel africain de contrecarrer les fictions de ces régimes. Lorsque des intellectuels interviennent pour parasiter leurs messages, démystifier leurs mensonges, les dictateurs paniquent. Le fait qu’Alain, moi-même et d’autres existions, sans leur devoir quoi que ce soit, est un problème pour eux.
Littérature et combat politique vont-ils toujours de pair ?
A. A. W. C’est ça ou rien. A Djibouti, au Centre culturel français, seul endroit où je pouvais m’exprimer, le simple fait de ne pas remercier [le président] Ismaïl Omar Guelleh avant de parler était un crime de lèse-majesté. Il faudrait, au XXIe siècle, faire allégeance et remercier le président de vivre, de manger, de parler, de penser. Ces dictateurs africains veulent éradiquer toute pensée libre.
Nous avons essayé de rester silencieux, de nous tenir loin de la politique qui est chronophage, et franchement pas très intéressante. Mais nous sommes interpellés par les jeunes restés au pays. Donc on fait ce qu’on peut. On est un peu des snipers de dictateurs.
A. M. En tant qu’écrivain, notre rôle, c’est de faire en sorte que les questions essentielles ne soient pas diluées pour permettre aux autocrates de prospérer. Car la durée de vie d’une dictature dépend de l’ampleur de notre silence. Plus on est silencieux, mieux la dictature se porte. Dès qu’on parle, qu’on décrit la situation, le dictateur se redresse, contre-attaque, car il ne comprend pas que la parole puisse être plus puissante que ses armes. D’où cette lettre à François Hollande.
Pourquoi s’être tourné vers l’ancienne puissance coloniale ?
A. M. A quoi bon écrire à Denis Sassou-Nguesso ? Il ne lirait pas. Il ne comprendrait pas. J’ai écrit une lettre au président d’un pays démocratique. C’est comme au billard : pour atteindre une boule, il faut parfois tirer à côté et jouer avec les bandes. Et puis, cette dictature qui me traite de « nègre de salon » ne dépend que de la France, premier partenaire économique et politique du Congo. Les derniers dictateurs d’Afrique vivent souvent de la nourriture de l’ancienne puissance coloniale.
A. A. W. Guelleh et Sassou appartiennent à un ancien monde. Celui de ces derniers pays africains soumis à la puissance politique et économique d’une France qui a changé. Les réseaux de la Françafrique ont nourri leur semblant de puissance. Or la Françafrique appartient aussi à l’ancien monde. Ces dictateurs anachroniques ne perçoivent pas les changements. Pour les atteindre, il semble inévitable de parler à leur maître.
A. M. Pour régler les problèmes du Congo, il faut discuter avec la France et avec le Congo. Avec les mamelles et le bébé en train de téter. Parler seulement avec le bébé n’apporte pas de solution. Et ce bébé est agacé de voir qu’un intellectuel a aussi accès à sa mamelle. Je vais d’ailleurs rencontrer le président François Hollande début juin.
Vous enseignez tous deux la littérature africaine dans des universités américaines. En quoi cet éloignement a-t-il nourri votre réflexion d’écrivain de langue française ?
A. A. W. Cela permet de prendre de la hauteur. Aux Etats-Unis, le rapport à l’Afrique est plus neutre. Il n’y a pas cette culpabilité coloniale ou ses réseaux comme en France. Penser l’Afrique de Washington permet aussi de réfléchir à la France et de se confronter à des postures exigeantes de la Maison Blanche, de la Banque mondiale, d’ONG… Cela donne plus de force, car on comprend plusieurs langages, plusieurs visions.
A. M. Ce sont les Etats-Unis qui ont fait qu’on puisse voir Waberi et Mabanckou. Inviter l’enseignement de la littérature africaine au Collège de France [Alain Mabanckou y dirige le cycle « Lettres noires : des ténèbres à la lumière » du 29 mars au 31 mai] a montré aux Français qu’ils ne peuvent pas saisir la littérature française s’ils ne comprennent pas ce que les Africains disent de l’Europe. Et cela se trouve dans le roman africain. La littérature négro-africaine, absente des programmes scolaires en France, ce n’est pas seulement Senghor et Césaire. Quid du sénégalais Boubacar Boris Diop, de l’Ivoirien Ahmadou Kourouma, du Guinéen Tierno Monénembo, de Fiston Mwanza Mujila du Congo-Kinshasa, du Mauritanien Mbarek Beyrouk ?
Le dynamisme de la littérature africaine n’a pas vraiment d’écho en France. Or il y est parfois fait grand procès à l’Occident. Et c’est bien dommage que l’accusé tourne le dos. Car le jour où il sera de face, ce sera trop tard, il sera condamné !
Vos œuvres sont interdites dans vos pays. Pourtant, vous y êtes lus. Quels liens entretenez-vous avec vos lecteurs congolais et djiboutiens ?
A. A. W. Tout livre intéressant est très difficile à se procurer à Brazzaville ou à Djibouti.
A. M. On y trouve facilement les bouquins de Marc Levy, Guillaume Musso et Denis Sassou-Nguesso.
A. A. W. Que des textes subtils ! Dès qu’il y a un zeste de métaphore, d’allégorie et de pensée, le livre est interdit et devient un objet clandestin. Il circule sous le manteau ou se raconte oralement.
A. M. Ah ça oui, quand le gars dit qu’il a lu le livre et qu’il le raconte autour de lui, c’est magique ! Parfois, il ne l’a pas lu et improvise. Mais c’est beau.
A. A. W. Le livre devient vivant. Paradoxalement, si la dictature fait tout pour interdire les productions d’intellectuels africains, nous n’avons jamais été aussi médiatisés qu’aujourd’hui en France ou aux Etats-Unis. Lorsque [l’auteure nigériane] Chimamanda Ngozi Adichie donne une conférence dans une université prestigieuse, elle a droit à tous les égards.
A. M. Lorsque je vivais au Congo, la lecture se méritait. Nous allions parfois dormir au Centre culturel français où l’on trouve notamment les livres de Waberi et les miens. Et ces livres circulent, les gens les emportent, les photocopient. Faute de lucidité, la dictature fabrique elle-même le prototype de l’homme qui peut la faire trembler. Car les écrivains engagés et leurs lecteurs la feront trembler un jour !
Quel effet cela fait-il d’écrire des récits qui se déroulent souvent dans vos pays, où vous êtes désormais interdits de séjour et menacés ?
A. A. W. Cela fait sept ans que je n’ai pas foulé le sol de Djibouti. La dernière fois, c’était sur invitation de l’Unesco. Comme au Congo, le pouvoir intimide, menace les écrivains libres. Mes proches restés au pays en font les frais. Le pouvoir a même initié une réunion pour que mon clan se dédise de moi. S’il m’arrive un pépin, mon clan, étant prévenu, ne réagira pas. J’ai dit à mon clan qu’il ne s’inquiète pas. Et je ne me considère pas comme membre d’un clan.
A. M. Comme Abdourahman, il y a une sorte de fatwa contre moi. Il paraît que je suis visé par une instruction pour « divulgation de fausses nouvelles et outrage à magistrat ». Le point positif, c’est que la justice travaille au Congo. J’attends de voir les poursuites contre Denis Christel Sassou-Nguesso, le fils du président, dont le nom figure dans les « Panama papers ». Mais aussi les autres affaires comme les « disparus du Beach », les détournements des revenus pétroliers par la famille du président, les « biens mal acquis »…
J’ai évoqué des périodes douloureuses du Congo comme la guerre civile des années 1990 dans Les Petit-Fils nègres de Vercingétorix (éd. Points, 2006). Il y a des critiques sociales dans nos livres, mais les dictateurs ne comprennent pas les paraboles. Donc on doit parfois leur faire des croquis niveau école élémentaire, comme cette lettre ouverte, qu’ils ont pu comprendre.
A. A. W. Les petites mains des dictatures chargées de lire nos livres se contentent de chercher les passages faisant allusion à la politique, à leur régime… Souvent, ils ne comprennent pas qu’un animal puisse être une incarnation de leur maître.
Je me souviens avoir croisé par hasard un premier ministre de Djibouti dans un aéroport : « J’ai aimé ton livre », me dit-il. Je lui demande à quel livre il fait allusion. Et il me répond : « Celui où tu parles d’Amérique et d’Afrique. » Comme ce livre, Aux Etats-Unis d’Afrique (éd. J.-C Lattès, 2005), ne parlait pas de Djibouti, il l’avait apprécié !
A. M. Ma lettre semble avoir donné de l’urticaire au ministre de la communication du Congo qui s’agite, me dénie la nationalité congolaise, m’accuse de ne pas payer mes impôts au Congo… Un monsieur triste et ignorant. Que cela lui plaise ou pas, je suis congolais. Et je suis le Congolais qui a fait connaître au monde entier la ville de Pointe-Noire, les tréfonds de ses quartiers et son histoire.
Cette « politique d’inimitié », comme le dirait Achille Mbembe, ne peut pas prospérer. Il va falloir parler à ces gens-là dépourvus de culture et de la base intellectuelle nécessaire pour débuter le dialogue. Mais comment discuter avec un régime dont le nouveau ministre de la culture [Léonidas Mottom, nommé le 30 avril] défraie déjà la chronique pornographique avec des images de ses ébats circulant sur le web ? C’est répugnant, humiliant pour le Congo. Mais ce « ministre du Kama-Sutra » n’a pas été limogé, tant le Congo de Denis Sassou-Nguesso a toujours méprisé la culture. Or c’est par la culture que ces Etats peuvent se sauver, enrayer les divisions ethniques, et inspirer la jeunesse.
Comment conciliez-vous écriture et engagement politique ?
A. A. W. C’est une vieille tradition de l’écrivain africain qui de venir en appui des forces progressistes. Le nigérian Wole Soyinka [prix Nobel de littérature en 1986] a passé vingt-deux mois en prison [entre 1967 et 1969] pour un appel au cessez-le-feu qui fut interprété par le pouvoir comme un soutien au mouvement rebelle du Biafra. L’écrivain kényan Ngugi wa Thiong’o a été emprisonné un an [en 1977] car il voulait faire du théâtre populaire en langue kikuyu, ce qui fut interprété comme une tentative de révolte paysanne… Quand la situation est bloquée, il faut alors un outsider, un esprit libre et indépendant.
A. M. L’écrivain africain engagé ne peut pas être un simple spectateur qui regarde la tauromachie et prend le temps de peindre la couleur du sang car c’est excitant et que ça plaît au public. Ces dictatures nous considèrent toujours comme des amuseurs publics qui font des belles phrases. Mais ils ne mesurent pas que la parole de l’écrivain peut croiser les angoisses de la population. Et que la jeunesse peut trouver dans cette parole une clé pour ouvrir la cage dans laquelle les dictatures enferment les gens.
Ce n’est pas une simple posture. C’est une situation d’urgence. On ne voit pas comment s’en sortir sans dire à ces dictateurs ce qu’ils sont, ce qu’ils font et ce qu’ils font subir à leur peuple. L’art n’a de liberté que si le territoire où il s’exerce ou d’où il provient respire la liberté. Or il n’y a pas de liberté à Djibouti, au Congo et dans d’autres pays d’Afrique. Donc s’indigner est une sorte d’allégorie. On ne le fait pas que pour ces deux pays. L’Afrique cherche à aller vers la modernité mais traîne encore des dinosaures usant d’armes, de violence, de treillis militaires pour se maintenir au pouvoir.
Quelles sont vos principales sources d’inspiration ?
A. A. W. La chance de la littérature africaine, c’est qu’elle est familiale. On peut s’asseoir sur les genoux de nos géants. J’ai rencontré Léopold Sédar Senghor lorsque j’étais étudiant, mais aussi Aimé Césaire et Bernard Dadié.
Alain a grandi en lisant des grandes plumes congolaises comme Sony Labou Tansi, Tchicaya U Tam’si et d’autres. Moi, je suis pétri des mots de l’écrivain somalien Nuruddin Farah, de l’Ethiopien Heruy Wolde Selassie, mais aussi de Senghor ou Cheikh Anta Diop. C’est notre nourriture intellectuelle.
Frantz Fanon nous a enseigné qu’il fallait faire au moins aussi bien que le colonisateur et se battre. L’écrivain africain est cofondateur de ce continent et a une tâche intellectuellement « himalayesque ». D’autres ont fini par abdiquer et mettre leur plume au service d’un dictateur, comme le Camerounais Ferdinand Oyono.
A. M. Nous sommes tous deux le produit d’une tradition littéraire de la contestation. Nous sommes les fils ou petits-fils de l’écrivain malien Yambo Ouologuem, du Camerounais Mongo Béti… Nous nous revendiquons de ces intellectuels africains qui ont osé intervenir et peser sur les débats de société. Nous sommes le résultat de ces géants de la littérature africaine qui est née avec la contestation de l’image de l’Africain dans la littérature coloniale. Désormais, ce n’est plus l’image caricaturale de la littérature coloniale que nous contestons. C’est l’image de l’Afrique que renvoient nos dictateurs que nous voudrions effacer. Pour mettre en avant une Afrique libre et éclairée.