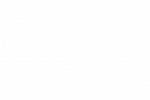Allemagne, un coup de bol historique

Allemagne, un coup de bol historique
Par Albrecht Sonntag (Enseignant-chercheur ESSCA Ecole de management)
Au lendemain des débuts victorieux de la Nationalmannschaft dans l’Euro 2016, notre chroniqueur Albrecht Sonntag revient sur la défaite du régime nazi au Mondial 1938.
Reinhard Grindel, président de la Fédération allemande de football, le 8 juin à Evian-les-Bains. | PATRIK STOLLARZ / AFP
Lille, le 12 juin. L’Allemagne ouvre son Euro 2016 par une victoire. Ce matin-là, Reinhard Grindel, le nouveau président de la Fédération allemande de football, devait visiter le Musée de la Résistance à Bondues (Nord), afin de rendre hommage à ceux qui s’étaient opposés à une invasion allemande autrement moins pacifique il y a plus de soixante-quinze ans.
C’est un geste sympathique, qui témoigne d’un changement de perspective significatif. Lors de l’Euro 84, il n’aurait sans doute pas encore été envisageable. Ce n’est qu’un an plus tard que le président de la République fédérale, Richard von Weizsäcker, dans un discours devenu célèbre, arrêta de manière définitive que « le 8 mai 1945 » n’était pas une capitulation, mais « un jour de libération ». Surtout pour les Allemands.
Dans quelques jours, la Mannschaft se déplacera à Paris. Peut-être M. Grindel devrait-il également déposer une couronne au Parc des Princes. Car c’est là, lors de la Coupe du monde 1938, que l’équipe allemande a encaissé la défaite la plus salutaire de toute sa longue histoire. L’élimination qu’elle a subie au premier tour face à la Suisse est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée.
C’est une étude de cas bien connue de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de ce sport. A la suite de l’annexion de l’Autriche – le fameux « Anschluss » de mars 1938 – les fonctionnaires nazis avaient imposé, avec cette « obéissance anticipée » aux désirs du Führer qui les caractérisait, une parité maximale entre footballeurs allemands et autrichiens pour la nouvelle sélection. Un vrai casse-tête pour le sélectionneur Sepp Herberger, en fonction depuis deux ans : manque d’automatismes sur le terrain, antipathie réciproque entre les deux groupes de joueurs, visions du jeu peu compatibles.
« La haine du Troisième Reich »
Bref : la mayonnaise ne pouvait pas prendre. Après un match nul 1-1 après prolongation, la « Grande Allemagne » est sortie par la petite porte après le match d’appui cinq jours plus tard. Après avoir mené 2-0 après seulement 22 minutes, elle s’est désagrégée en deuxième période, encaissant trois buts en un quart d’heure.
Cette défaillance réjouissait beaucoup de monde.
Les Suisses, d’abord. Comme le révèlent les différentes archives exploitées par Fabian Brändle et Christian Koller dans leur Histoire culturelle du football (2002), la rencontre avait été particulièrement chargée de signification politique. Durant la retransmission du match à la radio, la police constata « un calme saisissant dans toutes les villes » ainsi que « très peu de trafic dans les rues ». Après le coup de sifflet final, de nombreuses manifestations de joie éclatèrent partout dans le pays. Pour le Journal ouvrier de Bâle, « toute la haine du Troisième Reich s’y exprima », alors que la Gazette de Lausanne établit des parallèles avec la bataille de Saint-Jacques de 1444, un mythe national fondateur de l’Etat helvétique. Les lettres de félicitations envoyées spontanément à la fédération de football témoignent de la dimension symbolique qu’une grande partie de la population attribua à cette victoire.
Les historiens du football français ont quasi systématiquement adopté la perspective autrichienne. Le narratif dominant est celui de la « Wunderteam » danubienne bâtie par le magicien Hugo Meisl et menée par le magnifique attaquant Matthias Sindelar (mort dans d’étranges circonstances en janvier 1939), avant d’être disloquée par les Nazis. La défaite contre les Suisses au Parc des Princes devient ainsi une victoire de la morale sportive, voire de la morale tout court.
C’est beau, et c’est très convaincant, mais ce n’est que la moitié de l’histoire. Car on pourrait tout aussi bien prétendre que la « Wunderteam » née dans une série de 14 victoires d’affilée en 1931-32 était déjà en fin de cycle – Hugo Meisl était mort prématurément d’une crise cardiaque en 1937 – tandis que Sepp Herberger avait, lui, réussi à mettre en place son équivalent allemand, surnommé « le Onze de Breslau », qui aligna, tout au long de l’année 1937, des performances impressionnantes, parmi lesquelles un 8-0 contre le Danemark et un 4-0 contre la France. Pour cette équipe aussi, l’« Anschluss » fut une catastrophe.
Ni Hitler ni Goebbels en tribune
Pour ses successeurs, et pour la fédération allemande, le dilettantisme dont faisaient preuve les nazis au sujet du football – ils lui préféraient de loin le sport automobile, la boxe et l’athlétisme – fut une bénédiction. L’élimination par l’équipe helvétique en 1938 – à ce jour la seule Coupe du monde que la Nationalmannschaft n’ait pas finie dans les huit premiers – a épargné aux Allemands de voir le football instrumentalisé par le Troisième Reich, alors qu’ils possédaient une équipe capable d’aller loin dans le tournoi. Grâce à elle, il n’existe pas de photos juxtaposant la croix gammée et le trophée Jules-Rimet ni de Hitler ou Goebbels dans la tribune présidentielle d’une finale de Coupe du monde. Les nazis et le sport, ce sont les JO de Berlin. Le football, lui, l’a échappé belle.
Bien entendu, le football allemand a lui aussi été concerné par la mise au pas totalitaire de la société allemande, avec de lourdes conséquences, notamment pour les nombreux joueurs et dirigeants juifs dans les clubs. Et la fédération, qui depuis quelques années fait un travail d’introspection tardif mais sérieux – on peut citer pour l’exemple l’excellente somme de l’historien Nils Havemann Football sous la croix gammée (2005) – n’a guère brillé par des actes d’opposition ou de résistance contre le régime. Mais le palmarès international de la Nationalmannschaft, les quatre étoiles sur son maillot et les trois Euros déjà au compteur, resteront à jamais associés à la République fédérale. Ouf. Un vrai coup de bol. Cela vaut bien un dankeschön ! aux Suisses et un petit clin d’œil de reconnaissance au Parc des Princes.