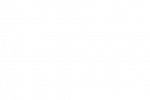« Les Britanniques sont convaincus que le Royaume-Uni reste un grand pays »

« Les Britanniques sont convaincus que le Royaume-Uni reste un grand pays »
LE MONDE IDEES
Pour Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique contemporaine à l’université Sorbonne-Nouvelle Paris-III, le Royaume-Uni pense ne pas avoir besoin du continent pour survivre.
Pauline Schnapper est l’auteure de Le Royaume-Uni doit-il sortir de l’Union européenne ? (La Documentation française, 2014) et de La Grande-Bretagne et l’Europe : le grand malentendu (Presses de Sciences Po, 2000).
Pourquoi les Britanniques se considèrent-ils différents du continent ?
La dimension insulaire, que certains mettent en avant, me paraît insuffisante pour expliquer la différence britannique : l’Irlande, elle aussi, est une île, mais son identité européenne est beaucoup moins problématique que celle des Britanniques. Les raisons historiques sont plus convaincantes. Il existe une tradition, en politique étrangère britannique, qui a toujours été, non pas le « splendide isolement », mais l’entretien d’un jeu d’équilibre entre les pays européens pour éviter une menace qui viendrait du continent. Elle repose sur l’idée que la Grande-Bretagne est extérieure à l’Europe, mais qu’elle est concernée par ce qui s’y passe et soucieuse d’éviter toute dégradation de la situation qui pourrait devenir une menace pour ses intérêts. Ce sentiment a été renforcé par l’expérience impériale : elle a montré que les liens culturels les plus forts n’étaient pas forcément ceux que l’on nouait avec ses voisins immédiats.
La seconde guerre mondiale et la résistance aux tentatives d’invasion de l’Allemagne ont en outre contribué à diffuser l’idée, en grande partie mythique, que le Royaume-Uni n’avait pas besoin du continent pour survivre. Il faut ajouter à cela l’expérience du déclin économique dans les années 1970 : parce que l’entrée du Royaume-Uni dans la Communauté économique européenne [CEE], en 1973, a coïncidé avec la crise économique, elle ne s’est accompagnée d’aucune amélioration immédiate du niveau de vie – ce qui n’a pas contribué à rendre l’Europe populaire. Aux yeux des Britanniques, le continent apparaît ainsi davantage comme une source de problèmes que comme un espace dans lequel on a intérêt à se fondre.
Lors du référendum de 1975, les Britanniques ont voté contre la sortie de la CEE. Pourquoi ce scrutin tout juste deux ans après l’adhésion ?
Le parallèle avec la période contemporaine est intéressant. A l’époque, le Labour était très divisé sur les questions européennes. Une partie du parti exprimait clairement sa frustration que le pays soit entré dans la CEE contre son gré. En 1973, le leader travailliste Harold Wilson, un proeuropéen sans grand enthousiasme, promit donc à ses troupes que si son parti revenait au pouvoir aux élections de 1974, il renégocierait l’accord conclu par son adversaire conservateur Edward Heath et organiserait un référendum sur la sortie de la CEE. On voit bien où David Cameron est allé chercher son inspiration. En 1974 comme aujourd’hui, la promesse de référendum est un outil de politique intérieure censé permettre de résoudre des difficultés de court terme.
La société britannique était-elle divisée, comme aujourd’hui ?
Oui, tout à fait. Le contexte politique et social était toutefois très différent. Il y avait encore une déférence envers les institutions qui a complètement disparu aujourd’hui. Les premiers sondages ont montré que l’opinion publique était opposée au maintien dans la CEE, ce qui n’était pas le cas du parti conservateur, de la moitié des travaillistes, des médias et des organisations patronales. Mais au cours de la campagne, l’opinion a basculé : à l’arrivée, le vote en faveur du maintien a obtenu les deux tiers des voix. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci.
Les pro- « Brexit » affirment aujourd’hui que le Royaume-Uni sera plus fort en dehors de l’Union européenne (UE). Cet argument rencontre-t-il un écho ?
La peur du déclin a été une obsession britannique dans les années 1960-1970. La grande force de Margaret Thatcher, dans les années 1980, a été de la renverser en mettant en avant la fierté nationale. Il s’agissait d’affirmer que la Grande-Bretagne était de nouveau une grande puissance. A cet égard, la guerre des Malouines, en 1982, a eu un effet remobilisateur.
Depuis, le Royaume-Uni a affronté la crise économique, mais dans l’ensemble les Britanniques sont convaincus que le Royaume-Uni reste un grand pays. Les eurosceptiques jouent d’ailleurs sur l’idée que la Grande-Bretagne est assez forte pour rester en dehors de l’Union européenne. Ils affirment que si elle sortait de l’UE, elle disposerait de toute manière de tous ses circuits traditionnels – les Etats-Unis, le Canada, l’Australie – et des pays émergents, avec lesquels elle pourrait signer des accords.
La question du déclin du Royaume-Uni est aujourd’hui à peu près absente du débat. L’idée sur laquelle insiste Nigel Farage, le chef du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni [UKIP, populiste], c’est qu’il faut se dégager de cette Europe déclinante sur le plan économique et se libérer de son emprise bureaucratique et régulatrice.
Le Royaume-Uni, qui est volontairement en dehors de l’espace Schengen et de la zone euro, conteste depuis 1973 le montant de sa contribution au budget européen, critique le fonctionnement de l’Union et s’oppose à une intégration politique et sociale plus poussée. N’a-t-il pas toujours refusé l’Europe ?
Non. Tout d’abord, il y est entré : c’est la preuve qu’il n’a pas refusé l’Europe. Il a certes refusé d’adopter l’euro et d’entrer dans l’espace Schengen, qui sont les deux pôles les plus importants de l’UE aujourd’hui, mais la contribution britannique à la construction européenne ne doit pas être oubliée, que ce soit pour la mise en place du marché unique, l’élargissement après la fin de la guerre froide, la coopération en matière de politique étrangère ou plus généralement la question de la démocratie à l’échelon européen.
Que répondez-vous à ceux qui, comme Michel Rocard, pensent que le Royaume-Uni est un obstacle à l’UE et qu’il vaudrait mieux qu’il en sorte ?
Vous remarquerez que c’est toujours lui que l’on cite. C’est le seul homme politique, dans les milieux français et européens, qui affirme une chose pareille. L’idée est séduisante, certes : puisque les Britanniques ont toujours été un frein, il suffirait de s’en débarrasser pour enfin réussir le grand saut fédéral. Cela supposerait que les Britanniques soient le seul obstacle à ce saut, mais c’est loin d’être le cas : quand on regarde les difficultés de l’UE aujourd’hui – les crises, le manque de leadership, la montée des populismes et le rejet de l’Europe dans les opinions publiques –, cette idée paraît naïve.
Quelles seraient concrètement les principales conséquences d’un « Brexit » ?
Les conséquences seraient importantes sur le plan économique. A court terme, la sortie de l’UE entraînerait très probablement une chute de la livre, une chute de la Bourse et une hausse des taux d’intérêt – le Trésor britannique prévoit une année de récession. A moyen terme, tout dépend des accords qui seront conclus avec l’UE. Si le départ du Royaume-Uni est essentiellement symbolique, si des accords sont trouvés sur la libre circulation des personnes (ce qui me paraît difficile), le marché unique et la place du Royaume-Uni à la table des négociations, les conséquences économiques seront peut-être limitées. Si, en revanche, l’accord trouvé réduit les échanges commerciaux entre le continent et le Royaume-Uni, ce sera beaucoup plus embêtant. Le Royaume-Uni pourra subir une chute des investissements étrangers, dont son économie est très dépendante. Sur le plan politique et diplomatique, une sortie de l’UE affaiblira et isolera le Royaume-Uni. Mais elle affaiblira aussi l’UE : le Royaume-Uni, qui dispose d’un siège au Conseil de sécurité de l’ONU, est une puissance nucléaire. Ces liens resteront-ils les mêmes après un tel divorce ? Rien n’est moins sûr.
David Cameron est-il tombé dans un piège ?
David Cameron a commis une erreur politique majeure. L’ironie, c’est qu’au départ il s’intéressait peu aux affaires européennes. Sa vision, dans la mesure où il en avait une, était eurosceptique : il a fait sortir les députés conservateurs du Parti populaire européen tout en ne souhaitant pas sortir son pays de l’UE. Mais la pression est devenue tellement forte chez les conservateurs qu’il a fini par promettre un référendum. Aujourd’hui, il est le chef du camp du maintien, ce qui n’est pas très crédible quand on a passé des années à critiquer l’Europe.
David Cameron est désormais dans une position peu confortable, quel que soit le résultat du scrutin. Si les Britanniques se déclarent en faveur de la sortie de l’UE, il devra démissionner. S’ils se prononcent pour le maintien dans l’Union, les députés conservateurs favorables au « Brexit » pourraient voter une motion de défiance afin de le contraindre à partir.
Cameron avait déjà pris un risque énorme lorsqu’il avait organisé le référendum sur l’indépendance de l’Ecosse, en 2014, mais il n’avait pas vraiment le choix : une majorité d’électeurs soutenaient clairement le SNP, le parti qui demandait le référendum. Cette fois-ci, c’est un piège dans lequel il s’est enfermé lui-même. Personne ne l’obligeait à faire cette promesse. S’il sort affaibli de ce référendum, il en sera le premier responsable.