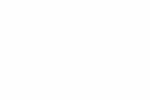Cyclisme : la tête dans les pilules

Cyclisme : la tête dans les pilules
LE MONDE SPORT ET FORME
Pour être excité lors des courses, pour récupérer entre les étapes, pour dormir... Certains coureurs ne conçoivent plus leur métier sans « pastoches », même légales.
Ressuscitons, pour les besoins de la cause, Albert Londres. Quelles confessions lui ferait aujourd’hui un coureur du Tour de France, dans l’énervement d’une course trop demandeuse, si le reporter du Petit Parisien lui demandait « comment il marche » ? Peut-être reprendrait-il à son compte, dans un accès de franchise et avec un doigt d’exagération, les mots des frères Pélissier qui, en 1924, passaient à table au Café de la gare à Coutances : « Ça, c’est de la cocaïne pour les yeux, ça, c’est du chloroforme pour les gencives. – Ça, dit Ville, vidant aussi sa musette, c’est de la pommade pour me chauffer les genoux. – Et des pilules ? Voulez-vous voir des pilules ? Tenez, voilà des pilules. »
Un siècle plus tard, c’est la caféine, c’est la nicotine que l’on fourre entre la gencive et la lèvre, et les pilules sont toujours bien rangées dans les boîtes, parfois assorties d’une alarme pour que l’on n’oublie pas de les gober. Rien n’est interdit par le code mondial antidopage, tout n’est pas automatique, mais il y a derrière ces petits remèdes du quotidien la même conviction que celle des frères Pélissier : ce sport est trop dur pour être pratiqué sans adjuvant.
Un coureur de haut niveau détaille, sous le sceau de l’anonymat, l’étendue de la pharmacopée légale à la disposition des cyclistes pour affronter leurs souffrances. Ce champion finissant, une quinzaine de grands tours à sa ceinture, se mue en ethnologue et décrit la vie de coureur et les coutumes du peloton.
Depuis l’interdiction des injections en 2011 par l’Union cycliste internationale (UCI) pour éradiquer la culture de la seringue, le peloton a, selon lui, développé un réflexe « pastoches ». Pilules de récupération et de supplémentation, mais aussi pilules pour dormir, pilules pour être excité pendant la course, pilules pour aller plus loin dans la douleur, pilules pour décompresser au départ et après l’arrivée.
« La culture du produit n’a pas disparu de ce milieu »
L’effet d’accumulation laisse le lecteur pantois. Toutefois, précise le « cycliste masqué » que Le Monde a rencontré, ce panorama qui donne le tournis recouvre une multitude de réalités. De ceux qui prennent un somnifère une fois par an, quand ils ont le corps brûlé, à ceux dont la prise de cachets rythme la journée, en passant par les jeunes coureurs qui tentent de faire leur métier sans le moindre cacheton.
Il y a deux manières de considérer ce témoignage. La première, optimiste, consiste à dire que ce sont là des dérivatifs légaux et bien triviaux, comparé au dopage lourd (EPO, transfusions sanguines, testostérone…) dans lequel le milieu s’est vautré. La seconde, pessimiste, est d’y voir la permanence d’un raisonnement malsain, suivant lequel la performance ne peut exister sans aide pharmaceutique.
Le sociologue Olivier Aubel, qui travaille depuis une dizaine d’années sur le peloton professionnel, et notamment son rapport au dopage, réunit les deux points de vue. « La culture du produit n’a pas disparu de ce milieu. Les produits pharmaceutiques restent des choses relativement communes, et le corps est, dans leur esprit, un élément que l’on peut maîtriser. Ils paramètrent ce qui est, pour eux, une machine, relève le chercheur de l’université de Lausanne. D’un autre côté, on est là dans l’accomplissement d’un job, pas dans la triche. C’est une pharmacopée de soutien, et certains coureurs disent qu’“à métier extraordinaire, pharmacopée extraordinaire”. Il faut comparer cela à la vie d’un salarié en dehors du milieu sportif, qui prend un Guronsan le matin pour aller travailler : l’usage à grande échelle de l’automédication dans le monde du travail, et des psychotropes en particulier, est attesté par nombre d’études épidémiologiques. »
Pour le coureur Steve Chainel, neuf ans de professionnalisme, passé par toutes les équipes françaises, « le corps humain n’est pas fait pour rouler 30 000 kilomètres par an. Nous sommes des formule 1, et ce n’est pas manger du boudin noir une fois par semaine et du muesli tous les matins qui nous fera tenir tout au long de saisons qui durent maintenant dix mois sur douze ».
« Solution de facilité »
Le réflexe du cachet, explique celui qui continue sa carrière en cyclo-cross, est la conséquence de l’état de stress dans lequel le cycliste se trouve souvent plongé. « C’est la solution de facilité. On a surtout envie de ne pas subir. Un coup de fatigue ? Je manque sûrement de magnésium ou de fer. Souvent, les examens révèlent que je n’étais pas carencé, mais je préfère prévenir que guérir. Donc, quand on arrive sur un grand Tour, on a en effet notre sachet de magnésium, sels minéraux, vitamine C, caféine, quelques décontractants musculaires et des somnifères pour les nuits passées dans des hôtels miteux ou bruyants. Effectivement, ça fait entre dix et quinze “pastoches” par jour, et ça nous ruine plus la santé qu’autre chose. Mais c’est notre travail et la compétition qui veulent ça. »
De fait, aucun sport n’échappe au phénomène, soulignent les spécialistes, qui s’inquiètent du développement d’une addiction non pas au produit mais au comportement. « Quand un gamin se gave de vitamines, oligo-éléments et compléments alimentaires entre deux stages, on est en plein dans une conduite nocive, en rapport avec la performance, un stress aigu, et la difficulté d’assumer l’objectif qu’on s’est fixé », affirme Bertrand Guerineau, psychologue à l’Antenne médicale de prévention et de prise en charge des conduites dopantes des Pays de Loire.
« Tout se passe dans la tête, confirme l’ancien coureur David Millar, dopé repenti. Les mecs sont persuadés qu’ils doivent prendre quelque chose. Cela devient une dépendance psychologique, et non physique, car l’effet sur la performance est inexistant. Mais ça fait partie, surtout en France et en Belgique, des traditions du milieu cycliste. Qu’il faut éradiquer, pour la simple raison qu’elles sont stupides. »
Certains médecins d’équipe tentent de limiter le recours aux pilules. Tel le docteur Gérard Guillaume, écarté de l’équipe FDJ en fin de saison dernière après seize ans de service : « En début d’année, on fait un bilan individualisé hypersophistiqué, très coûteux, qui détermine ce dont les coureurs ont besoin et surtout ce dont ils n’ont pas besoin. Je centralisais tout, et ils prenaient une gélule par jour d’oligo-éléments. En quoi est-ce pire que ce que vous prenez, vous, les journalistes ? »
A ce stade de la rédaction de l’article, sentant poindre la fatigue, l’auteur va se faire un café, bien serré. Rapidement, le voilà dans le même état que l’athlète britannique Mo Farah avant son titre olympique du 10 000 m, en 2012, tel qu’il le raconte dans son autobiographie (Twin Ambitions, Hodder, 2014, non traduit) : « Alors que je me dirige vers la piste, je ressens une grosse montée de caféine. Je suis euphorique. Mes mains, mes jambes… tout tremble. » Le meilleur fondeur du monde, qui ne cache pas son addiction au café, a l’habitude de boire un expresso vingt minutes avant le départ des courses. Pour l’occasion, il en a pris deux.
La caféine est aussi très répandue dans le football, avant les matchs, ou dans les sports d’endurance. Il est même devenu difficile d’y échapper, indique « le cycliste masqué » : « Aujourd’hui, la plupart des équipes sont sous contrat avec des marques de gels énergétiques dans lesquels les fabricants glissent des produits “boosters” à base de caféine, en doses de 200 à 400 milligrammes, soit trois ou quatre expressos. Ça a surtout un effet placebo. »
Steve Chainel confirme : « Sincèrement, c’est du pipi de chat, ça ne pousse pas les jambes. » Mais bon, tout de même : « C’est un excellent “boost” au bout de 180 kilomètres, ça permet de ne pas avoir de coup de mou, et ça donne le petit coup d’énervement supplémentaire pour l’arrivée, le petit coup d’accélérateur. »
Couplée avec un bronchodilatateur et un antalgique, prise dans la dernière heure de course, la caféine est l’élément de base d’un « bidon de sprint », ou bomba, en souvenir du cocktail d’amphétamines qu’appréciait l’Italien Fausto Coppi. Efficace, mais pas interdit.
Lorsque la caféine était encore sur la liste rouge, avant 2004, il fallait s’infuser une dizaine de petits noirs pour arriver au seuil de positivité. Ce seuil élevé a néanmoins été atteint par environ 1 % des sportifs contrôlés en 2014 en cyclisme, athlétisme, natation et ski. La caféine n’est pas près d’être interdite, confirme Olivier Rabin, le directeur scientifique de l’Agence mondiale antidopage (AMA) : « Bien sûr que la caféine augmente la performance. Mais peut-on considérer que c’est une substance dopante quand on la compare à l’EPO, aux stéroïdes anabolisants ou autres ? Il faut garder une certaine mesure : la caféine est consommée par des centaines de millions de gens tous les jours. De plus, les experts de l’AMA sont sensibles au côté naturel d’un produit. »
L’abus de caféine est aussi une manière « naturelle » de réveiller l’organisme engourdi par la prise de somnifères, elle-même consécutive à un abus de caféine. L’Italien Luca Paolini, de l’équipe russe Katusha, positif à la cocaïne sur le dernier Tour de France, était entré dans ce cercle vicieux jusqu’à suivre une cure de désintoxication aux somnifères. Dans une interview à La Gazzetta dello Sport, le médecin de Katusha, Massimo Besnati, avait ainsi expliqué la mode des somnifères dans le peloton : « Maintenant qu’il n’y a plus de produits de récupération, les coureurs ont du mal à se requinquer. Ils sont stressés par une fatigue progressive, qui gêne le repos. »
Sachets de tabac humide
Le snus, tabac à chiquer venu de Scandinavie, fait partie des moyens de lutter contre le stress de la compétition. Très communs dans les sports d’hiver, ces petits sachets de tabac humide que l’on glisse entre la gencive et la lèvre, se répandent dans les sports collectifs sous la forme « d’un rituel initiatique et secret », dit Thomas Bujon, sociologue des addictions à l’université de Saint-Etienne et auteur d’une enquête sur la question. En 2014, le programme de surveillance de l’AMA a relevé la forte présence de nicotine dans plus d’un quart des échantillons de footballeurs, basketteurs, rugbymen ou volleyeurs, sans que l’on puisse dire s’il s’agissait d’une cigarette fumée dans la journée ou de tabac à chiquer.
Pratique sociale, la prise de snus peut aussi accélérer la fréquence cardiaque, faire baisser l’anxiété et augmenter la concentration. « Il y a une différence entre la perception des sportifs, qui le comparent au Myolastan [décontractant musculaire], et les toxicologues qui disent que c’est tout sauf un relaxant », observe Thomas Bujon.
Dans le peloton, ce « chewing-gum à la nicotine » est particulièrement prisé par les équipes russes ou belges. Dès lors que quelques leaders s’y sont mis, leurs coéquipiers les ont imités. Les plus accros sont passés d’un sachet sous la lèvre à quatre, deux en haut, deux en bas. Les conséquences sur les gencives et la denture se verront dans quelques années. Celles sur la course se constatent déjà, selon certains coureurs, qui voient dans le snus une cause de chutes : le ruminant perd la notion du danger et n’hésite plus à prendre un maximum de risques, en cherchant à passer là où il n’y a pas la place ou en refusant de freiner.
Dans un même élan, les coureurs dénoncent le tramadol, un antidouleur en vogue dans le peloton qui plonge dans un état comateux. Certains coureurs en gardent un sous le cuissard en cas de besoin. Ses opposants s’insurgent : s’il est déconseillé de conduire sous l’effet du tramadol, comment peut-on laisser certains se faufiler dans le peloton à 50 kilomètres/heure ?
Pas de « sentiment de tricher »
L’UCI a demandé en 2015 à l’AMA d’interdire cet opiacé semblable à la codéine, addictif et dont la consommation augmente en France. La question a fait l’objet de vifs débats entre experts. « Il était dans le projet de liste [des produits interdits pour 2016] mais ça n’a pas abouti, précise Olivier Rabin. En effet,des spécialistes considèrent qu’il est parfois très utile dans la gestion de la douleur, et la très grande majorité de nos parties prenantes étaient contre l’idée de l’interdire. » En clair : des fédérations internationales ont pesé de tout leur poids en faveur de cet antidouleur. Dans le cyclisme, selon le programme de surveillance de l’AMA, 5,4 % des échantillons de 2014 seraient positifs au tramadol.
Les médecins anglo-saxons n’ont rien contre l’utilisation de narcotiques pour lutter contre la douleur dans certains cas, rappelle le docteur Rabin. Le tramadol était en vogue dans la formation britannique Sky, celle de Chris Froome, vainqueur du Tour de France 2013 et 2015, jusqu’à ce qu’un ancien de l’équipe vende la mèche. Pas de ça chez nous !, s’est récrié le patron Dave Brailsford, très sensible à l’image de l’équipe.
C’est que le produit peut être considéré comme une substance dopante, dans la mesure où il permet d’allonger les sorties d’entraînement et d’aller plus loin dans la douleur. « Si l’EPO est un dopant de niveau dix, le tramadol est à deux », estime le médecin de l’équipe américaine Cannondale-Garmin, Prentice Steffen. « C’est puissant, c’est efficace, assure David Millar. Il faut vraiment s’en occuper car les opiacés, dans le vélo, aident à la performance. »
Toutefois, souligne le « cycliste masqué », « pas un coureur n’a le sentiment de tricher quand il prend tout ça. On ne peut pas reprocher à un coureur de prendre un produit s’il n’est pas sur la liste ! » Ainsi vont les forçats de la route, as de « la liste » et de l’automédication, maîtres de leur corps et esclaves d’un sport par nature surhumain.