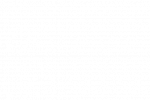Euro 2016 : « To be or not to be English », par Albrecht Sonntag

Euro 2016 : « To be or not to be English », par Albrecht Sonntag
Par Albrecht Sonntag (Enseignant et chercheur ESSCA, école de management)
En ce jour de référendum outre-Manche, notre chroniqueur s’intéresse au rôle de la sélection aux trois lions dans la construction d’une identité nationale anglaise, et non britannique. Une cause de la montée de l’euroscepticisme.
Lors du match Slovaquie-Angleterre (0-0), lundi 20 juin, au stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Etienne. | Max Rossi/Reuters
En février, lorsque David Cameron a fixé la date du référendum sur le maintien (ou non) du Royaume-Uni dans l’Union européenne, il était amusant de s’adonner à des spéculations gentiment moqueuses au sujet du possible impact de l’Euro sur le comportement électoral des sujets de Sa Majesté. Aujourd’hui que le « Brexit » se dessine comme une issue plus que plausible du vote, on a moins envie de plaisanter. Et, une fois le divorce consommé, on se demandera, comme tous les couples naufragés, comment on a pu en arriver là. On se creusera la tête pour comprendre les causes profondes d’un désamour suffisamment fort pour que le partenaire claque la porte.
Quel lien avec le football ? Aucun, à première vue. Mais cela se trouve que le football a joué un petit rôle dans les coulisses du drame conjugal. Car il a été à la fois un symptôme et un terrain d’expression de ce qu’il n’est pas exagéré d’appeler une crise identitaire. Cette crise est liée au concept d’« Englishness ».
Cela a commencé dans les années 1990, avec une vague de publications historiques foisonnante sur l’avènement du Royaume-Uni et la coexistence des différentes parties – les « home nations » qui le composent. La « devolution » – décentralisation mise en œuvre par le gouvernement Blair vers la fin de la décennie et accordant une plus grande autonomie à l’Ecosse et au Pays de Galles – a laissé l’Angleterre en quelque sorte « orpheline de la Grande-Bretagne ». Car, face à l’affirmation des autres membres du « Royaume-moins-uni-qu’avant », l’adjectif « britannique », si longtemps lié à un empire désormais disparu, perdait de son sens pour un grand nombre d’Anglais.
Dans les librairies, on trouva alors toute une flopée de tentatives plus ou moins réussies de définir une identité nationale distinctement anglaise ou de décrire son émergence. L’écrivain Julian Barnes s’en moqua brillamment dans son roman satirique England, England, dans lequel un magnat des médias transforme l’île de Wight en Angleterre miniature, en un concentré d’« Englishness ».
Le retour de la croix de saint Georges
Dans le désarroi identitaire, on s’accroche aux symboles. Tout à coup, l’équipe nationale anglaise – dont l’attachement était traditionnellement éclipsé par l’amour pour les clubs – a fait l’objet d’une vague d’engouement. Et elle a servi d’écran pour y projeter un symbole puissant, marqueur distinctif d’une identité nationale anglaise, et non britannique.
Si on chantait encore sagement le God Save the Queen valable pour tous les Britanniques, toute l’iconographie liée à l’Union Jack so british, qui avait dominé jusque dans les années 1980, fut remplacée assez rapidement par la croix de saint Georges, aujourd’hui omniprésente jusque sur le design des slips de supporteurs éméchés. C’est bien le football qui a entièrement réhabilité ce vieux symbole, que l’extrême droite s’était approprié durant plusieurs décennies.
Le grand changement eut lieu à l’Euro 1996, qui était justement accueilli par l’Angleterre (Football’s Coming Home), et non par la Grande-Bretagne. Trois années plus tard, le journaliste Jeremy Paxman se souvint de ce basculement dans son livre The English : A Portrait of a People :
« En 1995, le marchand de cartes de vœux Clinton’s s’est mis à fabriquer les premières cartes pour fêter la Saint-Georges. En l’espace de deux années, les boutiques en vendaient plus de 50 000 en chaque mois d’avril. A l’été 1996, il y a eu une augmentation considérable de supporteurs anglais de football au Championnat d’Europe qui avaient choisi de maquiller leur visage avec une croix rouge sur fond blanc à la place de l’habituel Union Jack. En avril 1997, le “Sun” sautait dans le train en marche en imprimant une croix de saint Georges d’une demi-page dans ses éditions anglaises et en demandant à ses lecteurs de la coller sur leur fenêtre. (…) Et lors de la Coupe du monde à l’été 1998, la croix de saint Georges semblait avoir remplacé le drapeau britannique. »
En 2002, le phénomène a atteint son paroxysme : en l’espace de deux mois seulement, entre le jubilé des cinquante ans de règne d’Elisabeth II, la Coupe du monde au Japon et en Corée du Sud, et le tournoi de Wimbledon, le principal fournisseur de drapeaux à croix de saint Georges, un certain Aggy Akhtar, du East End de Londres, qui avait fleuré la bonne affaire, réalisait des bénéfices de 6 millions de livres sterling…
De l’« Englishness » à l’euroscepticisme
L’« Englishness » a envie de prendre sa revanche, sur sa dévaluation en interne, contre une Ecosse rebelle et sûre de son identité propre, et sur l’humiliation en externe que constitue le partage de la souveraineté dans une Europe communautaire. Et l’équipe nationale, comme l’a noté très finement l’écrivain David Goldblatt, avec ses joueurs d’origines ethniques diverses, a permis d’ancrer dans l’imaginaire national la dissociation de l’identité anglaise de toute connotation ethnique. Ce qui se reflète d’ailleurs aujourd’hui dans la diversité des supporteurs qui accompagnent leur équipe.
Il n’est aucunement tiré par les cheveux de considérer que la consolidation et l’intensification, durant les deux dernières décennies, de cet euroscepticisme agressif et revendicatif, qui a fini par pousser un premier ministre relativement faible dans le cul-de-sac d’un référendum, a été concomitante et, en fait, sous-tendue par l’émergence de l’« Englishness ».
Aujourd’hui, jeudi 23 juin 2016, ce référendum sera décidé non pas par le vote en Ecosse ou en Irlande du Nord, nations majoritairement proeuropéennes, mais en Angleterre, nation ébranlée, fragilisée, où n’a cessé de grandir le sentiment qu’il est temps de mettre fin à « thirty years of hurt », comme le disait la chansonnette de l’Euro 1996 sur le football qui « revenait à la maison ».
Même s’ils se persuadent, en ravivant un pragmatisme très british dans un contexte sur-émotionnalisé, qu’il est plus raisonnable de rester dans une Union européenne elle-même en crise identitaire aiguë, le sentiment demeurera. Et l’euroscepticisme reviendra, aussi sûrement que les supporteurs éméchés avec leurs trois lions sur le tee-shirt et leur slip à la croix de saint Georges.