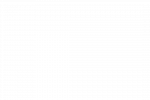Turquie : « Ce n’est pas seulement une purge, mais un reformatage de l’Etat »

Turquie : « Ce n’est pas seulement une purge, mais un reformatage de l’Etat »
Propos recueillis par Enora Ollivier
Le chercheur Jean Marcou s’inquiète de la « situation d’exception » en Turquie depuis le coup d’Etat manqué du 15 juillet.
La purge se poursuit en Turquie, chaque jour plus importante. Depuis le putsch manqué du 15 juillet, 50 000 personnes ont été arrêtées, gardées à vue ou limogées. Après l’armée et la justice, ce « grand ménage » touche à présent l’enseignement : plus de 15 000 fonctionnaires du ministère de l’éducation ont été suspendus cette semaine.
Jeudi 21 juillet, les autorités ont prévenu qu’Ankara allait temporairement déroger à la Convention européenne des droits de l’homme pendant l’état d’urgence, que le président Recep Tayyip Erdogan a proclamé mercredi.
Pour Jean Marcou, chercheur spécialiste de la Turquie et enseignant à l’Institut de sciences politiques de Grenoble, on est passé en quelques jours de la « répression des putschistes à une intimidation de toute la société ».
En quelques jours, en Turquie, on a assisté à un coup d’Etat qui a échoué, une large purge, une instauration de l’état d’urgence. Quel sens donner à tous ces événements ? Que cherche à faire le président Recep Tayyip Erdogan ?
Cet après-coup d’Etat est tout aussi surprenant que la tentative de putsch en elle-même. On a senti tout de suite que la répression des putschistes allait être très dure : Erdogan a parlé du rétablissement de la peine de mort, il y a eu des séances de lynchage, et la direction des affaires religieuses a même refusé de pourvoir au service funéraire pour les putschistes.
Ce qui est impressionnant, c’est que, tout de suite, s’est embrayée une mécanique qui n’est même pas seulement une purge, mais une forme de reformatage de l’Etat. Il y a actuellement 50 000 fonctionnaires frappés par des licenciements, des suspensions ou des arrestations – ce qui est énorme – et on a demandé aux fonctionnaires de mettre fin à leurs congés d’été pour rejoindre leur poste.
Dans les universités, tous les doyens doivent démissionner, avant qu’on décide si on les confirme ou on les remplace. Trois mille juges ont été suspendus et deux juges de la cour constitutionnelle arrêtés, c’est du jamais-vu.
Intérieur, justice, éducation nationale, affaires sociales : presque tous les ministères sont touchés par des réaffectations ou des sanctions. Qui va effectuer le travail de tous ces fonctionnaires, des 3 000 juges ? On sent bien qu’on est dans une période d’exception.
Quand on met en place l’état d’urgence, il y a bien l’idée de créer une situation de crise prolongée. Les autorités brandissent l’argument qu’il y a encore des risques de coup d’Etat. Donc, pour éliminer ce risque, il faut non seulement écarter les putschistes, mais aussi les putschistes potentiels, et même ceux qui ne sont pas d’accord avec ce que l’on fait. On passe d’une répression des putschistes à une intimidation de toute la société.
La thèse d’un coup d’Etat échafaudé par le pouvoir pour mieux écarter des opposants peut-elle être totalement exclue ?
Je suis très prudent à l’égard des théories complotistes. Mais il est intéressant que cette théorie existe, car elle révèle la situation très favorable dans laquelle se trouve Erdogan. Elle a commencé à démarrer quand le coup d’Etat a échoué : on s’est alors dit que cet échec le servait tellement que c’était peut-être lui qui avait provoqué le putsch.
Je pense plutôt que l’AKP d’Erdogan (Parti de la justice et du développement, islamo-conservateur) se préparait à une telle situation. L’AKP et Erdogan ont toujours été très opportunistes, ils savent profiter de ce genre de situation.
De plus, l’AKP connaît très bien les gülenistes [du nom de Fethullah Gülen, qu’Erdogan accuse d’avoir fomenté le putsch raté] parce qu’elle a travaillé avec eux, ils ont été alliés jusqu’en 2010. Donc la répression a pu être mise en place très vite.
En revanche, on sait maintenant que le gouvernement a été informé plusieurs heures avant que le coup d’Etat ait lieu. Je pense qu’il l’a laissé se développer, probablement pour pouvoir mieux l’écraser le moment venu.
Une opposition au mouvement auquel on assiste est-elle possible ?
Ce coup d’Etat, qui profite à Erdogan, a mis tout le monde en porte-à-faux, et notamment l’opposition, parce qu’elle ne pouvait pas approuver le coup d’Etat et était obligée d’appeler à la défense de l’ordre constitutionnel. D’une certaine manière, elle s’est alors placée, qu’elle le veuille ou non, du côté d’Erdogan. On est dans une situation où l’opposition ne peut plus s’opposer. D’autant qu’Erdogan continue de dire qu’il y a toujours une menace de putsch.
Au-delà des partis, de larges pans de la société ont dénoncé le putsch : les associations d’entrepreneurs, les syndicats, les organisations religieuses, les intellectuels, les chanteurs et même les médias. Cette unanimité me paraît malsaine, c’est une situation perverse et dangereuse. Dans ce contexte, il va être très difficile de faire entendre un avis différent.
Depuis le putsch raté, de nombreux rassemblements ont lieu pour soutenir Erdogan. Sont-ils réels, populaires ? Ou constituent-ils une mise en scène du pouvoir ?
Un peu des deux. Il ne faut pas oublier qu’Erdogan a gagné toutes les élections depuis 2002 – le seul revers qu’il a connu, c’est en juin 2015 quand il a perdu sa majorité absolue. Et il a l’habitude de mobiliser ses partisans.
Mais il y a une forte polarisation en Turquie : une moitié de la population soutient Erdogan, l’autre moitié est critique, voire carrément hostile. L’idée d’Ergogan, aussi, dans cette situation exceptionnelle, est d’obtenir « le référendum de la rue », qui va lui permettre de passer outre certains obstacles légaux ou constitutionnels. Il est en train de créer un climat de tension qui vise à transformer la Turquie de fond en comble.
Comment envisagez-vous la fin de cette période ?
Elle va peut-être être consacrée par des réformes institutionnelles importantes, comme l’installation de la présidentialisation. Pour l’instant, seul le Parlement empêche Erdogan de mettre en place un régime présidentiel : il faut 376 voix pour modifier la Constitution, et l’AKP n’a que 317 sièges. Erdogan va peut-être essayer de convaincre des députés, en leur rappelant que la Constitution actuelle est issue du putsch de 1980 et qu’elle doit être modifiée pour qu’il n’y ait plus de coup d’Etat.