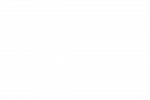Gabon : les paradoxes d’une dictature « soft »

Gabon : les paradoxes d’une dictature « soft »
Le système de redistribution de la richesse est aujourd’hui en panne dans ce petit pays d’Afrique centrale dont la stabilité est menacée.
Dimanche 28 août, le candidat de l’opposition unie, Jean Ping (73 ans) déclare avoir gagné l’élection présidentielle. Libreville s’enferme dans une attente inquiète. Les magasins sont fermés et les rues désertes. Mercredi soir 31 août, le président sortant, Ali Bongo (57 ans), crie victoire. Le résultat a été officiellement annoncé quelques heures auparavant par la Commission électorale nationale autonome et permanente (Cénap). Bongo a une faible avance : 49,80 % des voix contre 48,23 % pour Jean Ping, soit 5594 votes sur 627,805 inscrits.
À l’annonce de cette victoire, la rue gabonaise s’enflamme. À Libreville et Port-Gentil, les deux villes principales, des manifestants improvisent des barrages de route et mettent le feu à l’Assemblée nationale. Le lendemain, jeudi 1er septembre, la rumeur fait état d’une attaque du QG de Jean Ping par la garde républicaine, un corps d’élite chargé de la protection du président. La police et de l’armée sont dans la rue. Vendredi 2 septembre, on décompte alors trois morts et plus d’un millier de manifestants et pillards en état d’arrestation.
Les évènements semblent un rejet des manifestations et de la grogne exprimées en 2009 après l’élection d’Ali Bongo à la présidence. À cette date, Ali Bongo était déjà passé en force. Fils du président sortant, il est soupçonné d’être le fossoyeur du système de parrainage inauguré par de Léon Mba, premier président du Gabon, envers de méritants dauphins politiques. Avec Ali, on passe à un système ouvertement dynastique. L’embrasement actuel montre que malgré sept ans au pouvoir, le fils d’Omar Bongo n’a pas convaincu.
Sur le papier, le Gabon peut paraître insignifiant : 1,6 million d’habitants seulement contre 23 millions au Cameroun voisin. Mais avec de riches ressources (pétrole, manganèse, uranium et bois), ce petit pays est resté un bastion de stabilité en Afrique centrale, une région minée par la guerre et les violences sociales.
Depuis l’indépendance (1960), le Gabon n’a pas quitté l’orbite de l’ancien pouvoir colonial. Liens économiques avec la France, présence militaire, loyauté diplomatique et clientélisme n’ont fait que croître et embellir, même après les secousses de la libéralisation politique de 1990 et le renforcement de l’opposition, vite maté à l’époque par Omar Bongo.
Plus récemment, l’éclatement de brefs scandales médiatiques sur les propriétés du personnel politique gabonais en France, ou sur les « crimes rituels » que commanditerait la classe politique, loin de signaler une rupture, démontre l’imbrication des intérêts entre les classes dirigeantes des deux pays.
En 2009, lorsque la France soutient la candidature d’Ali Bongo, les milieux bien informés murmurent que le choix se justifie par la nécessité de ne pas voir l’ex-empire éclaboussé par les dossiers secrets et explosifs qu’aurait laissé Omar Bongo au Palais du bord de mer.
Pourtant même si, en 56 ans d’existence, la jeune nation n’a connu que deux présidents élus avant Ali (Léon Mba : 1960-1967, Omar Bongo :1968-2009), les démocraties occidentales ont continué, bon an, mal an, de fréquenter le régime. Malgré le népotisme et le contrôle des prébendes par l’État, le Gabon reste une dictature soft. Deux raisons principales à cela : la politique gabonaise repose d’abord sur un système d’équilibre régional qui lui a évité les sanglants conflits ethniques de ses voisins. Deuxièmement, la classe politique a longtemps réussi à étouffer l’opposition dans l’œuf en redistribuant régulièrement les miettes du gâteau national.
L’union nationale à la Bongo
Sous Omar Bongo, le contact entre base électorale et politiques fonctionnait en effet sur un système flexible dit d’« union nationale ». Il reposait sur la cooptation par l’appareil d’État de fonctionnaires et politiques venus de tous les coins du pays. Pendant sa longue présidence, Bongo eut soin de s’entourer de cabinets savamment composés de représentants de la plupart des ethnies et régions du pays, et d’opposants qu’il réussissait à convaincre de collaborer.
Lui-même originaire du Haut Ogooué (Franceville), Bongo appartient à une ethnie (Téké) largement minoritaire au Gabon. Dans un pays où moins de deux millions d’habitants parlent plus de cinquante langues différentes, ce système de gouvernement proportionnel et d’union nationale rassure les Gabonais, qu’ils soient supporters ou adversaires du régime. Seuls les Fang ont un relatif avantage démographique avec environ 35 % de la population, mais ils cristallisent contre eux des peurs de domination des autres composantes du pays.
Ce multiculturalisme politique, sous les traits du pater familias entouré des enfants de toutes les provinces, anime également la vie quotidienne et les médias. Il agit au rebours des discours modernisants et répressifs de ses voisins, où les questions tribales ont longtemps été bannies du discours public pour mieux exploser en guerres politico-ethniques. Saupoudrée de marketing et d’animation folklorique, la fierté ethnique opère à tous les niveaux. Les candidates au concours annuel de « Miss Gabon », par exemple, doivent défiler dans le costume de leur ethnie à la grande joie de leurs supporters locaux. Mais la fierté d’être gabonais, ou « originaire » comme on dit, s’appuie sur une lourde xénophobie vis-à-vis des étrangers, surtout immigrants pauvres nombreux à travailler dans l’industrie minière et le commerce.
La deuxième clé de la longévité du système politique gabonais tient aux innombrables canaux de redistribution qui tempèrent la rapacité des « grands », surnom familier des dirigeants politiques. Le PDG (Parti démocratique gabonais), au pouvoir, maîtrise ces réseaux à travers ses branches locales. Les partis d’opposition adoptent les mêmes tactiques. Tous participent par exemple aux « distributions » ou « donations » de médicaments, argent, nourriture et vêtements aux « populations locales » (sic) lorsqu’ils sont en tournée dans les provinces : tout un vocabulaire hérité de « la coloniale », comme on dit au Gabon.
En période de campagne électorale, ces donations quasi quotidiennes sont retransmises sur la télévision nationale. On y voit les bienfaiteurs accueillis par une foule joyeuse et les danses de bienvenue des associations féminines locales. En contrepartie, les donateurs espèrent les votes de leurs protégés. Le système signifie que rente minière et pétrolière ne revient au commun des Gabonais que selon le bon vouloir d’une classe politique qu’on somme de se montrer généreuse et ostentatoire (un style politique très prisé au Gabon), mais qui reste imprévisible. La relation de dépendance est renforcée par le cercle vicieux du marasme des infrastructures de base et des équipements sanitaires, économiques, scolaires et médicaux qui manquent partout, ou ne fonctionnent pas.
Un pays riche, une population pauvre
Un cas banal est celui de ces hôpitaux de Libreville où les salles d’attente engorgent de malades soumis à des cautions de 300 000 francs CFA (environ 450 euros) ou plus, conditionnant toute prise en charge médicale. Le prétexte est que le personnel soignant manque de tout. Dans les grandes villes le nombre d’écoles maternelles et élémentaires privées explose, conséquences de la décomposition de l’enseignement public. L’eau et l’électricité sont victimes de coupures quotidiennes. La poste ne marche pas. Dans un pays grand comme la moitié de la France, le réseau routier compte 9 000 km de routes (contre 950 000 km dans l’hexagone), dont à peine 20 % est goudronné, condamnant à l’isolement une large partie de la population rurale (42 %).
Ali Bongo n’a pas réussi à inverser la tendance. Lancée en 2011, la campagne d’Ali Bongo et de son épouse Sylviane pour « Le Gabon émergent », censé transformer le pays « en moins d’une génération » a fait long feu.
Le Gabon est resté un pays riche avec une population pauvre. Alors que le PIB est parmi les premiers d’Afrique, avec environ 10 0000 dollars par habitant, le désemploi, la faiblesse des infrastructures bancaires, l’insécurité économique et l’absence de perspectives d’avenir constituent l’expérience quotidienne de la majorité des Gabonais. Avec la chute du prix du pétrole à partir de l’été 2014, le marasme a fortement augmenté. Les investissements publics, déjà insuffisants, se sont réduits.
C’est dans un contexte de mécontentement populaire exacerbé que l’élection présidentielle s’est jouée cet été.
Des élections sous contrôle
Depuis l’époque coloniale, l’État a la mainmise sur le système électoral. Bien que les résultats des vainqueurs restent modestes comparés à certains régimes africains, les candidats cooptés par le pouvoir bénéficient d’un appareil bien rôdé. Les présidentielles de 2016 en sont un excellent exemple. La date exacte des élections à venir (27 août) n’a été annoncée par la Commission nationale électorale (Cenap) que le 6 juin dernier. Les candidats ont eu à peine de déposer leurs candidatures avant la date butoir du 12 juillet. La Cenap a ensuite fixé l’ouverture officielle de la campagne au 13 août, soit 14 jours avant le vote.
Entre-temps c’est le gouvernement qui est chargé de recenser les électeurs et d’imprimer les nouvelles cartes qui devront être présentées lors du vote. On imagine les prétextes à favoriser les électorats fidèles, et écarter les récalcitrants.
En 2009, l’élection controversée d’Ali Bongo se déroule selon une logique dynastique qui semble rompre avec l’ancienne tradition du « parrainage » inauguré par Léon Mba dans les années 1960 pour son dauphin Omar Bongo. Pourtant Ali Bongo peut aussi compter, paradoxalement, sur un statut d’outsider-insider. Ses origines obscures (la rumeur veut qu’il ait été adopté au Nigeria par Omar et sa première femme) ont l’avantage de faire croire qu’il devrait, comme ses prédécesseurs, gouverner avec toutes les composantes du pays.
Mais depuis son arrivée au pouvoir, Ali Bongo a préféré, aux dosages ethniques et partisans de son père, la loyauté d’un cercle plus restreint d’hommes de confiance. L’ancien équilibre régional et politique s’est affaibli. D’où la popularité du slogan de la campagne de Jean Ping : « C’est dosé ». En clair : avec Ping comme président, le Gabon reviendra à la bonne vieille cooptation « de papa » et à ses bienfaits. Jean Ping lui-même, produit de la génération d’Omar Bongo, incarne la nostalgie des plus âgés pour la décade de prospérité économique qu’a connu le Gabon entre 1990 et 2002.
Ancien pilier du sytème Omar Bongo, Jean Ping est désormais le chef de file de l’opposition à Ali Bongo. | MARCO LONGARI / AFP
Le parcours de Jen Ping ressemble d’ailleurs à celui de feu Omar Bongo : fils d’un commerçant chinois et d’une femme d’Ombooué (Sud), il occupe lui aussi la position « présidentiable » d’une minorité ethnique. Cacique du pouvoir et brillant serviteur de l’État, il a une réputation de frugalité – dans ces temps de crise, elle apparaît comme une promesse de lutte contre la corruption des « grands ».
Enfin, Jean Ping peut se targuer d’une carrure internationale que n’avaient ni Omar Bongo ni son fils. Secrétaire général de l’Union africaine de 2008-2012. C’est justement cette carrière internationale qui a jeté la graine de la discorde entre Ping et Ali Bongo. En 2012, lorsqu’il n’est pas renouvelé à la tête de l’Union africaine, Jean Ping se plaint de n’avoir pas été soutenu par son gouvernement, et par Ali Bongo. En 2014, la rupture entre les deux hommes est totale.
Que va-t-il se passer ?
Si la tourmente actuelle rappelle le scénario de 2009, le mécontentement populaire est plus fort. Peu d’espoir reste, même parmi les supporters d’Ali Bongo, que celui-ci puisse véritablement engager les réformes nécessaires au pays. Du côté de l’opposition, des tendances lourdes sont à prendre en compte. L’opposition gabonaise est historiquement faible, mal organisée, et souvent prête à pactiser avec le pouvoir. Ses dirigeants restent avant tout des politiciens du sérail et des technocrates sans véritable assise populaire. C’est le cas de Jean Ping lui-même, ou de ses alliés de dernière minute pendant la campagne : Casimir Oyé Mba, ancien premier ministre d’Omar Bongo, et Nzouba Ndama, ancien président de l’Assemblée nationale.
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que depuis 1960, aucun mouvement d’alternance ne soit vraiment apparu au Gabon. Reste la pression de la rue ou le coup d’État. Celui perpétré contre Léon Mba en 1964 a été réprimé dans le sang. On voit mal aujourd’hui comment les molles protestations internationales de ces derniers jours, de Ban Ki Moon à François Hollande, convaincront Ali Bongo de mettre en péril sa réélection en ordonnant le recomptage des votes. Mais le Gabon, « pays où il ne se passe jamais rien », selon la « radio-trottoir » locale, peut toujours surprendre.
Florence Bernault, professeur, University of Wisconsin-Madison. Cet article a d’abord été publié par The Conversation.