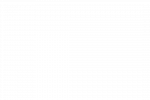L’Ethiopie entre croissance à marche forcée et répression

L’Ethiopie entre croissance à marche forcée et répression
Par Emeline Wuilbercq (contributrice Le Monde Afrique, Addis-Abeba)
Addis-Abeba veut entrer dans le club des pays à revenus intermédiaires d’ici à 2025, quitte à spolier une partie de sa population au profit d’investisseurs étrangers et à étouffer toute contestation.
La famine « biblique » des années 1980 semblait indélébile dans la mémoire collective. Pourtant, l’Ethiopie a réussi l’exploit de se transformer en « tigre africain » aux yeux de l’Afrique et du monde. Fort d’une croissance insolente sur la dernière décennie – le Fonds monétaire international l’estime à 6,5 % en 2016 – le gouvernement éthiopien mène depuis un quart de siècle une politique de développement à marche forcée. Mais celle-ci est de plus en plus critiquée par la population, qui manifeste régulièrement contre les autorités depuis près d’un an malgré une répression sanglante des autorités. Explications.
Qui manifeste ?
Ce sont d’abord les Oromos, l’ethnie la plus nombreuse d’Ethiopie qui représente un bon tiers de la population, qui ont manifesté dès novembre 2015 contre un projet d’agrandissement de la capitale Addis-Abeba, située géographiquement au cœur de la région Oromia. Ils accusaient le gouvernement d’expropriations de leurs terres au profit d’investisseurs étrangers et de potentats locaux.
Les autorités ont renoncé en janvier à ce plan controversé, mais les Oromos ont continué de manifester contre le pouvoir central. Le mouvement a pris de l’ampleur lorsque les Amharas – plus d’un quart de la population – sont à leur tour descendus dans la rue. En août, des manifestations ont eu lieu simultanément dans les deux régions Amhara et Oromia, ainsi qu’à Addis-Abeba. D’autres foyers de contestation ont éclos à travers le pays, notamment en pays Konso, dans le sud. La répression de ces manifestations, qui durent depuis plus d’un an, aurait causé la mort de plus de 800 personnes, selon Amnesty International.
Quelles sont les raisons de la colère ?
Le plan d’extension de la capitale éthiopienne a jeté de l’huile sur le feu, mais les griefs à l’encontre du gouvernement sont multiples. La question de l’expropriation des terres est centrale. Pour mener à bien sa politique d’industrialisation et entrer dans le club des pays à revenus intermédiaires d’ici à 2025, Addis-Abeba est prêt à tout pour attirer les investisseurs en leur proposant des exemptions fiscales ainsi que la location d’hectares de terres à moindre coût. Quitte à se les approprier sans offrir de compensations financières adaptées aux populations : 150 000 fermiers oromos auraient ainsi été chassés de leurs terres depuis dix ans.
La population nourrit également une hostilité grandissante à l’égard des Tigréens. Oromos et Amharas se sentent marginalisés et critiquent la mainmise du Front de libération des peuples du Tigré (TPLF), qui constitue la base politique de la coalition au pouvoir depuis le renversement de la dictature militaire de Menguistu Hailé Mariam en 1991. Les Tigréens – qui ne représentent que 6 % de la population éthiopienne – sont accusés de monopoliser les postes-clés au sein du gouvernement, de l’administration et des services de sécurité.
La colère du peuple s’explique aussi par la violence des forces de l’ordre qui ont brutalement réprimé les manifestations. En août, pancartes et slogans des protestataires dénonçaient les arrestations arbitraires, l’autoritarisme et le manque de démocratie.
Pourquoi la communauté internationale a tardé à réagir ?
Une seconde, c’est le temps qu’il a fallu à Feyisa Lilesa pour placer le curseur médiatique sur la colère des Oromos. En août, lors des Jeux olympiques de Rio, le marathonien éthiopien a franchi la ligne d’arrivée en croisant ses deux bras au-dessus de la tête. Un geste fort symbolisant la rébellion de son ethnie qui n’avait jusqu’alors reçu que peu d’écho auprès de la communauté internationale, malgré des mois de contestation.
Pourquoi ? L’Ethiopie est un allié stratégique de l’Occident dans la lutte contre le terrorisme dans la région. La visite du président américain Barack Obama en juillet 2015, ainsi que l’élection de l’Ethiopie en juin 2016 en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, sont autant de preuves de son influence croissante sur la scène internationale. Dans une Corne de l’Afrique minée par les conflits, elle fait figure de puissance quasi intouchable et difficile à froisser. La communauté internationale a toutefois exprimé son inquiétude après l’instauration, le 9 octobre, de l’état d’urgence. Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a exhorté les autorités éthiopiennes à « préserver les droits de l’homme fondamentaux ».
Pourquoi l’état d’urgence a-t-il été instauré ?
Le gouvernement a décrété l’état d’urgence pour six mois afin de « rétablir la paix et la sécurité », compte tenu des « récentes perturbations, des violences et des activités illégales » sur son territoire. L’élément déclencheur a été le drame de Bishoftu qui s’est déroulé une semaine plus tôt. Dans cette localité du sud-est de la capitale, une bousculade meurtrière a fait au moins 55 morts selon le gouvernement, beaucoup plus selon l’opposition. La charge émotionnelle de cet événement et la rage des Oromos ont provoqué de violents heurts dans la région Oromia qui ont atteint la capitale Addis-Abeba, où une ressortissante américaine a été tuée le 5 octobre par un jet de pierres. Des entreprises locales et étrangères ont aussi été la cible de manifestants et de pillards en pays oromo.
Le gouvernement a donc durci sa politique : des mesures restrictives ont été mises en place, parmi lesquelles l’interdiction de manifester, un couvre-feu pour des usines, des fermes et des institutions gouvernementales et une limitation des déplacements, notamment pour les diplomates qui ne peuvent aller au-delà d’un périmètre de 40 km autour de la capitale. Les autorités ont par ailleurs reconnu avoir procédé à l’arrestation de plus de 1 500 personnes depuis l’instauration de l’état d’urgence.
Les Ethiopiens ont également l’interdiction, sous peine de prison, de contacter des groupes considérés comme terroristes par le gouvernement, dont le Front de libération Oromo (OLF) et le groupe armé Ginbot 7. « Ces mesures d’exception sont d’une grande sévérité et leur champ d’application est si vaste qu’elles menacent des droits fondamentaux qui ne doivent pas être restreints même sous l’état d’urgence », a déclaré Muthoni Wanyeki, directrice régionale pour l’Afrique de l’Est, la Corne de l’Afrique et les Grands Lacs à Amnesty International.
Que fait l’opposition ?
Elle existe, mais n’est pas représentée au Parlement. Lors des élections générales de mai 2015, la coalition au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (EPRDF), a remporté tous les sièges, récupérant le seul que détenait l’opposition depuis le précédent scrutin, cinq ans plus tôt. En 2005, des élections aux résultats contestés s’étaient soldées par des violences et la mort de 200 personnes. Les partis de l’opposition avaient alors refusé de siéger au Parlement. Depuis, ces derniers sont désorganisés pour certains observateurs, muselés pour d’autres. De nombreux militants ont choisi l’exil, surtout aux Etats-Unis. Leur influence est notable sur les réseaux sociaux, où ils dénoncent violemment les errements démocratiques de l’EPRDF.
De leur côté, les organisations de défense des droits humains ne cessent de tirer la sonnette d’alarme au sujet des arrestations arbitraires de dissidents et des restrictions des libertés politiques. Ces dernières risquent d’être menacées par l’état d’urgence. Depuis le 9 octobre, il est illégal de s’informer et de diffuser sur les réseaux sociaux les informations de deux médias d’opposition basés aux Etats-Unis : Ethiopian Satellite Radio and Television (ESAT) et Oromo Media Network (OMN). Les partis politiques ont également l’interdiction de faire des déclarations à la presse pouvant inciter à la violence.
Quid des réseaux sociaux ?
La fracture numérique de l’Ethiopie était déjà inquiétante avec seulement 3,7 % d’Ethiopiens connectés selon la Banque mondiale, et l’une des connexions les plus onéreuses de la planète. Mais l’accès à l’information sur le Web est de plus en plus difficile depuis près d’un an. C’est le cas depuis près de trois semaines dans la majeure partie du pays, y compris la capitale, où l’Internet mobile est coupé et les réseaux sociaux sont inaccessibles sans réseau privé virtuel (VPN). Cette opération de blocage est facilitée par le monopole de l’entreprise d’Etat Ethio Telecom, qui contrôle les télécommunications. Le gouvernement éthiopien se serait même doté il y a quelques années de logiciels sophistiqués venus de Chine et d’Europe pour surveiller les actions virtuelles de sa population sur le territoire et à l’étranger, selon un rapport de Human Rights Watch. Facebook et Twitter sont les principaux relais des militants et des opposants politiques, notamment ceux de la diaspora.
Peu après le drame de Bishoftu, ces derniers avaient appelé à « cinq jours de colère » sur les réseaux sociaux. « La coupure de l’Internet ne rétablit pas l’ordre, dénonce Ephraïm Percy Kenyanito, du groupe de défense des droits numériques AccessNow. Elle entrave l’activité journalistique, masque la vérité sur le terrain et empêche les gens d’obtenir les informations nécessaires à leur sécurité. » Elle fait également du tort à l’économie locale : selon une récente étude de l’institution Brookings, une seule coupure de l’Internet entre juillet 2015 et juin 2016 aurait déjà coûté plus de 8,5 millions de dollars (7,8 millions d’euros) à l’Ethiopie.