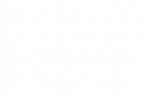Le commando au service de Donald Trump

Le commando au service de Donald Trump
Par Gilles Paris (Washington, correspondant)
Le magnat de l’immobilier a préféré se fier à son instinct et s’est appuyé sur un réseau d’outsiders plutôt que sur un conglomérat de consultants politiques.
Un s+énateur quasi inconnu de l’Alabama, un ancien maire de New York, un gouverneur du New Hampshire englué dans un scandale de pont fermé pour embarrasser un adversaire politique, un ancien speaker de la Chambre des représentants que son activisme avait contraint il y a longtemps à une retraite anticipée, telle est l’équipe qui s’est portée au printemps aux côtés d’un outsider vomi par l’establishment républicain.
Inutile de rappeler que cet attelage faisait pâle figure face aux grands noms du Parti démocrate : Barack et Michelle Obama, Joe Biden ou Bill Clinton.
Jeff Sessions, Rudy Giuliani, Chris Christie et Newt Gingrich ont été les porte-voix de Donald Trump lorsqu’il était tenu à distance par les cadres du Grand Old Party (GOP). Un investissement dont le retour promet d’être exceptionnel tant l’adversité a dû resserrer les liens entre eux, face aux autres familles républicaines, face aux démocrates et face à des médias avec lesquels les relations ont été de plus en plus conflictuelles.
Mais cette équipe de chevaux de retour et d’espoirs déçus ne constitue que la vitrine officielle du « mouvement » mis en branle par le magnat de l’immobilier. L’un de ses horlogers est resté plus discret pendant la campagne qu’il avait rejointe officiellement le 17 août. Il s’agit de Stephen Bannon, l’ancien patron du Breitbart News, site politico-trash rebaptisé Trumpbart News par ses détracteurs pour sa constance à défendre M. Trump.
Bannon, « Leni Riefenstahl du Tea Party »
Cette alliance est celle d’outsiders tout à leur ivresse de pouvoir poser leurs pieds sur le bureau du GOP sans se soucier d’en rayer le vernis délicat. Le sens commun que le milliardaire se vante d’incarner aurait voulu qu’il essaie de séduire, une fois sa nomination acquise, au-delà du cercle des convaincus, pour espérer l’emporter le 8 novembre face à la démocrate Hillary Clinton. Mais M. Trump a préféré se fier à son instinct et s’est rapproché au contraire d’un chef de commando plutôt que d’un conglomérat de consultants politiques.
Andrew Breitbart, le fondateur du site, avait encensé, avant sa mort, M. Bannon, le qualifiant de « Leni Riefenstahl du Tea Party » pour ses documentaires très engagés. Glen Beck, qui fut sur Fox News le héraut du même mouvement avant de tourner casaque pendant la campagne, l’a qualifié autrement plus méchamment de « Goebbels ».
Au départ, rien ne prédisposait à ce destin ce fils de « cols-bleus » passé successivement par Harvard, la Navy et Goldman Sachs. Lorsqu’il se lance dans le cinéma comme producteur exécutif, en 1991, c’est au côté de Sean Penn pour un film, Indian Runner, inspiré d’une chanson de Bruce Springsteen. Autrement dit des figures du camp d’en face.
On est très loin, alors, du documentaire hagiographique consacrée à l’ancienne candidate républicaine à la vice-présidence, Sarah Palin, vingt ans plus tard. Mais Andrew Breitbart avait également débuté dans l’écosystème numérique sous la bannière libérale du Huffington Post avant de s’engager dans les rangs conservateurs.
« Breitbart Embassy »
Moins d’une décennie plus tôt, en 2007, le partenariat entre Andrew Breitbart et Stephen Bannon s’était fondé sur un projet similaire de guerre à double front : la dénonciation de la direction républicaine comme de l’emprise intellectuelle et médiatique du camp libéral (la gauche démocrate) que Fox News commence à écorner, de même que certains animateurs de talk shows.
La mort brutale du fondateur du site iconoclaste, en 2012, va propulser son bras droit à la tête de la « Breitbart Embassy », cette maison de style néocoloniale proche du Congrès, à Washington, qui tient lieu de quartier général aux spadassins de cette machine de guerre.
Pour parvenir à leurs fins, les deux hommes avaient en effet la même conviction : tous les coups sont permis. Lorsque le sénateur démocrate Ted Kennedy décède en 2009, Breitbart se fend d’une oraison lapidaire : « Repose à Chappaquiddick ». Une allusion délicate à la part d’ombre du disparu : son comportement erratique après l’accident de voiture qu’il avait provoqué en 1969 et dans lequel une jeune assistante avait été tuée et qui avait pesé sur ses ambitions politiques. M. Trump y fera allusion pendant la campagne pour stigmatiser les mœurs démocrates.
Arme de guerre électorale
Le site peut alors se flatter de plusieurs succès frappés de sa marque : la démission du représentant de New York Anthony Weiner, époux d’une fidèle de Hillary Clinton, Huma Abedin, après la divulgation de photos suggestives ; la faillite d’une ONG défendant les classes défavorisées militant pour l’inscription sur les listes électorales après la diffusion de vidéos controversées enregistrées en caméra cachée ; la démission, enfin, d’une responsable du département de l’agriculture après la diffusion d’extraits tronqués d’un de ses discours. Un style annonciateur de la campagne à venir de M. Trump.
Derrière Breitbart News, on retrouve un autre milliardaire, mathématicien de talent devenu le gestionnaire avisé d’un fonds spéculatif, Robert Mercer, épaulé par sa fille Rebekah. Aussi passionné par le débat politique que le richissime David Koch, un compagnon de route des libertariens, ce dernier dispose d’une arme de guerre électorale avec la société Cambridge Analytica, spécialisée dans le traitement des données.
Ce n’est pas un hasard si une autre proche des Mercer avait rejoint l’équipe de Donald Trump : Kellyanne Conway, une experte des sondages qui allait tenter de canaliser le milliardaire. Et enrichir la vitrine d’un trumpisme en marche.