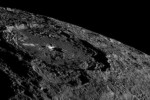« Le Gang des Antillais » ou l’histoire vraie d’un groupe de braqueurs des années 1970

« Le Gang des Antillais » ou l’histoire vraie d’un groupe de braqueurs des années 1970
Propos recueillis par Gladys Marivat (contributrice Le Monde Afrique)
Rencontre avec Jean-Claude Barny et Sébastien Onomo, réalisateur et producteur d’un « thriller nègre » qui a l’ambition de divertir et de « conscientiser ».
Adaptation du roman autobiographique de Loïc Léry, Le Gang des Antillais lève le voile sur deux histoires oubliées mais étroitement liées. La petite histoire d’abord, celle d’une bande d’Afro-Antillais qui ont braqué des bureaux de poste et une banque à Paris à la fin des années 1970. La grande histoire ensuite, celle des dizaines de milliers d’Antillais et de Réunionnais arrivés dans l’Hexagone entre 1963 et 1981 via le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer (Bumidom).
Créé par Michel Debré, ce bureau a organisé la venue de plus de 70 000 ultramarins de condition modeste en leur promettant un travail et une vie meilleure, mais pas de billet retour. L’épisode est controversé, comme d’autres pages oubliées de l’histoire de France. Confrontés au racisme, les migrants ont été embauchés à des tâches subalternes. Le gang des Antillais est né dans ce contexte. Désireux de faire un travail de mémoire par le cinéma, le réalisateur Jean-Claude Barny (Nèg maron, Tropiques amers) et le producteur Sébastien Onomo nous ont raconté la genèse de leur « thriller nègre ».
Pourquoi raconter l’histoire du gang des Antillais ?
Jean-Claude Barny Ma mère est antillaise, elle est arrivée en France dans les années 1960 avec le Bumidom. L’avoir vu travailler si dur tout en étant confrontée au racisme, cela m’a donné envie de témoigner de ce qu’ont vécu les Antillais. Dans tous mes films, j’essaie de réparer cet oubli.
Sébastien Onomo C’est une histoire méconnue mais qui appartient à l’histoire de France. Savoir d’où l’on vient, c’est savoir où l’on va, tous ensemble. On sait qu’il y a un certain nombre de clichés sur les Antillais qui travaillent dans les hôpitaux ou à La Poste. En fait, tout cela a été organisé par l’Etat. Les minorités qui composent la diversité de la France ne sont pas arrivées en un claquement de doigts. Il y a quelque chose de plus complexe derrière.
C’est ce que montre la séquence d’archives au début du film ?
J.-C. B. Un jour, j’ai entendu à la radio ou à la télé Nadine Morano dire : « La France est un pays de race blanche. » Elle citait de Gaulle ! J’ai d’abord été choqué, et puis je suis parti à la recherche d’archives. J’ai trouvé cette phrase du général de Gaulle qu’il prononce en 1964 lors d’un voyage aux Antilles. Devant la foule en liesse, il s’écrit : « Mon Dieu que vous êtes français ! » Quand je place cette archive au début du film, ce n’est pas cynique. J’y crois. Mais je ne suis citoyen français qu’à condition qu’on intègre toutes les couleurs de la citoyenneté. Si on exclut une seule couleur, alors je ne suis plus citoyen français.
Pourquoi raconter l’histoire du Bumidom à travers celle d’un gang ?
J.-C. B. Les auteurs que j’aime ont toujours su parler de leur communauté tout en faisant des films de fiction. Martin Scorsese raconte l’immigration italienne aux Etats-Unis avec des films de gangsters. A travers un genre et l’histoire de sa communauté, il fait des films universels. Le Gang des Antillais est un thriller nègre qui raconte une histoire universelle : celle d’une communauté opprimée qui lutte pour sa liberté.
S. O. On parle d’une communauté qui se sent sous-représentée dans le cinéma français qui ne reflète pas la diversité réelle du pays. On a voulu faire un film « conscient ». Cette conscience qu’on peut retrouver dans certains films d’auteurs français. Mais il y a aussi une certaine dynamique proche de la « blaxploitation » et une modernité qu’on est allés chercher dans le cinéma de divertissement afro-américain. Nous sommes à la croisée de ces genres.
Comment s’est passée la production du film ?
S. O. Ça a duré six ans. On a commencé à tourner sans avoir tout le budget. On continuait à chercher de l’argent pendant la postproduction. Ce qui a été dur, c’était de convaincre les partenaires financiers de nous accompagner sur un type de films qui n’a pas d’autre équivalent en France. Cinq acteurs noirs dans les rôles principaux, un film qui n’est ni un film d’auteur, ni un film de divertissement grand public. Les partenaires voulaient nous faire basculer dans un genre ou dans l’autre. Mais basculer dans le film d’auteur, ça impliquait de se couper d’un public afro qui, certes, aime les films « conscients », mais a aussi besoin de divertissement. Basculer dans un film purement d’action, c’était nier le besoin d’une communauté de se reconnaître dans des films où on les met en valeur. Il a fallu tenir notre ligne jusqu’au bout.
Vous dépeignez Loïc Léry et ses acolytes du gang des Antillais comme des militants qui ont financé les mouvements indépendantistes aux Antilles.
J.-C. B. Loïc Léry est pour moi un Robin des bois, quelqu’un qui a voulu déjouer le système et en a payé lourdement le prix. Le gang des Antillais n’a pas financé les indépendantistes. Ça fait partie du fantasme. J’ai voulu que cette image soit dans le film pour rendre concret l’engagement de Loïc Léry. Il a été considéré comme un malfrat, car on n’a pas réussi à faire de lui un antihéros comme Pierre Goldman ou la bande à Bonnot. Pourtant, il a milité contre un système injuste qui discriminait les Antillais sur le marché du travail et dans la société en général.
Votre film dénonce le racisme décomplexé qui régnait dans les années 1970. Mais il semble aussi nous parler de la France d’aujourd’hui...
J.-C. B. Aujourd’hui, il y a surtout des films français qui exploitent le Noir comme un objet insolite dans un milieu hostile. C’est ce que j’appelle le « phénomène Martine ». On nous montre le Noir à la plage, le Noir à la montagne… Et ça marche. Avec Sébastien, nous sommes dans un combat de désaliénation du cinéma français. Il faut reconstruire le regard que posent les Français sur nous. Quand François Fillon dit que « la colonisation est un partage de culture », je me sens insulté. Cette droite décomplexée a le pouvoir de « conscientiser » la population française à ses idées. Nous pouvons faire la même chose avec le cinéma.
Vous ne craignez pas qu’on vous reproche de culpabiliser les Français, d’attendre un acte de repentance ?
S. O. Non, car nous ne sommes pas manichéens. Dans notre film, il y a des gentils et des méchants chez les Blancs comme chez les Noirs. Après le visionnage du film, les gens nous disent : « Maintenant que je connais cette histoire, je comprends mieux certaines choses. » Le cinéma a participé à créer et à diffuser des clichés, il peut en défaire un certain nombre. Ne nous fions pas à ce qu’on nous a enseigné, ce n’est qu’une partie de l’Histoire. Et l’autre partie, celle des Noirs de France, du métissage, de la diversité culturelle, on ne nous l’enseigne pas et pourtant elle existe. Il faut la porter au grand jour pour engager un nouveau dialogue. C’est peut-être naïf, mais c’est ce que je crois.
J.-C. B. Ce problème de repentance, je pense que c’est un gimmick des partis politiques qui souhaitent fermer le débat. Mais si tu veux une unité nationale, il faut savoir qui est dedans. Il ne s’agit pas de faire acte de repentance, mais de faire un travail de mémoire. Le travail de mémoire, c’est prendre le tronc commun de l’histoire française et interroger les deux versions, celles du colonisateur et celle du colonisé. Tu les mets face à face et tu écoutes. C’est pour le bien du citoyen français et de l’Humanité.
Quel sera votre prochain film ?
J.-C. B. Un film sur Frantz Fanon et la guerre d’Algérie.
Le Gang des Antillais, un film de Jean-Claude Barny, d’après le roman de Loïc Léry (Caraïbéditions, 2016). Avec Djedje Apali, Eriq Ebouaney, Adama Niane, Vincent Vermignon et Zita Hanrot (1 h 30).