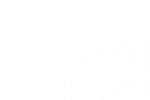La fabrique du club de l’élite républicaine

La fabrique du club de l’élite républicaine
Par Camille Stromboni
Derrière une analyse éclairante qui fait ressortir les contradictions du système français féru de méritocratie, l’ancienne directrice de l’ENS, Camille Stromboni avance cependant des pistes qui peuvent laisser sceptiques.
A l’heure où les discours contre les élites prospèrent, la philosophe Monique Canto-Sperber entrouvre la porte de la fabrique de cette élite qui n’en est plus une, viciée par un système qui fonctionne en vase clos. Tout comme l’école française, très inégalitaire, l’enseignement supérieur ne manque pas de défaillances derrière l’apparente méritocratie républicaine, pointe l’ancienne directrice de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, dans son dernier ouvrage.
La chercheuse puise dans la galerie des concepts politiques pour décrire cette machine enrayée. Si, selon une approche politique, l’oligarchie correspond à ce type de régime où gouverne un groupe restreint, de façon à servir ses intérêts, elle embrasse ici une signification plus large. Celle d’une « organisation sociale dans laquelle une ressource de pouvoir se trouve possédée de façon quasi exclusive par une fraction de la population, et lui permet d’exercer une influence considérable ».
Dans l’enseignement supérieur, c’est l’accès aux meilleures filières, soit les Polytechnique, Ecole normale et autres HEC ultrasélectives, qui constitue cette ressource de pouvoir, « dans la mesure où tous les étudiants, quels que soient leur milieu d’origine et leurs études secondaires, les considèrent comme dotées d’une réelle valeur ». Ce qui est loin d’être le cas dans d’autres voies d’études, comme l’université, marquée par l’échec en première année et une moindre considération.
Désormais, seul un groupe réduit y accède : les enfants de milieux aisés, de la grande, petite ou moyenne bourgeoisie, cultivés, éduqués dans le bon lycée, entourés de « bons » parents bien informés. Soit quelques dizaines de milliers de jeunes. Ce qui ne retire aucunement le mérite à ces étudiants qui réussissent des concours des plus ardus, mais ce mérite ne joue un rôle « qu’une fois réunies certaines conditions sociales et culturelles ».
Des chiffres éloquents
La chercheuse aligne une série de chiffres qui montre l’aggravation de la fermeture des filières les plus élitistes. Il y a trente ans, le recrutement des grandes écoles était deux à trois fois moins populaire que celui de l’université, il l’est aujourd’hui cinq à six fois moins, décrit-elle. Le taux de boursiers est passé de 25 % à 9 % dans le recrutement de quatre écoles prestigieuses (ENA, X, ENS, HEC) entre 1970 et 1990. En miroir inversé, la réussite des étudiants issus des milieux les plus défavorisés dans leurs études à l’université n’a cessé de diminuer, tandis qu’ils étaient de plus en plus nombreux à rejoindre l’enseignement supérieur.
Derrière cette analyse éclairante qui fait ressortir les contradictions du système français féru de méritocratie, l’ancienne directrice de l’ENS avance cependant des pistes qui peuvent laisser sceptiques, avec même, paradoxalement, une touche d’élitisme.
Celle qui a présidé aux destinées du pôle d’établissements de la montagne Sainte-Geneviève (Paris sciences et lettres) préconise de se concentrer sur le premier cycle, nœud du problème. Elle défend la nécessité d’un rapprochement des classes préparatoires – porte d’entrée aux grandes écoles – et de la licence universitaire. Non pas des institutions, comme l’a tenté en vain le gouvernement sous le quinquennat Hollande, mais des modèles de formations.
Du côté des classes préparatoires, cela passerait par le renforcement de l’initiation à la recherche, marque de fabrique de l’université, incontournable pour former une génération innovante à même de s’adapter au monde de demain. Pour l’université, en revanche, l’effort attendu serait d’une tout autre ampleur : afin de devenir aussi efficace et attractive que les prépas, à elle de s’adapter à tous en différenciant ses cursus pour coller aux différents profils d’étudiants, des meilleurs aux moins bons. « L’échec n’est pas dû au fait que les étudiants concernés ne sont pas capables de suivre l’enseignement qui leur est dispensé », ils le seraient si cet enseignement était « adapté à leur besoin », estime-t-elle. Reste à savoir comment… Monique Canto-Sperber avance l’idée de rendre plus généralistes les premières années universitaires.
Une vision à contre-courant
Une vision à contre-courant du ressenti de nombreux enseignants-chercheurs qui se disent démunis face à des étudiants qui n’ont tout simplement pas les prérequis pour suivre une formation universitaire. Avec notamment une difficulté insoluble face aux bacheliers professionnels, dont le bagage de formation ne donne quasiment aucune chance de réussite. Quid des BTS et DUT, où la réussite de ces jeunes est bien plus importante ? L’auteur n’en dit mot.
En revanche, pas question de toucher à la sélection à l’entrée des prépas et des grandes écoles, ou de leur demander de s’adapter aux différents profils de bacheliers. Et encore moins d’instiller la moindre goutte de sélection à l’entrée de l’université, puisqu’il est indispensable de former de plus en plus de jeunes. L’université absorbe environ 30 000 étudiants supplémentaires chaque année, et ce n’est que le début du boom démographique, mais la perspective d’un rééquilibrage des financements entre les différentes filières de l’enseignement supérieur ne figure pas non plus au rang des préconisations premières.
Finalement, c’est peut-être le prisme de départ, cette volonté, louable certes, de rouvrir à tous la fabrique de l’élite d’un pays démocratique, qui aboutit à des solutions moins convaincantes, quand l’urgence est de trouver un système de formation dans lequel chacun peut réussir et trouver sa place dans la société.
L’oligarchie de l’excellence, les meilleures études pour le plus grand nombre, Monique Canto-Sperber, PUF, parution le 11 janvier, 348 pages, 21 euros.