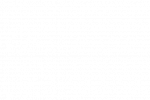Véronique Sanson : « On m’a enlevé ma mère, le vide est monstrueux »

Véronique Sanson : « On m’a enlevé ma mère, le vide est monstrueux »
Par Annick Cojean
L’artiste, qui a sorti un album fin 2016, vient d’être nommée aux Victoires de la musique 2017 dans les catégories artiste féminine de l’année et chanson de l’année. Elle remontera sur scène cet été.
Je ne serais pas arrivée là si…
… si je n’avais pas eu des parents musiciens. Pas des professionnels, de vrais mélomanes. Papa jouait du piano, maman de la guitare. Et lorsqu’on partait en vacances dans notre vieille 403, tassés sous les valises, on chantait, on chantait ! Des comptines, une foule de chansons populaires que maman connaissait, de grands airs classiques, un concerto brandebourgeois à quatre voix, vachement beau. Papa voyageait beaucoup pour son travail et rapportait des disques de partout. Il rentrait du Pérou ? « Venez écouter ça, les filles ! », disait-il avec gourmandise. Et on accourait découvrir ensemble des musiques du monde. Et du jazz, et du Gershwin, et du classique… C’était joyeux, naturel, délicieux.
Et un jour, ils vous ont mise au piano…
Le piano, c’était l’affaire de papa. Il avait formé un petit groupe inspiré de l’orchestre de Ray Ventura quand il était encore au lycée. Alors dès que j’ai eu 3 ou 4 ans, il m’a initiée. Il me prenait sur ses genoux et il guidait ma menotte pour des morceaux de jazz et « Sentimental Journey ». Pas évident, les touches noires, quand on a une toute petite main ! Puis j’ai pris des cours avec une prof et une répétitrice. Et comme j’ai beaucoup d’oreille, j’ai pu jouer très vite tout ce que j’entendais.
A vrai dire, je ne me souviens pas d’une époque de ma vie où je ne jouais pas de piano. En revanche, la guitare est venue beaucoup plus tard. Quand j’ai découvert Brassens et eu envie de le chanter à la guitare. J’ai alors demandé à maman, qui jouait du classique, de bien vouloir m’apprendre. Et très patiemment, sur sa vieille guitare espagnole, elle m’a appris comment faire un la mineur, un mi mineur, un fa, un sol, des septièmes…
Leur annoncer que vous vouliez consacrer votre vie à la musique a donc été facile ?
Mon père m’a dit : « D’accord, mais dans ce cas, tu devras être la première ! » Encore fallait-il que j’ai ce qu’il appelait un « bagage » et que je passe le bac. Il y en avait deux à l’époque. J’ai eu le premier mais j’ai raté le second, alors que nous étions pourtant en 1968, que c’était la chienlit, et qu’il n’y avait que l’oral ! Mais je me fichais bien de la philo. Michel Berger, avec qui je faisais déjà de la musique, me donnait des cours tout en me disant : « Mais qu’est-ce qu’on s’en fout de Bergson ! »
Et puis, grâce à des amis de mes parents, j’avais déjà enregistré un 45 tours au sein d’un trio éphémère, les Roche Martin, formé avec ma sœur Violaine et François Bernheim. Les deux sont partis en fac de droit, moi, je ne rêvais que de musique. Et la rencontre avec Michel, qui travaillait chez Pathé Marconi, a été déterminante. On ne s’en souvenait pas, mais nous nous étions croisés, très jeunes, dans des goûters d’enfants. Nos parents se connaissaient. Mon père avait même emmené Annette, sa mère, dans des bals très chics de l’époque.
Vous veniez donc d’un milieu bourgeois.
Très ! La famille de maman était extrêmement modeste et elle avait fait son droit grâce à des bourses, se payant même le luxe de passer de surcroît une petite licence de maths. C’était une éponge, maman. Elle lisait vite, retenait tout, avide d’apprendre. Une véritable encyclopédie ! Papa, lui, était issu de la grande bourgeoisie, notamment par la lignée hollandaise de sa mère, faite de banquiers archi à l’aise. Il était avocat, puis député UNR du 13e arrondissement pendant longtemps, rapporteur du budget…
Et j’ai vu défiler à la maison le gratin des hommes politiques de l’époque. Il ne concevait pas qu’on puisse ne pas s’intéresser à la politique. « C’est une philosophie de la vie, nous disait-il quand on était petites. Cela impacte vos libertés, votre façon de vivre. » Et quand on a été en âge de voter, il essayait de nous décrypter avec la plus grande impartialité possible la classe politique : « Celui-là, tu vois, c’est avant tout un rusé. Et celui-là, bien qu’il soit de gauche, eh bien c’est le plus intelligent. » Il n’avait pas d’œillères et il était formidablement intègre.
Michel Berger, au fond, vous ressemblait.
Nous étions comme des jumeaux, même milieu, même bouillonnement, même envie créative. On s’aimait autant qu’on s’admirait. Il n’a jamais écrit pour moi, mais il me disait : « On se voit demain ? J’aurai deux chansons. Et toi ? » J’essayais de m’aligner et ce fut une période incroyablement féconde ! On n’arrêtait pas. Et on a fait deux albums ensemble, coup sur coup, avant que je ne parte très brusquement aux Etats-Unis, happée par Stephen Stills… J’ai alors habité un ranch perché à 3 000 mètres d’altitude dans le Colorado. Je perdais tous mes repères, je ne connaissais personne, il fallait tout réapprendre. Ce fut rude. Mais si je n’étais pas partie là-bas, je ne serais pas non plus celle que je suis aujourd’hui.
Votre père parlait de « bagage ». En dehors de la musique, de quoi était-il fait ?
D’une joie de vivre incroyable qui avait régné à la maison. Et de valeurs fortes que mes parents incarnaient et avaient eu à cœur de nous transmettre, à ma sœur et moi. La liberté avant tout. Et donc l’esprit de rébellion et de résistance. On ne doit subir le joug de qui ou de quoi que ce soit, travail ou compagnon. On ne courbe pas l’échine, et l’on garde la tête haute, menton relevé. Quant aux passions, il serait fou d’y renoncer. Il faut parvenir à les assouvir et aller jusqu’au bout de ses rêves. Les regrets, c’est pour la tombe !
Tous deux avaient été des figures de la Résistance.
Ah oui ! C’est là qu’ils se sont connus au début de la guerre et c’est une belle histoire. Ils faisaient partie du fameux réseau du Musée de l’Homme. Papa était dans le renseignement et maman décodait les messages et faisait du sabotage. Elle était experte en explosifs et a fait sauter quelques trains, et aussi un bateau. Ils se sont hélas fait dénoncer et ont été incarcérés en France pendant deux ans et demi, gardés et torturés par des Français. Papa s’est évadé grâce à des faux papiers fabriqués au camp. Maman, elle, c’était Bruce Willis, et son évasion est digne d’un film d’aventure.
On l’avait d’abord mise neuf mois au secret, enfermée dans le noir, nourrie tous les quatre jours. Puis elle avait connu l’horreur dans l’ancien couvent des Présentines, à Marseille. Et puis un jour, apprenant que sa déportation à Ravensbrück était imminente, elle s’était enfuie avec une copine. Grâce à une seringue d’eau, elles avaient fait sauter l’électricité du camp où elle était, assommé un gardien, marché des kilomètres dans un torrent, afin de rejoindre leur réseau et continuer la lutte. Ce qui est drôle, c’est qu’après s’être retrouvés sous leurs noms d’emprunts, mes parents ont continué à se vouvoyer jusqu’à la fin de leur vie. Pas par snobisme, mais par habitude. Même quand ils s’engueulaient. « Vous n’êtes qu’une buse ! », entendait-on alors.
Vous avez chanté votre vie sur scène, vos amours, vos désirs, vos souffrances. Mais votre famille apparaît aussi dans plusieurs chansons.
Bien sûr ! Dans 5ème étage, j’évoquais ma sœur, ma nounou, mon père (« Tu m’as donné toutes les chances »), ma mère (« sans qui je n’aurais rien créé »). Bien avant qu’elle ne meure, j’avais aussi dédié à maman la chanson intitulée Pour celle que j’aime. J’y confessais ma peur qu’elle s’en aille : « Quand tu seras sous terre, je ne saurai plus quoi faire, il faut vraiment que tu reviennes, que tu m’appelles… » Et j’avais un mal fou à la chanter quand je la savais dans la salle de concert. J’avais les larmes aux yeux, elle était bouleversée.
Je voulais dire : « Même six pieds sous terre, on ne s’abandonnera pas, je serai toujours avec toi… » Mais elle est partie il y a dix ans, on m’a enlevé ma mère, c’est un cambriolage, le vide est monstrueux. J’ai passé des années à faire semblant de rien, et puis ça m’est retombé dessus d’un seul coup. Elle est morte ici, dans ma maison, à l’étage. Je voyais bien qu’elle souffrait et qu’elle était au bout du rouleau. Elle me disait : « Franchement ma chérie, j’en ai marre. J’ai eu une vie merveilleuse, tellement remplie, quelle chance. Mais vois-tu, papa est mort, tous mes amis sont morts, je ne peux plus marcher et j’ai mal partout. Maintenant j’en ai assez. Aide-moi. »
Dix ans après, vous écrivez « Et je l’appelle encore »…
Oui. Le lien était si fort. A toutes les époques. Quand j’étais aux Etats-Unis, il n’y a pas un jour où je ne l’ai pas appelée au téléphone. Pas un ! Je me déchargeais sur elle. C’était ma poubelle, maman. Comme les psys sur lesquels on déverse sa vie. Et sans elle, comme dit la chanson, je n’aurais pas su résister aux griffures de l’existence, aux déceptions, aux souffrances, à ceux qui « ont tué mon innocence ».
Elle me rassurait, temporisait, dédramatisait. Et elle me faisait rire. Vous n’imaginez pas comme on a pu rire ensemble ! Elle m’a transmis la passion des puzzles (je dois en avoir plus de mille) et celle des mots croisés. Les plus durs et les plus astucieux. Je continue sans elle. Mais j’ai toujours l’impulsion de l’appeler. Papa aussi d’ailleurs. Comme il me manque ! Et comme j’aimerais son éclairage – pardonnez-moi – sur cette élection de merde !
Vous êtes croyante ?
Je ne suis pas sûre qu’on puisse retrouver un jour les êtres qu’on a aimés. Mais je crois qu’il existe une puissance supérieure, quel que soit le nom qu’on lui donne. Et qu’on n’est jamais seul, même quand on est à terre, et même plus bas que terre. Sans cet ange gardien, je serais morte depuis belle lurette.
Vous vous moquez allègrement des religions dans la chanson « Dignes, dingues, donc… »
Je les trouve toutes liberticides. Et j’ai l’impression qu’elles nous prennent pour des cons. Tous ces discours punitifs et culpabilisants, les stupidités du créationnisme, les fastes ridicules du Vatican… C’est une philosophie d’amour qu’il faudrait enseigner, comme le fait le pape François. Ah, celui-là, je lui tire ma mitre ! Je l’aime infiniment.
On ne le sent pas dans la chanson !
Parce que mon texte est ancien et que je ne le connaissais pas encore. Sinon, je l’aurais cité. Il est bon, tolérant, rassembleur et il fait tout ce qu’il peut pour que les gens puissent vivre heureux ensemble. Je n’ai qu’une peur, c’est qu’on l’assassine, comme ce fut sans doute le cas pour Jean-Paul 1er, qui voulait agir contre la corruption au Vatican et à qui on a fait boire un bouillon d’onze heures.
La chanson « Docteur Jedi et Mr. Kill » met en scène une femme battue par son compagnon, qu’elle finit par poignarder. Est-ce une référence à Jacqueline Sauvage, pour laquelle vous avez signé des pétitions, ou à votre expérience personnelle ?
C’est une référence à toutes les femmes violentées qui, légitimement, souhaitent faire passer l’arme à gauche à leur tortionnaire. Je sais de quoi je parle car à une période de ma vie, j’ai eu un compagnon très violent. Mais quand j’ai écrit le texte, je ne pensais ni à moi, ni à Jacqueline Sauvage, à laquelle j’aurais pourtant aimé dédier la chanson. J’avais en tête une belle jeune femme, pleine de patience, qui, à force de se prendre des coups, saisit un jour un couteau et tue son bourreau. Sans regrets et sans états d’âme. Simplement : toi, c’est fini. Au revoir.
Vous avez éprouvé un jour cette envie de meurtre ?
De nombreuses fois ! C’était en Amérique, et je ne savais pas comment faire. Je déteste les armes à feu. Donc l’arme blanche ? Il était tellement plus fort que moi qu’il aurait pu me l’arracher en deux secondes. Alors le pousser d’une falaise lors d’une randonnée à cheval dans le Colorado ? Ou le jeter du bateau ? J’ai tout imaginé sans penser une seconde que c’était le père de mon fils. Je n’en pouvais plus, c’est tout.
Et dans mon désarroi, j’ai demandé à un de mes musiciens : « Tu crois que ça coûterait combien de mettre un contrat sur sa tête ? » Il m’a répondu : « Je peux te le dire parce que je me suis renseigné pour ma femme et figure-toi que c’est moins cher de se débarrasser d’un homme. A moi, cela me coûterait 15 000 dollars, à toi seulement 9 000. » Ce n’était rien pour en finir en deux secondes… Mais j’ai imaginé qu’on pourrait ensuite me faire chanter, que tout ça était en fait très compliqué…
On n’entend pas assez la détresse des femmes ?
On ne les écoute pas ! Quand elles vont dans un commissariat rapporter les violences subies avec une trouille bleue des représailles de leur mec, qui pourraient être mortelles, les flics ne prennent pas la mesure du drame. Personne ne les écoute. C’est injuste. C’est insupportable. Alors j’ai écrit pour toutes celles qui subissent cela. Ce n’est pas une incitation à tuer. Mais l’expression d’une compassion pour les femmes et une supplique aux hommes, flics, voisins, amis, pour qu’ils entendent enfin et ne laissent pas repartir chez elle une femme couverte de bleus.
Nouvel album « Dignes, Dingues, Donc » (Sony Music). Retour sur scène à l’été 2017, Salle Pleyel, et à l’Olympia en novembre-décembre 2017.
Retrouvez tous les entretiens de La Matinale du Monde ici