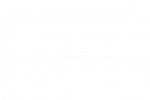Et si on arrêtait de recompenser les chefs des groupes armés en Centrafrique ?

Et si on arrêtait de recompenser les chefs des groupes armés en Centrafrique ?
Par Nathalia Dukhan
Pour Nathalia Dukhan, de l’ONG Enough Project, les récompenses accordées aux responsables de violence, comme l’impunité rampante, alimentent un cercle vicieux d’instabilité.
Un casque bleu devant un bureau de vote à Bangui, la capitale centrafricaine, lors du second tour des élections législatives et présidentielle le 14 février 2016. | ISSOUF SANOGO / AFP
« Nous avons évité des massacres de masse, permis un processus de réconciliation intercommunautaire, la reconstitution de l’Etat centrafricain (…) », déclarait le ministre français de la défense, Jean-Yves le Drian en annonçant le succès et la fin de l’opération militaire française, Sangaris, en République Centrafricaine. C’était en octobre dernier et avec ce retrait, l’opération a emporté avec elle l’attention internationale, replongeant la Centrafrique dans l’abime de l’oubli.
Pourtant, depuis fin septembre, les civils vivent au rythme des massacres qui ont principalement lieu dans les régions du nord-ouest, du centre et de l’est du pays, des zones prises en otage par les groupes armés. Le bilan des affrontements de ces derniers mois est lourd. Au moins 287 civils ont été tués selon l’ONU, mais ce chiffre est largement sous-évalué puisque les groupes armés dissimulent le bilan de leurs exactions. Dans la capitale, Bangui, des regains de violence éclatent de manière sporadique et font toujours craindre le scenario de l’embrasement. En 2017, plus de 14 groupes armés contrôlent le territoire national. Dans les zones occupées, bourreaux et victimes cohabitent et des taxes sont prélevées, obligeant les civils à participer à la perpétuation des violences dans lesquelles elles sont les victimes principales.
Dans son récent rapport, le Secrétaire Général de l’ONU annonce, sans équivoque, que « les tensions ont été exacerbées en raison d’une absence de progrès tangible sur la résolution des causes profondes du conflit et par la position des leaders des groupes armés qui cherchent à renforcer leur pouvoir de négociation ».
L’instrumentalisation des violences sectaires
En 2014, au plus fort de la crise centrafricaine, le conflit avait pris l’allure d’une guerre civile entre communautés musulmanes et chrétiennes, ces dernières considérant les musulmans comme complices, actifs ou passifs, des exactions commises par les Seleka en 2013. La dimension sectaire du conflit se poursuit toujours et révèle que les leaders des groupes armés l’instrumentalisent pour servir leurs intérêts.
Pour justifier leur existence et obtenir le soutien populaire nécessaire, les chefs de guerre alimentent et coordonnent des actes de violence qui encouragent les membres des groupes ethniques ou religieux qui leurs sont les plus proche contre les autres groupes. L’instauration d’un climat de terreur crée, parmi les civils, le sentiment d’un besoin de protection qui amène les jeunes à rejoindre la lutte armée, et y rester aussi longtemps que l’insécurité persiste.
La menace permanente de coup d’Etat permet à ces leaders de renforcer leur pouvoir de négociation. Plus leur pouvoir de déstabilisation est grand, plus ils pourront accéder aux tables des négociations et obtenir des postes politiques stratégiques, des intégrations militaires et un maintien de la partition de facto. En réalité, ces leaders n’ont aucune intention de désarmer ou de perdre leurs sources d’enrichissement.
La dangereuse légitimation des groupes armés
Le président Touadera, avec le soutien de la communauté internationale, a fait le choix du dialogue avec les leaders des groupes armés en renonçant à une ‘chasse aux sorcières’ et en négociant un désarmement volontaire, validant ainsi la stratégie des éléments perturbateurs. Certains chefs de guerre, sous sanction de l’ONU, ont quant à eux déjà été récompensés. C’est le cas d’un chef anti-balaka notoire, Alfred Yékatom, surnommé ‘Rambhot’, qui a été élu député à l’Assemblée Nationale en faisant usage de menaces et d’intimidations. Fin 2016 pourtant, Yékatom avait toujours un important degré d’influence sur certaines milices.
Dès lors, il existe une croyance générale qu’être commandant d’un mouvement politico-militaire permet d’accéder à des fonctions officielles, voir même de prendre le pouvoir. Cet état de fait est renforcé par l’impunité rampante. Un récent rapport d’enquête de l’ONU indiquait qu’il existe des doutes sur « l’impartialité du système judiciaire et sur la volonté d’enquêter effectivement les crimes graves », une situation qui profite aux instigateurs de violence.
En outre, parmi les leaders de la Séléka, cette volonté persistante d’accéder au pouvoir s’est transformée en un véritable plaidoyer en faveur d’une sécession du pays. Le principal partisan est le groupe dirigé par le chef rebelle Nourredine Adam et par Michel Djotodia, ancien président et chef de la coalition Séléka. En octobre dernier, un document interne au groupe justifiait leur agenda en dénonçant une impossible cohabitation et incompatibilité entre population chrétienne du sud-ouest et les musulmans de la région du nord-est. Une logique qui emprunte la stratégie du « diviser pour mieux régner » mais sans autre fondement.
Vers une quête d’amnistie générale
Deux figures emblématiques continuent de jouer un rôle important dans les instabilités politico-militaires. Il s’agit de François Bozizé - président de 2003 à 2013, renversé en mars 2013 par Michel Djotodia, qui tentent ensemble de tirer leur épingle du jeu en sponsorisant l’action des factions armées.
Depuis 2015, les clans de ces deux hommes, frappés par des sanctions internationales, ont tenté à plusieurs reprises d’obtenir l’amnistie générale. En décembre dernier, invités dans le cadre de la médiation angolaise souhaitée par le président centrafricain, Nourredine Adam et plusieurs autres commandants de la Séléka se sont rendus à Luanda. Le rapport de la réunion, resté secret jusqu’ici, fait ressortir deux revendications majeures : « l’amnistie pour les crimes de guerre comme solution politique et juridique de la résolution des différends » et « un statut des anciens chefs d’Etat pour (leur permettre), sans exclusion, de bénéficier d’un statut et d’un rang protocolaire et cérémonial leur permettant de vivre dans leur pays », ce qui laisse entrevoir les mains invisibles des deux anciens présidents.
En l’absence de réponses politiques aux causes profondes du conflit, la menace d’un état de guerre permanente est réelle. Le climat d’impunité rampante, la légitimation de facto de l’action des leaders des groupes armés et les récompenses accordées aux responsables de violence alimentent un cercle vicieux d’instabilité. Tirer les leçons des trois années d’interventions internationales et française, en reconnaissant les échecs de l’approche actuelle, permettrait de sortir les Centrafricains de l’abime dans laquelle ils sont plongés.
Nathalia Dukhan, chercheuse et analyste pour l’ONG américaine Enough Project sur la République centrafricaine.