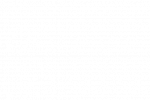En Namibie, des scènes de chasse à la mode néocoloniale

En Namibie, des scènes de chasse à la mode néocoloniale
Par Antoine Duplan (journaliste au "Temps")
Dans « Safari », le documentariste Ulrich Seidl montre comment ses compatriotes autrichiens paient pour faire des cartons sur la faune sauvage.
Ulrich Seidl n’aime pas les gens, surtout les Autrichiens. A l’instar de Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek ou Michael Haneke, c’est sans pitié qu’il crucifie ses compatriotes dans des films à valeur misanthropique augmentée. A travers fictions et documentaires, il éclaire les recoins de la psyché nationale en s’intéressant aux rapports des bêtes et de leurs maîtres (Animal Love), descend dans les caves où s’accomplissent des rituels fangeux (Im Keller) ou, dans la trilogie de Paradis, dévoile l’effrayant visage de la Foi, de l’Espérance et de la Charité…
Paradies "Liebe" by Ulrich Seidl - Trailer
Durée : 02:06
Avec Safari, il s’intéresse aux chasseurs. Un spécimen sans panache de cette espèce sanguinaire sonne du cor devant les bois. Puis l’action se déplace en Afrique, sur le terrain de Paradise Love, ce film terrible dans lequel des Teutonnes maousses s’adonnent au tourisme sexuel. Sur le mode documentaire, Ulrich Seidl dénonce cette autre forme de néocolonialisme qu’est la chasse.
Décimations héroïques
Ulrich Seidl distingue deux groupes de tirailleurs. Le premier rassemble de vieux chnoques grognons qui chassent à l’affût. Planqués dans leur guérite, ils somnolent en buvant des bières, lâchant parfois une salve propre à disperser les oiseaux. L’autre faction est plus nocive. Ses membres choisissent leur proie sur catalogue : buffle, gnou, antilope, zèbre, kudu, springbok, éland… Toute la faune namibienne est à portée de fusil. Il faut compter 615 euros pour un gnou, 100 euros pour une antilope dik-dik ; le phacochère, c’est entre 330 euros et 450 euros selon les régions.
Pour mener leurs héroïques décimations, les Tartarins d’Europe centrale ne crapahutent pas dans la savane. On les amène en 4 x 4 à proximité d’un animal repéré par les pisteurs. Ils ont de coûteux fusils à lunette montés sur des trépieds. La bête n’a aucune chance. Le plaisir qu’ils ressentent quand le coup part est de nature indéniablement sexuelle. « Après avoir tué, je suis submergée par l’émotion », halète une chasseresse.
Ulrich Seidl SAFARI Trailer - Ab 16.9. im Kino
Durée : 02:10
En prenant la pause pour la photo derrière leur proie, un genou à terre, le fusil dressé, les tueurs de bêtes perpétuent un imaginaire colonial qu’on croyait aboli. Ils se sentent chez eux, droits dans leurs bottes. Ils ont payé, ils ne vont pas se justifier. Philosophant face à la caméra, sous des murs chargés de trophées, ils préfèrent dire « donner la mort » que « tuer », parlent de la « délivrance » que leur coup de fusil amène aux bêtes vieilles ou malades. Ils regrettent qu’on les taxe de racistes quand ils observent que les Noirs courent plus vite que nous (« quand ils le veulent… ») en raison de la morphologie de leur talon. Ils rêvent de se payer un buffle, voire un éléphant…
Le sang et la sanie
Ils finissent par se payer une girafe, espèce menacée dont la population a décru de 40 % en trente ans. La scène est insoutenable. Foudroyé par le projectile, le bel animal dont la tête ondulait comme une graminée à six mètres du sol tombe dans une pose pathétique et grotesque, corps avachi, cou coudé comme un vieux tuyau, front posé au sol. Il se redresse une dernière fois, ses bourreaux surpris ont les jetons de prendre un coup de cornes, mais la tête trop lourde retombe, langue pendante.
Il faut neuf personnes et un treuil pour charger une tonne de viande de girafe sur la camionnette. Puis viennent les basses besognes du dépiautage. Curieusement, cette tâche est dévolue aux indigènes. Tandis que les hôtes blancs se relaxent au bar, une poignée de Noirs s’active en sous-sol dans le sang et la sanie, tronçonnent, dépècent… Ils ont droit à des rogatons qu’ils grignotent en fixant l’objectif d’un œil vitreux.
Dans le film Chasseur blanc, cœur noir, Clint Eastwood lâche : « Tuer un éléphant n’est pas un crime, c’est un blasphème. » L’adage s’applique également aux girafes.
Cet article a d’abord été publié dans Le Temps.