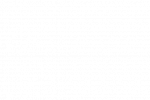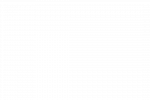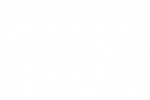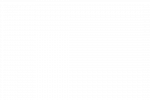Amours déçues, révolutions inachevées, héros pathétiques : notre sélection littéraire

Amours déçues, révolutions inachevées, héros pathétiques : notre sélection littéraire
Chaque jeudi, « Le Monde des livres » propose ses coups de cœur de la semaine.
Fatigués des écrans ? Reposez vos yeux et nourrissez vos neurones avec le dernier roman de Zeruya Shalev, une parodie « culte » de super-héros enfin éditée en France et deux ouvrages de réflexion, le premier consacré à la condition animale, le second aux printemps arabes.
ROMAN. « Douleur », de Zeruya Shalev
Dix ans après l’attentat où Iris a été blessée, les effets de la déflagration se font encore sentir. Dans son corps, d’abord, qui la meurtrit de nouveau. Dans sa famille, aussi : celle qu’elle forme avec son mari et leurs deux enfants ne s’est jamais remise de cet événement qui les a silencieusement éloignés les uns des autres. Sur l’insistance de son mari, Iris consulte un médecin spécialiste de la douleur ; il se trouve être l’homme qui lui a infligé sa première souffrance en la quittant, quand ils avaient 17 ans.
La trame de Douleur pourrait sembler imbibée d’eau de rose, avec ce retour soudain d’un amour disparu, devenu de surcroît un beau docteur célibataire. Mais Zeruya Shalev est l’écrivaine la moins complaisante qui soit. Armée de ses phrases longues et hachées, poétiques et dures, qui s’enroulent autour du lecteur pour le happer et ne jamais le lâcher, elle sonde en profondeur les pensées, les émotions et les aspirations d’Iris.
Avec une lucidité sidérante, éprouvante parfois à force de justesse, son écriture parvient à tout saisir dans un même mouvement : les regrets d’Iris pour la vie qu’elle aurait pu avoir si cet Ethan ne l’avait pas quittée, ses élans de passion, son goût de l’ordre et de l’efficacité, ses inquiétudes pour ses enfants, ses accès de loyauté à l’égard de son mari…
Mais, peut-être parce qu’Iris est un personnage plus pragmatique, moins torturé que les héroïnes précédentes de Zeruya Shalev, ce cinquième roman est, paradoxalement, le moins « douloureux » de l’écrivaine. Sans qu’il perde en force pour autant. Raphaëlle Leyris
« Douleur » (Ke’ev), de Zeruya Shalev, traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz, Gallimard, « Du monde entier », 416 pages, 21 €.
HISTOIRE. « Biographies animales », d’Eric Baratay
L’attention intellectuelle plus grande portée aux animaux ne saurait se résumer à la question de leurs droits, estime l’historien Eric Baratay, de l’université de Lyon, un des pionniers français de la vague d’études sur le sujet.
Il faut cesser pour cela de voir les bêtes seulement comme des organismes biologiques et retrouver, derrière les espèces, les individus, en leur restituant un nom. D’où ces biographies d’animaux célèbres, certes saisis dans leurs interactions avec l’homme, mais abordés autant que faire se peut du strict point de vue non humain.
Si la littérature s’est depuis longtemps emparée du procédé – qu’on pense aux autobiographies animales du Terrier, de Kafka (1931), ou de Flush, de Virginia Woolf (1933) –, Eric Baratay cherche à serrer au plus près les sensations, voire les sentiments, d’une douzaine d’animaux, de la girafe de Charles X, à Consul, le chimpanzé du zoo de Belle Vue, à Manchester (Royaume-Uni), ou au chien Bauschan, « promeneur de Thomas Mann » de 1915 à 1920.
Il mobilise pour cela non l’imagination mais toutes les ressources de l’éthologie ainsi que les documents disponibles. Ce qui est en jeu, outre la saveur et le pittoresque de ces récits, n’a rien d’anecdotique. Il s’agit en effet de reconfigurer la notion de sujet, jusque-là réservée à l’homme, afin d’étendre la notion de personne bien au-delà de l’anthroposphère.
Le récit où Eric Baratay entrecroise habilement les commentaires d’époque et les impressions reconstituées du taureau, lors de la corrida du 28 août 1947 où le célèbre torero Manolete perdit la vie d’un coup de corne, constitue un vrai morceau de bravoure. Considéré comme « lâche » par les aficionados, parce qu’il évitait le combat, Islero, le taureau, était en réalité presbyte. La description minutieuse de son martyre subi sous les huées du public représente un des réquisitoires des plus efficaces contre les courses taurines. Nicolas Weill
« Biographies animales. Des vies retrouvées », d’Eric Baratay, Seuil, « L’univers historique », 300 pages, 22 €.
ROMAN. « Supernormal », de Robert Mayer
La parodie est un art qui se prête à la multiplication. Robert Mayer en fait la démonstration dans ce roman, son premier, publié il y a tout juste quarante ans aux Etats-Unis et traduit pour la première fois en France.
Supernormal ne se contente pas de caricaturer l’univers des super-héros à travers les « exploits » d’un vengeur masqué en pleine crise de la quarantaine. Il détourne également, tous azimuts, les films d’espionnage, les dessins animés, les séries télévisées, le milieu de l’art contemporain, la société de consommation, la Genèse, le base-ball, le journalisme (qui était alors le métier de l’auteur)…
Pas un de ses héros, même mineur, ne fait référence à un personnage de la vie publique ou à une marque américaine. Il faut du coup bien connaître la culture et la contre-culture des Etats-Unis dans les années 1970 pour savourer pleinement cet exercice de style, sauf à se rendre régulièrement à la fin de l’ouvrage où des notes explicatives sont fournies par le traducteur québécois du roman (ce qui s’avère un peu lassant à la longue).
Mais Supernormal vaut surtout pour sa dimension de satire sociale : l’Amérique en plein doute de l’époque y est dépeinte à travers le déclin d’un justicier costumé qui fut autrefois le « plus grand des super-héros ».
La métaphore bat son plein. Nul n’est invincible, et surtout pas une nation, nous dit Robert Mayer dans ce thriller humoristique qui aurait fait une très bonne bande dessinée, sous la plume de Robert Crumb par exemple. Frédéric Potet
« Supernormal » (Superfolks), de Robert Mayer, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Francis Guévremont, Aux forges de Vulcain, 312 pages, 21 €.
ESSAI. « Symptômes morbides », de Gilbert Achcar
C’est une écriture combative, obstinée et en même temps un peu marginale, à laquelle l’époque prête de moins en moins l’oreille. Les mots de Gilbert Achcar sont ceux d’un intellectuel marxiste qui se souvient des luttes du XXe siècle, des défaites et des désastres aussi.
Analyser le devenir des soulèvements arabes de 2011 avec, en tête, cette mémoire-là, celle des combats pour l’émancipation sociale, voilà une démarche qui n’est pas si courante, et qui fait l’originalité de Symptômes morbides, le nouvel essai du politologue libanais.
Excellent connaisseur de la scène proche et moyen-orientale, il évoque en détail le destin de ces « printemps » qui ont débouché sur un terrible hiver, au cours duquel les forces révolutionnaires, démocratiques et laïques se sont trouvées broyées entre la férocité des dictatures militaires et la barbarie des intégristes musulmans.
Replaçant ce triangle infernal dans le temps long des contre-révolutions passées, examinant en particulier le cauchemar syrien et l’impasse égyptienne, Gilbert Achcar propose un bilan critique des soulèvements arabes, décortique les rapports de force, revient sur quelques rendez-vous manqués. Les illusions et les contradictions propres aux divers courants de « la gauche arabe », par exemple, ne sont pas escamotées.
Ainsi, ce livre semble tout entier structuré par une certitude : dans le chaos sanglant qui a succédé aux insurrections de 2011, quiconque prétend reconstruire ne serait-ce qu’un début d’espérance « progressiste » doit d’abord faire montre d’une implacable lucidité. Jean Birnbaum
« Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe » (Morbid Symptoms. Relapse in the Arab Uprising), de Gilbert Achcar, traduit de l’anglais par Julien Salingue, Actes Sud, « Sindbad », 288 pages, 22 €.