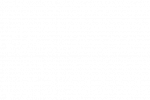Dans l’Arctique aussi, les déchets plastiques s’accumulent

Dans l’Arctique aussi, les déchets plastiques s’accumulent
Par Stéphane Foucart
Jusqu’à 1 200 tonnes de fragments provenant d’Europe de l’Ouest et des Etats-Unis contaminent la surface de l’océan glacial.
La goélette « Tara » dans l’archipel François-Joseph, dans le nord de la Russie, en janvier 2013. | A. DENIAUD GARCIA / AFP
C’est désormais une certitude : on trouve des débris plastiques flottants sur tous les océans. On connaissait les grandes zones d’accumulation, en Méditerranée et au cœur des cinq gyres océaniques – Atlantique nord, Atlantique sud, Pacifique nord, Pacifique sud, océan Indien –, mais une équipe internationale menée par Andrès Cozar (université de Cadix, Espagne) publie, mercredi 19 avril dans la revue Science Advances, les résultats d’une campagne de mesures montrant l’existence d’une nouvelle zone d’accumulation dans l’océan Arctique. Loin, très loin des grandes sources de rejet de plastique en mer.
« Nos résultats portent néanmoins une bonne nouvelle, puisque dans de vastes zones de l’Arctique, on ne trouve pas ou très peu de plastique flottant, explique Erik van Sebille (université d’Utrecht, Pays-Bas), coauteur de ces travaux. Cependant, en mer du Groenland et en mer de Barents, on en trouve des concentrations élevées, beaucoup plus hautes que quiconque l’aurait imaginé. » Dans certaines zones, on ramasse jusqu’à « plusieurs centaines de milliers de débris par kilomètre carré », écrivent les chercheurs, qui fondent leur analyse sur les relevés effectués par la goélette Tara. Celle-ci a laissé traîner ses filets dans de larges secteurs de l’Arctique entre juin et octobre 2013, récupérant les fragments de taille supérieure à 0,5 millimètre.
La quantité totale de débris découverte demeure toutefois marginale par rapport à ce qui pollue la Méditerranée et les gyres océaniques. Dans l’océan glacial, les chercheurs estiment la quantité totale de fragments entre 100 tonnes et 1 200 tonnes. Et ce, alors que leur masse totale, à l’échelle des océans du globe, est généralement évaluée entre quelques dizaines de milliers de tonnes et plus de 200 000 tonnes – là encore avec une grande marge d’erreur.
Cul-de-sac
Selon les auteurs, les débris qui s’accumulent là, dans les mers glacées septentrionales, sont portés par un bras de la circulation dite « thermohaline » – ce lent courant marin qui transporte les eaux chaudes de l’Atlantique tropical vers l’Europe du Nord. Les zones où ces eaux de surface chaudes se refroidissent et plongent en profondeur seraient, écrivent les chercheurs, comme un cul-de-sac propice à l’accumulation des débris flottant. « Un modèle de circulation océanique que nous avions utilisé en 2012 anticipait que ce serait le cas, mais nous n’avions pas les données pour le vérifier, dit Erik van Sebille. C’est désormais chose faite. »
En 2015, une étude publiée dans la revue Science avait fait grand bruit en estimant à 8 millions de tonnes la quantité de plastique déversée chaque année dans les océans, ajoutant que 80 % environ des rejets ne provenaient que de quelques pays d’Asie (Chine, Indonésie, Philippines, Vietnam, Sri Lanka, etc.). « Certains se sont alors demandé s’il était bien utile que les pays européens et les Etats-Unis fassent un effort dans la mesure où l’essentiel de la contamination de l’océan par le plastique ne provient pas de ces pays, raconte Erik van Sebille. Or, nos travaux montrent que les rejets de plastiques provenant d’Europe de l’Ouest et des Etats-Unis sont importants, car ils finissent en partie dans l’Arctique, une zone à la fois biologiquement très productive et d’une grande fragilité car tous les stress qu’elle subit s’ajoutent au changement climatique. »
En outre, la contamination des eaux de surface de l’Arctique n’est sans doute que la partie émergée du problème : une part, pour l’heure impossible à chiffrer, a coulé et gît sans doute sur le plancher océanique. De fait, les débris flottant sur l’océan ne représentent qu’une minuscule fraction, inférieure à 1 %, de la masse totale de plastique introduite dans les mers du globe. Où se trouve cette matière manquante ? A-t-elle coulé au fond des mers ? Est-elle stockée dans la chaîne alimentaire ? Est-elle présente en trop petits fragments pour être ramassée dans les filets des missions d’échantillonnage ? A-t-elle été dégradée par des communautés bactériennes ? Ces multiples questions demeurent largement ouvertes.