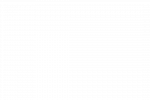Sandrine Kiberlain : « Je suis née une deuxième fois »

Sandrine Kiberlain : « Je suis née une deuxième fois »
Propos recueillis par Pascale Krémer
L’actrice césarisée en 2014 pour le film « 9 mois ferme » préside, au Festival de Cannes, le jury de la Caméra d’or. Ce prix, attribué en 2016 à « Divines », sera remis dimanche 28 mai.
Je ne serais pas arrivée là si…
… Si je n’étais pas sincère. Si je n’avais pas su dire « oui » ou « non » à des rôles avec la même spontanéité, la même absence de calcul, depuis le début. Quand je choisis de faire un film, de me plonger pendant deux mois dans l’univers d’un metteur en scène, de m’investir totalement dans un rôle, c’est que j’en ai vraiment envie pour des raisons personnelles. Sinon c’est une souffrance.
Je ne serais pas non plus arrivée là si je n’avais pas eu une famille qui a toujours su prendre les choses avec beaucoup de recul, d’humour. Une famille qui n’était pas friande de drames alors qu’elle en avait vécu, pourtant.
Vos quatre grands-parents ont immigré en France en 1933 ?
Ils étaient juifs de Pologne. Quand mon père et ma mère se sont rencontrés à l’Ecole des cadres, ils ont découvert que leurs parents étaient arrivés à peu près en même temps de Pologne, qu’ils venaient de villages séparés de quelques kilomètres seulement. C’est fou ! Il y a des choses qui semblent écrites… Des deux côtés, les membres de la famille qui étaient restés en Pologne sont morts en 1939.
En France, mes grands-parents maternels ont été cachés par des Justes d’Alsace. La grande soeur de ma mère, elle, était cachée dans un couvent, et mes grands-parents paternels, dans des fermes. Ils avaient confié mon père à une dame qui avait un chien. C’est ce chien qui a donné à mon père la force de tenir pendant trois ans. Il s’est senti abandonné.
Avec ma sœur, on a entendu plein d’histoires de la guerre, mais il fait bon les réentendre aujourd’hui, pour rappeler que ça a existé, que ce n’est pas un détail de l’histoire. Je trouve fou qu’on parle encore d’antisémitisme aujourd’hui ! Que ces années-là n’aient pas suffi ! S’ils étaient encore vivants, mes grands-parents pleureraient.
La Shoah a marqué votre enfance ?
C’est en moi, c’est quelque chose que je trimballe dans mon sang, dans mes veines, dans mon cœur, sans que mes grands-parents aient eu besoin d’en parler toutes les quatre minutes. Au contraire. Ils étaient en France pour construire, donner à leurs enfants l’éducation la plus belle qui soit. Ils se sont faits tout seuls, ils se sont embourgeoisés en travaillant comme des brutes dans la fourrure et les pulls.
Du côté paternel, il y avait une culpabilité très ashkénaze de la réussite. Ils avaient été sauvés, ils allaient le payer un jour. Ils ont toujours vécu avec la peur, ils nous l’ont certainement communiquée.
Côté maternel, c’était l’inverse. Une envie de réussir et d’en profiter. Ils ont appris le français grâce à leurs filles, ils ont passé le permis. Les commerçants se moquaient d’eux parce qu’ils avaient un accent yiddish. Ils sont passés par tout ce que vivent les immigrés. Mais ils se sont battus jusqu’à habiter Neuilly, devant le lac, et nous offrir une belle vie.
Ma grand-mère maternelle était mon idole, elle avait une force innée, un humour ! Pendant la guerre, quand son mari lui a dit qu’il devait se présenter à la mairie, elle a eu le flair de l’en empêcher. Elle avait beaucoup d’instinct, d’esprit, elle était extrêmement moderne. Mes parents ont su profiter de la vie, ils étaient toujours en bande de potes, comme dans un film de Claude Sautet. Avec ma sœur, on a aussi hérité de ça : profiter de l’instant, ne pas se plaindre. Il y a plus dramatique ailleurs.
Votre enfance a été douce ?
J’étais extrêmement protégée, en quatuor avec mes parents et ma sœur. J’avais mon monde imaginaire. J’étais très solitaire, observatrice, dans la lune, flottante. Le passager à l’arrière de la voiture. Un peu transparente. Tristoune, sans raison dans le fond.
A l’école, je m’arrangeais pour être dans les bons sans travailler des masses, à part en dessin où j’étais douée. Jusqu’au bac, j’ai fait les choses un peu automatiquement, comme si je n’étais pas dans la vie. Puis j’ai commencé le théâtre, au Cours Florent. C’est là que je suis née une deuxième fois, vraiment.
Comment vous est venue l’envie de jouer ?
Dans ma solitude, je m’inventais des vies. J’étais un jour vétérinaire, je l’incarnais de manière hyperprécise avec ses dossiers, ses faux instruments, ses peluches-patients, ses dialogues. Mon père, qui était expert-comptable mais extrêmement fantaisiste, nous filmait beaucoup, ma sœur et moi. Tout de suite, j’ai vu que c’était le moyen de faire rire mes parents, d’être regardée, d’exister. Et puis, j’ai eu très vite la passion du cinéma. Ingrid Bergman, Romy Schneider, Miou-Miou… Elles étaient comme mes meilleures amies. C’était cette vie-là que je voulais vivre.
Et vous commencez à la vivre au Cours Florent ?
En fin de classe de 1re, j’ai entendu parler de ce cours de théâtre, au 35, quai d’Anjou, à Paris. J’aimais beaucoup Francis Huster, qui dirigeait la classe libre. On entrait quai d’Anjou comme dans un moulin, j’ai grimpé un escalier, je suis allée écouter son cours derrière la porte. A la pause, Francis Huster est sorti. Il m’a vue, avec ma frange jusqu’au bas des yeux.
Qu’est-ce que je faisais là ? J’ai dit que je voulais faire comme ses élèves. Il m’a demandé si je connaissais un poème, j’ai récité du Francis Blanche devant ses élèves, avec un trac ! J’avais 16 ans… Mais j’étais tellement contente ! Il m’a proposé de venir assister au cours le mercredi. J’en suis devenue la mascotte. J’ai fini par passer le concours de cette classe libre. Francis m’a recalée la première fois, il voulait que j’aie mon bac.
J’ai été prise la deuxième fois, avec Yvan Attal, Valérie Benguigui, José Garcia… Ce furent des années géniales et une rencontre très forte avec Francis. Il savait voir qui on était, puis nous laissait libres de l’exprimer, et nous valorisait.
Très vite, à 20 ans, je suis entrée au Conservatoire national supérieur en faisant rire le jury avec une scène d’Annie Hall, que je jouais avec Yvan Attal. C’était risqué – mais ensuite, je présentais le monologue de l’infante du Cid… Au Conservatoire, j’ai explosé, si je puis dire. J’ai fait connaissance avec moi, j’ai pris confiance, plaisir à décider. Quoi jouer, qui aimer. J’ai accepté d’« atterrir ». Ma vie a commencé avec l’expression de ma passion.
Vous avez rapidement trouvé vos premiers rôles ?
J’ai connu les castings où l’on arrive avant-dernière, où l’on est « peut-être trop ceci », « pas assez cela ». Mon premier vrai rôle, cela a été dans Les Patriotes, d’Eric Rochant, qui m’a choisie alors que son producteur était affolé. Je devais jouer une call-girl et j’avais l’air d’avoir 4 ans, j’étais en baskets, en jeans, je n’avais aucune conscience de ma féminité. Au dernier essai, Eric Rochant m’a relevé les cheveux, habillée en call-girl, on a travaillé l’allure. Le producteur a fini par dire banco. C’était un premier regard sur moi. Un soulagement.
J’attendais ce réalisateur qui comprendrait qu’on pouvait faire quelque chose avec ma singularité. Je ne suis pas une beauté classique, pas une icône glamour. Je suis une ambiance.
Et dès l’année suivante, en 1996, vous recevez le César du meilleur espoir féminin pour votre rôle dans En avoir (ou pas), de Laetitia Masson…
Cela s’est enchaîné très vite, mais je le pressentais, sans aucune prétention. Je me sentais extrêmement légitime comme actrice. Comme le cordonnier qui sait qu’il fait bien son métier. Il fallait juste qu’on me choisisse une première fois, qu’on m’ouvre la porte.
Puis vient ce Molière, en 1997, pour Le Roman de Lulu, une pièce écrite par votre père. Ce n’est pas banal !
Mon père, comme ma mère, avait une vraie passion du théâtre. Ils se sont rencontrés à l’Ecole des cadres parce que mon père mettait des pièces en scène et qu’il avait choisi ma mère pour jouer sa fiancée. Ma carrière lui a donné le courage de quitter son bureau pour ouvrir un bar à vin, et de passer à l’acte comme auteur. Un jour, j’ai reçu par la poste Le Roman de Lulu, signé David Decca. J’ai vite compris que c’était de lui, je l’ai lu la gorge serrée. Il m’a offert la pièce, je lui ai offert le Molière, on n’arrêtait pas de se dire « Quelle histoire ! » On a vécu ce moment comme une chance, en quatuor.
Vous passez facilement du drame à la comédie. Où va votre préférence ?
Dans la comédie comme dans le drame, je me noie dans le personnage. Je fais un métier d’empathie totale, d’observation, de compassion. Quand je suis Alice, la poissonnière de Laetitia Masson qui veut être embauchée, je deviens son porte-parole. Comme un avocat avec son client, je ne peux pas rater, être à côté. Ariane dans 9 mois ferme, si je me mets à penser qu’elle doit être drôle, elle ne le sera jamais. Je dois être sincèrement cette Ariane, ses milles facettes, et c’est au réalisateur de doser.
A la naissance de ma fille Suzanne, il y a 17 ans, deux caillots se sont formés dans mon cerveau, je suis restée deux jours dans le coma. J’aurais pu ne pas m’en sortir. Après, on met de côté tout ce qui pèse. La vie est trop courte. Ça a changé ma façon d’être, donc les rôles qu’on me proposait. Je dégageais autre chose. Je suis passée des femmes mystérieuses, flottantes, errantes, à des rôles plus adultes, terriens, plus ancrés, plus drôles, plus féminins. Les films sont souvent proches de la vie.
Et les chansons encore plus ? Vous avez sorti deux albums…
Mes chansons révèlent peut-être un humour mélancolique, un côté slave qui me colle à la peau. Une grande conscience du temps qui passe, du côté éphémère de la vie. Et une légèreté, parce que tout ça est une grande blague.
Vous présidez le jury de la Caméra d’or, à Cannes. Qu’est-ce qui vous a poussée à accepter cette mission ?
Ma passion du cinéma ! Cannes, c’est comme un tournage. On est là, tous, parce qu’on aime le cinéma, c’est émouvant. Dans la grande salle, quand vous regardez le film d’un des plus grands metteurs en scène du monde, il y a une espèce de tension, de passion. J’aborde Cannes avec beaucoup de recul. Il y a une hystérie à gérer. Mais Cannes, c’est aussi moi, j’adore la lumière, le tapis rouge. J’en ai rêvé, comme toutes. La base solide qui m’a été donnée me permet de rester dans la réalité et de m’amuser de cette folie ambiante.
Distinguer un premier film, lancer une carrière… c’est un beau rôle que l’on vous confie ?
Oui, j’en suis très flattée. Des premiers films, j’en ai tourné, et j’en tourne encore plein. Je vais me sentir responsable, je sais l’impact de Cannes pour un cinéaste. On va assister à la naissance de quelqu’un qui changera peut-être notre vie par sa vision du cinéma.
Moi, adolescente, il y a des films qui ont changé la mienne : L’Argent de poche, de Truffaut, A nos amours, de Pialat, L’Effrontée, de Miller… Je me suis identifiée à tous ces personnages si différents de moi. Parmi les 24 films que nous allons voir, j’espère que nous trouverons un ton, quelque chose qui nous touche, qui nous fasse oublier qu’on est juges. Une sincérité !
Propos recueillis par Pascale Krémer
Festival de Cannes, du 17 au 28 mai. La Caméra d’or récompense chaque année le meilleur premier film, toutes sections confondues (Sélection officielle, Semaine de la critique, Quinzaine des réalisateurs). En 2016, ce prix avait été remis à Houda Benyamina pour Divines.
Retrouvez tous les entretiens de La Matinale ici