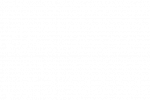« A Manchester, la violence a toujours fait partie de notre histoire »

« A Manchester, la violence a toujours fait partie de notre histoire »
Propos recueillis par Charlotte Chabas (Manchester, envoyée spéciale)
Erinma Bell dirige le centre social du quartier de Moss Side, quartier du sud de Manchester où une quinzaine de jeunes hommes ont rejoint les rangs de l’Etat islamique.
Une minute de silence a été observée sur une place mancunienne, jeudi 25 mai, en hommage aux 22 victimes du Manchester Arena. (Owen Humphreys/PA via AP) | Owen Humphreys / AP
Depuis vingt-quatre ans, Erinma Bell dirige le centre social du quartier de Moss Side, voisin de Fallowfield, où vivait le kamikaze qui s’est fait exploser à l’Arena lundi 23 mai, faisant 22 morts et 75 blessés. Dans ce faubourg résidentiel du sud de Manchester, une quinzaine de jeunes hommes ont rejoint les rangs de l’organisation Etat islamique en trois ans.
A la tête du Chrysalis Family Centre, la militante a vu son quartier se transformer ces dernières années. Mais elle a surtout vu « la résurgence d’un cycle de violence qu’on avait réussi à briser dans la politique anti-gang des années 1990 ».
Comment avez-vous réagi après l’annonce de l’attentat, et de l’identité du tueur, qui vivait non loin d’ici ?
Erinma Bell : J’ai été submergée d’appels de proches et de ma famille, s’exclamant à quel point « ce n’est pas Manchester cet attentat ». J’ai été choquée aussi. Ici, on a l’esprit britannique chevillé au corps : nous sommes polis, nous sommes sociables, mais quand les portes sont fermées, on ne cherche pas à savoir ce qui se passe derrière. Alors forcément, on tombe de haut quand on voit qu’un enfant peut s’en prendre à des enfants. Encore plus quand c’est un enfant de chez nous.
Avez-vous constaté une montée en puissance ces dernières années d’une forme d’extrémisme religieux dans votre quartier ?
Sociologiquement, il y a eu beaucoup de changement dans le quartier depuis le début des années 2000. On est passés d’un quartier à majorité noire, avec des gens arrivés principalement d’Afrique subsaharienne dans les années 1970-80 – je suis née ici mais mes parents sont Nigérians, par exemple – à une population nettement plus mixte, avec beaucoup de nouveaux arrivants venus du Maghreb.
Dans la rue du centre social, on a de nombreuses familles de Somaliens, des Egyptiens, des Mauritaniens. Et dans la maison voisine, une famille libyenne dont les deux fils sont partis en Syrie.
Donc oui, l’extrémisme religieux, on sait qu’il existe, il ne faut pas être naïf. Mais il ne représente en rien ce quartier, qui est en fait pour moi une communauté de communautés. A qui on ne demande pas de renier ce qu’elles sont et d’effacer leur passé, mais d’apporter sur la table leur culture pour créer à l’échelle du quartier, de la ville, une communauté plus riche, avec des nouveaux commerces, des nouvelles pratiques… Le problème est d’organiser ensemble ces communautés, de trouver le liant dans cette grande salade.
Comment on peut s’organiser face à la violence ?
Dans ce quartier, la violence a toujours fait partie de l’histoire. L’histoire de la création de ce centre social, c’est le constat qu’un soir, mon ami avait pris douze balles par un gang rival, et que l’ambulance de l’hôpital en bas de la rue a mis quarante-cinq minutes à arriver.
On a commencé à travailler dans un contexte où tous les jeunes hommes noirs étaient perçus comme des porteurs d’armes. Le code postal ici, c’est M16, comme le fusil d’assault. On avait honte de donner notre adresse, notre quartier avait été rebaptisé « Gunchester » [association de « gun », pistolet en anglais, et de « Manchester »]. En dix ans de travail dans la communauté, en partenariat avec la police, avec les lycées, avec les associations, on a réussi à faire baisser la violence des gangs de 92 %. A tel point qu’on a dissous l’association qu’on avait créée, Carisma.
On sait donc qu’il est possible de briser le cycle de la violence, de la revanche permanente. Dans le cas présent, c’en est une résurgence : des jeunes gens qui considèrent que le Royaume-Uni a fait du mal à leur peuple – et de fait, c’est dur à contredire, quand on regarde la situation de tous ces innocents Syriens, par exemple – et qui se vengent contre des innocents britanniques. Mais on sait qu’on peut briser les préjugés et les barrières mentales, parce qu’on l’a déjà fait auparavant.
Vous êtes confiante sur la capacité de la société à surmonter cette épreuve ?
Je sais que ma ville a de la ressource, oui. Outre la guerre des gangs, on a aussi eu la guerre entre l’Armée républicaine irlandaise (IRA) et l’Etat britannique, qui a fait des ravages [65 blessés en décembre 1992 dans le centre-ville, et 206 blessés le 15 juin 1996 dans le centre commercial d’Arndale]. C’étaient des protestants qui se battaient contre des catholiques, mais dans ce cas-là, on n’a jamais mis une étiquette « guerre religieuse » pourtant. Je ne sais pas si ça a un lien avec le fait qu’ils étaient tous de type « caucasien »…
Ce qui m’inquiète aujourd’hui, c’est de voir à quel point on construit une génération qui a peur des musulmans. Et à quel point les musulmans en viennent aussi à avoir peur de nous.
Mon fils de 12 ans est rentré mardi soir à la maison en me disant qu’il avait découvert que Samsa, qui est un de ses meilleurs amis depuis trois ans, est musulman. Mon fils ne s’était jamais posé la question avant, parce qu’on ne naît pas raciste, on ne grandit pas raciste à l’école. Je lui ai demandé si ça changeait quelque chose pour lui, il m’a dit que ça restait son ami. Le racisme est un comportement qui s’apprend.
Je suis Mancunienne, alors je suis obligée de faire une comparaison avec le foot. Je vais rarement au stade, mais quand j’y vais, je suis toujours surprise de voir comme tout bascule. Il n’y a plus que deux camps ici : ceux qui supportent United et ceux qui supportent City. Peu importe leur religion, leur couleur de peau, celles des joueurs : ils sont tous ensemble sous le même maillot. Salman Abedi était un pro-United, d’après ce que j’ai lu. Je me demande toujours comment on a réussi ce miracle, et surtout comment on peut le reproduire à notre échelle…
Est-ce que l’attentat de l’Arena Manchester va changer quelque chose dans votre travail au quotidien ?
Concrètement non, parce qu’on va continuer à faire ce qu’on fait depuis toujours. Organiser des événements, faire que les gens se rencontrent partout, discutent, échangent. On organise des événements dans les cafés où on entend dire que certains n’auraient pas le droit d’entrer. Quand j’étais une jeune noire, je me disais la même chose, je me créais mes propres limites.
Après, je sais avec certitude qu’aucun jeune ne se lève le matin en décidant sur un coup de tête de prendre une arme et de tuer des gens. C’est un processus mental, souvent influencé par d’autres. Ça veut dire qu’il y a un certain délai, et c’est dans ce temps imparti que nous devons agir.
Il n’y a donc rien à améliorer ?
Si, bien sûr. La chose qui m’attriste le plus dans l’histoire de Salman Abedi, c’est qu’il y avait eu plusieurs signalements de sa radicalisation au sein même de la communauté libyenne. Au moins trois, selon la BBC. Parce qu’on peut blâmer la police de ne pas avoir été assez efficace, mais si c’est la loi du silence qui règne, c’est normal qu’ils ne puissent pas avancer. Dans le cas d’Abedi, ça montre qu’il y a une vigilance collective, qu’il y a un réseau qui existe et qui est attentif.
Mais je crains que les signalements par la plate-forme dédiée [un numéro de téléphone spécial a été ouvert, comme en France] ne rendent la chose un peu moins locale. C’est peut-être une personne à Londres qui a géré l’appel et a classé le dossier comme « un autre môme qui fronce les sourcils dans une mosquée ». Je crois que ce qu’il se passe à Manchester doit être géré par la police de Manchester, que ce qu’il passe à Moss Side ou à Fallowfield doit être géré par des policiers du coin, prévenus par des habitants du coin. Mais ça demande des moyens supplémentaires.