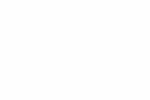David Goldblatt photographie les zones grises sud-africaines

David Goldblatt photographie les zones grises sud-africaines
Par Roxana Azimi (contributrice Le Monde Afrique)
Chroniqueur de la vie de ses compatriotes depuis 1948 et l’instauration du régime d’apartheid, le photographe a toujours préféré le récit à la dénonciation.
Amateurs de clichés ou de sensationnalisme, manichéens dans l’âme, passez votre chemin ! David Goldblatt n’est pas de ce bois-là. Le photographe octogénaire a beau préférer le noir et blanc à la couleur, son travail régate dans les zones grises de la société sud-africaine. Les évidences, très peu pour lui. Son regard traque le substrat, les nuances, la complexité.
Plus que les échauffourées, le bruit et la fureur, David Goldblatt s’est appliqué depuis les années 1960 à photographier les structures du pouvoir, disséquant par petites touches les injustices de l’apartheid. « J’ai appris au début des années 1990 que je n’étais pas homme à couvrir les événements, confie-t-il dans sa coquette maison remplie de livres et de bibelots, dans la banlieue de Johannesburg. Ce qui m’intéresse, ce sont les conditions qui mènent à ces événements. »
Né en 1930 dans la ville minière de Randfontein, David Goldblatt fait très tôt l’expérience de la haine, celle contre les juifs. Ses grands-parents lituaniens qui avaient fui les pogroms à la fin du XIXe siècle n’avaient sans doute pas prédit la ségrégation raciale instaurée en 1948, au moment même où l’Europe semblait s’être débarrassée du nazisme. A tout juste 18 ans, Goldblatt chronique la mise en place des lois raciales. Depuis lors, le « critique social autoproclamé » a accompagné la triste vie quotidienne de ses compatriotes.
Les sans-voix et sans-grade
Délaissant les personnalités politiques, son objectif s’attache aux sans-voix et sans-grade, travailleurs anonymes aux corps et regards fatigués. Pas de place pour le hasard dans ses compositions rigoureusement construites. Sans pathos aucun, Goldblatt énonce plus qu’il ne dénonce. Le photographe refuse d’ailleurs le qualificatif d’activiste. « Je l’étais, mais en silence », murmure-t-il. La violence, il l’a toujours fuie. A la frontalité, le solitaire préfère l’oblique. Prenez l’architecture. Chaque bâtiment, chaque édifice public ou privé, chaque église a été construit sur des convictions politiques. « Ces structures nous en disent long sur notre culture, nos valeurs », dit-il après avoir sillonné les routes durant des années dans un van Volkswagen.
Dépose de la statut coloniale du Britannique Cecil John Rhodes, à l’entrée de l’université du Cap, en Afrique du Sud, le 9 avril 2015. | David Goldblatt/Fondation Vuitton
Il l’admet, être photographe blanc durant l’apartheid lui permettait d’aller partout ou presque, avec ou sans permission. Il pouvait photographier les fermiers afrikaners de Randfontein, la bourgeoisie blanche de Johannesburg et les habitants du ghetto de Soweto. Mais sans parler le zulu, sans avoir leur couleur de peau, il n’a pu pénétrer l’intimité de la communauté noire. Le prix sans doute de sa liberté. Goldblatt s’est toujours tenu à distance de toute autorité, celle du gouvernement comme celle du Congrès national africain (ANC). L’irréductible a même subi les foudres de l’ANC, qui lui reproche en 1983 d’exposer en Grande-Bretagne.
Il le martèle, une situation aussi absurde et inique que l’apartheid ne peut s’observer qu’avec du recul. « Il faut être dépassionné et passionné, comme un médecin qui regarde un patient malade », explique-t-il. Un état d’esprit qu’il a transmis à ses disciples du Market Photo Workshop, une école sans discrimination raciale qu’il a fondée en 1989, et d’où est sortie la fine fleur des photographes sud-africains comme Zanele Muholi.
« Etre là » : l’Afrique du Sud, une scène contemporaine
En 1994, trois ans après la fin du régime ségrégationniste, Goldblatt n’a pas baissé la garde. En témoigne sa série « Structures of Dominion and Democracy », poursuivie jusqu’en 2014. La place de la Liberté, rebaptisée Walter Sisulu Square of Dedication, où convergeaient autrefois les marchands ambulants, a été assainie. Un mémorial à l’architecture ampoulé y a été érigé.
Rien de démocratique dans cet édifice dans le pur style néofasciste. Goldblatt est furieux de ces dérives, mais refuse les raccourcis. « On ne peut pas comparer avec ce qui s’est passé durant l’apartheid où des Noirs ou des Indiens ont été déplacés de force à quarante kilomètres de chez eux pour faire de la place pour les Blancs. La démocratie n’est pas un système absurde alors que l’apartheid l’était, c’était immoral, incompréhensible. »
« Je suis en colère »
Malgré quelques incursions récentes dans la couleur, le photographe déroge peu au noir et blanc. « C’est difficile de faire passer la colère avec de la couleur, et je suis en colère », confie-t-il. En colère, il l’est en premier lieu contre la direction de l’université du Cap, qui n’a pas su stopper les débordements des étudiants protestant contre l’augmentation des frais universitaires. Les manifestations ont culminé dans des amphis saccagés et des bibliothèques brûlées.
« Ce qui se passe en ce moment est un grand gâchis », déplore le démocrate, tellement courroucé qu’il a renoncé au legs de photos et d’archives qu’il avait prévu de faire à l’université. « Le mouvement de conscience noire actuel n’est pas démocratique, alors que Steve Biko, lui, prônait la non-violence, dit-il. En démocratie, on parle, on ne sort pas des armes à feu, on ne menace pas. » Ces dérives conduisent l’octogénaire à s’entêter, à documenter, plus qu’à lâcher prise. « Cet endroit est le mien, j’y suis engagé, déclare-t-il. C’est là où sont mes tripes, mes viscères. Je détesterais être ailleurs. ».
Ce portfolio tiré du hors-série du Monde, Art, le printemps africain, 84 pages, 12 euros, en librairie et sur boutique.lemonde.fr.
Exposition Afrique du Sud « Etre là », Fondation Louis-Vuitton, du 26 avril au 28 août 2017.