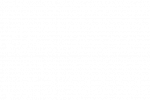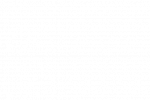A la résidence de la Femis, on peut « faire du cinéma sans être dans les clous »

A la résidence de la Femis, on peut « faire du cinéma sans être dans les clous »
Par Mathilde Dumazet
Reportage auprès de quatre étudiants issus de cette formation accessible aux non-diplômés.
Les élèves de la Résidence dans la cour de la Fémis. De gauche à droite : Lawrence, Madanie, Sarah et Sofiane | La Fémis
La promotion entière du programme de la Résidence de la Fémis est assise autour de la table d’un café, à quelques mètres de l’école de cinéma parisienne. Pas besoin de jouer des coudes, ils sont quatre : Lawrence Valin, Madanie Boussaïd, Sarah Al Atassi et Sofiane Halis. Ils sortent à peine de leur oral de fin d’étude et les mots se bousculent, avant de sortir timidement pour faire le bilan des onze mois de formation qui s’achèvent.
En septembre dernier, ils ont intégré un cursus sans exigence de diplôme préalable, contrairement aux parcours traditionnels de l’école. En moins d’un an, ils ont chacun réalisé un court-métrage ; une année « courte » mais « intense », sans laquelle ils n’auraient pas pu trouver les moyens pour concrétiser leur idée. Soutenue par le CNC, la Fondation Culture et Diversité et la Fondation France Télévisions, la Résidence donne à des jeunes de moins de trente ans, issus de milieux défavorisés, la possibilité de s’exprimer dans des conditions professionnelles idéales. Ils ont été prévenus : à la sortie de l’école, ça ne sera pas aussi facile. Mais leur accompagnement ne s’arrête pas à leur diplôme. Lancé depuis deux ans, le programme est encore en phase d’expérimentation.
« T’as pleuré ? »
De l’avis général, la journée des oraux a été l’une des étapes les plus stressantes. Madanie Boussaïd a « fait le ménage toute la nuit » car il n’en dort plus. Sofiane Halis est allé courir tôt le matin. « J’ai invité ma famille à la projection, j’avais peur de les décevoir, avoue Lawrence Valin, je ne leur ai presque pas donné de signe de vie pendant toute l’année… » « T’as pleuré ? » demande Madanie. Oui, car pour la première fois, Lawrence voyait son film en dehors de la salle de montage. Avec un public. « Le cinéma a le pouvoir de renouer des liens, un pouvoir de partage », ajoute Sarah Al Atassi, dont les parents aussi sont venus, alors qu’ils étaient en froid depuis trois ans.
Entre les quatre, pas de compétition, plutôt de l’exigence, de la tendresse et beaucoup de taquineries. Le jury n’était pas là pour les départager mais pour se prononcer sur un produit fini. « C’est le moment où l’on te dit que tu as le droit de faire du cinéma même si tu n’es pas dans les clous », conclut Sarah Al Atassi, convaincue que son enfance « en province » rendait jusque-là inaccessible son désir de mise en scène. Sofiane Halis acquiesce : « avant, je travaillais dans une boîte d’informatique. J’avais fait un court-métrage en indépendant, je pensais que c’était facile de faire un film mais non ! La Résidence m’a donné confiance. »
Parler de tout
Madanie Boussaïd avait déjà quelques courts-métrages à son actif, réalisés dans le cadre d’associations en contact avec la Fémis (1000 visages, Atelier Varan, La Ruche). Généreux en silences, le jeune réalisateur s’ouvre dès qu’il s’agit de parler de son film, un documentaire. Il y dresse le portrait de Nordine, un ancien voisin qui a une passion : se prendre en photo avec les stars. « Il a mis de côté un modèle de vie, il est à la marge, pour pouvoir vivre ce moment de plaisir qu’est celui de la photo. »
La marginalité n’est pas le sujet principal des quatre courts-métrages mais elle reste constamment présente. « On peut donner la parole à des cultures sous-représentées sans faire un cinéma très engagé, explique Sarah Al Atassi. Même si on n’a pas de slogan, on peut juste interroger. » Elle veut susciter une émotion, voir les clichés se renverser en les poussant à leur paroxysme. Son film, « c’est un duel entre deux mâles dans la campagne industrielle, un film de corps, pensé violent. Ca peut refléter ma difficulté à m’adapter au monde. Ce n’est pas très joyeux… mais la Fémis nous donne le droit de ne pas être joyeux. »
Marre de jouer l’indien de service
Depuis six ans, Lawrence Valin est aussi comédien. Il en avait « marre de jouer l’Indien de service ». « Au lieu d’attendre qu’un réalisateur prenne les devants, je fonce, je me mets en scène en espérant changer la perception qu’ont les gens de la communauté indienne et sri-lankaise. » Il est arrivé à la Fémis avec trop d’idées, l’école l’a canalisé. Pour son film, il voulait un tigre. « Il est vite passé à la trappe, ça coûte 8 000 euros sur un tournage. »
Dès sa rencontre avec Sofiane Halis, au lendemain de leur admission, Lawrence Valin lui a confié ses projets. « Il m’a immédiatement dit qu’il voulait parler des gangs tamouls à La Chapelle […] pour moi ça a été plus compliqué, je voulais parler de tout : d’amour, d’amitié. Finalement je me suis concentré sur une histoire entre un homme et un chien ». Ses deux personnages principaux (humains) du film sont immigrés : le jeune réalisateur voulait mêler l’arabe et le français, pour rendre hommage à sa mère.
« C’est quoi ton rêve, Sofiane ? » « Gagner la Palme d’Or ! ». Ils rigolent tous. Une palme d’or pour un film sur les Tamouls d’un réalisateur issu de cette communauté, une autre pour un film sur des hommes qui se battent dirigé par une femme, encore une pour un film dans lequel on entend autant d’arabe que de français ou tout simplement pour un film qui parle des stars de cinéma… pour tous les quatre, il y a matière à rêver !