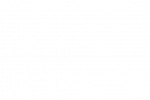Eva Doumbia, vigie afropéenne

Eva Doumbia, vigie afropéenne
Par Séverine Kodjo-Grandvaux (contributrice Le Monde Afrique, Douala)
Portrait d’une metteure en scène qui questionne la place des Noires dans la société française et appelle à un renouveau du théâtre hexagonal.
Une couronne de plumes jaunes sur la tête qui n’est pas sans rappeler la ceinture de bananes de Joséphine Baker, Eva Doumbia s’affaire derrière les fourneaux. Casseroles, autocuiseur pour riz, boîtes d’épices… et, étalés sur un pagne sur le devant du plateau, des tomates et des bananes. Un musicien l’accompagne. Il s’agit de Lionel Elian, son compagnon, qui, lorsque sa mère lui demande ce qu’Eva Doumbia mange avant de la recevoir, répond tout de go : « Des bananes. » « En fait, elle voulait savoir si je mangeais du porc », raconte la metteure en scène née en 1968 d’une mère normande et d’un père malinké.
A partir de son histoire familiale et de sa position de femme perçue avant tout comme noire dans la société française, Eva Doumbia interroge avec intelligence et perspicacité les rapports raciaux nés de l’histoire française esclavagiste et coloniale, en utilisant un médium original : les aliments. Comment se fait-il qu’il n’y a pas si longtemps encore (en octobre 2013), l’on jetait à la figure d’une garde des sceaux de la République française, Christiane Taubira, une banane en la traitant de guenon ? Parce qu’une idéologie raciste toujours bien vivace compare les Noirs à des singes, lesquels, contrairement à une idée répandue, ne mangent pas de bananes dans la nature…
« Interroger les formes modernes d’esclavage »
La performance Moi et mes grandes histoires de bananes, riz, tomates, présentée à la Chapelle du Verbe incarné le 20 juillet à Avignon, dans le cadre du Off de l’un des plus importants festivals de théâtre au monde, retrace la généalogie de ces aliments assimilés dans notre imaginaire à l’Afrique et qui, pourtant, ne sont venus que tardivement dans la cuisine et l’agriculture africaines : la banane, le riz, la tomate, le cacao, nombre d’épices, etc. Des aliments qui témoignent d’une très longue histoire mondiale de l’Afrique et, pour certains d’entre eux, d’une histoire singulière, celle du commerce triangulaire. « L’on a déporté des hommes et des femmes d’Afrique, les a réduits eux et leurs enfants en esclavage pour que dans les cours européennes l’on puisse boire un bon chocolat chaud sucré. Tout ça pour ça ? », interroge Eva Doumbia sans chercher à culpabiliser les consommateurs d’un cacao produit en Côte d’Ivoire dans des conditions totalement inéquitables.
A la fin de sa performance, encore en chantier mais très prometteuse, elle invite les spectateurs à partager le repas qu’elle a préparé sur scène pour honorer les victimes de ce passé toujours bien présent. « Je voudrais mettre du sens dans ce que l’on mange, partir de l’histoire des Noirs et interroger les formes modernes d’esclavage, y compris l’industrialisation du vivant, des animaux. Lorsque j’observe les fermes industrielles, j’ai du mal à me dire que c’est différent de l’esclavage parce qu’il ne s’agit pas d’êtres humains. On ne sait pas comment se vivent les autres vivants », précise cette grande lectrice devenue végétarienne, qui a dévoré Défaite des maîtres et possesseurs, de Vincent Message. Et d’ajouter : « Depuis l’enfance, je ne fais pas de différence entre l’homme et l’animal. Je suis profondément animiste. Pour moi, tout ce qui respire a une âme. J’avais envie de parler du respect de toute vie, du vivant, en partant de mon être de femme noire. »
Son être de femme noire porte son verbe et affute son regard. C’est sa vigie qui lui permet de dire si une société est saine ou malade, selon qu’elle respecte ou pas les siens, selon qu’elle les étouffe ou non dans un modèle unidimensionnel. C’est cet être de femme française noire qu’elle explore dès 2011 dans un cabaret intitulé Moi et mon cheveu et dans Afropéennes, une mise en scène de textes de Léonora Miano repris cette année sous leur titre initial d’Écrits pour la parole. Jouée également dans le Off d’Avignon, du 12 au 14 juillet à L’Entrepôt, cette création au souffle nouveau, extrêmement bien rythmée, évoque les préoccupations et les désirs, le désespoir et les joies des femmes françaises noires, leurs relations professionnelles ou amoureuses avec les hommes, le regard des femmes blanches…
« Interdites de spectacle de fin d’année »
« Je n’arrive pas à me défaire de cette pièce, qui est le spectacle d’une communauté, d’une histoire qui ne se dit pas ailleurs. Je voulais continuer et pousser le travail. La femme française noire n’est pas racontée au théâtre, la famille noire non plus », confie celle qui a grandi à Gonfreville-l’Orcher, dans l’unique « famille noire, africaine » de cette bourgade proche du Havre. « Je n’y ai pas vécu un racisme frontal comme dans le Sud où je suis désormais installée, détaille la Franco-Ivoiro-Malienne. On ne nous disait pas de “rentrer chez nous” mais ma sœur et moi, qui faisions de la danse classique, étions interdites de spectacle de fin d’année. On ne voulait pas de nous sur scène. Les agressions frontales étaient davantage tournées vers ma mère, y compris au sein de sa propre famille, et bien sûr, envers notre père. »
Un père qui a élevé les quatre frères et sœurs à la dure. « Chez moi, c’était étouffant. Le patriarcat était très fort », explique-t-elle. Eva trouve rapidement un « espace de liberté » dans le théâtre. Elle part l’étudier à l’université d’Aix-en-Provence avant de se produire dans les milieux alternatifs dans les années 1990 et de monter sa compagnie, La part du pauvre, en 1999 à Marseille, et Nana Triban en Côte d’Ivoire en 2002. L’artiste, qui fut associée du Théâtre des Bernadines, interroge continuellement la double histoire dont elle est l’héritière, celle de l’Afrique et celle de l’Europe. Une histoire commune douloureuse qu’elle met en scène notamment dans La Traversée et qui invite à repenser et à retravailler les récits, les esthétiques et les représentativités.
Eva Doumbia au premier plan en train de se faire tisser les cheveux sur scène pour son spectacle de cabaret « Moi et mon cheveu ». | DR
Un travail auquel elle appelle également à travers le collectif Décoloniser les arts, dont elle est cofondatrice avec la poétesse et dramaturge guadeloupéenne Gerty Dambury. « Décoloniser les arts, c’est une manière de décoloniser la société et les mentalités, de déconstruire notre héritage colonial. C’est un travail que nous ne pouvons pas mener seuls, il faudrait pouvoir, par exemple, le mener avec les enseignants », avance Eva Doumbia. Ce travail permettrait enfin de donner toute leur place à ces Françaises et à ces Français non blancs sur les plateaux des scènes nationales, mais aussi à leur direction. Aujourd’hui, rappelle Leïla Cukierman, du collectif Décoloniser les arts, on compte « 1 % de “racisés” à la direction de centres dramatiques nationaux, 4 % à la direction de centres chorégraphiques nationaux, 1 % au sein des comités d’experts et des conseils d’administration ».