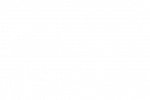La sélection littéraire du « Monde »

La sélection littéraire du « Monde »
Chaque jeudi, dans La Matinale, les critiques du « Monde des livres » vous font partager leurs coups de cœur.
LES CHOIX DE LA MATINALE
Cette semaine, nos livres puisent leur force aux sources de la nature ou du pays.
Roman. « Les Fantômes du vieux pays », de Nathan Hill
Avant de l’abandonner lorsqu’il avait 11 ans, la mère de Samuel, Faye, lui a raconté des légendes de Norvège qu’elle tenait de son propre père. L’une d’elles se concluait sur cette morale : « Les choses que tu aimes le plus sont celles qui un jour te feront le plus mal. » Croisant les histoires de Samuel et de Faye (que le premier retrouve, vingt ans après sa disparition, devenue célèbre pour avoir jeté des pierres sur un homme politique ultraconservateur), Les Fantômes du vieux pays raconte ainsi la solitude de ces deux êtres convaincus que s’attacher revient à se condamner à la souffrance. Comme eux, tous les personnages du premier roman de Nathan Hill sont en proie à la déréliction.
Avec ce premier roman prodigieux, d’une ambition aussi ahurissante que son souffle, l’écrivain américain plonge alternativement le lecteur dans la jeunesse de Faye, au cœur des protestataires années 1960, dans l’enfance silencieuse de son fils, auprès d’un unique ami dont la sœur sera le grand amour de sa vie, et dans les années 2000, marquées par la contestation de la guerre en Irak comme par le mouvement Occupy Wall Street.
Nathan Hill manie des registres narratifs divers, passe avec aisance de la satire au tragique et offre avec ce somptueux pavé l’une de ces si rares bulles de fiction où l’on voudrait pouvoir se lover pour toujours. L’un de ces romans rappelant que, grâce à la littérature, on n’est jamais seul au monde. Raphaëlle Leyris
Les Fantômes du vieux pays (The Nix), de Nathan Hill, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Mathilde Bach, Gallimard, « Du monde entier », 720 p., 25 €.
Roman. « Les Huit Montagnes », de Paolo Cognetti
Un jeune chimiste milanais tombe amoureux de la montagne. Avec sa fougue de scientifique, il se passionne pour la neige, ses cristaux, « les formes qu’elle prend, son caractère changeant, son langage ». Mais aussi pour les peaux de phoque et les cuites à la grappa. « On aurait dit qu’il avait découvert un monde complètement différent », écrit Paolo Cognetti. Un univers à « la saveur plus dure et plus réelle », dont il transmettra la passion à son fils, Pietro – le narrateur – au fil de leurs étés dans le Val d’Aoste…
Adulte, Pietro oublie la montagne. Jusqu’à ce que, à la faveur d’une crise, autour de la trentaine, il la redécouvre et s’y installe. Là, il retrouve Bruno, son ami d’enfance, resserre les liens avec sa propre mère, et fait émerger – comme un corps rejeté par un glacier très longtemps après sa disparition – le secret enseveli qui, juste avant sa naissance, fonda sa famille.
Dans ce splendide roman, il est question de l’intimité avec les arbres, les lacs, les pierriers. De l’existence frugale d’un berger ou d’un maçon. Du « sentiment d’abandon devant une civilisation alpine aujourd’hui disparue ». Et, surtout, d’une très complexe relation père-fils. Et puis, il y a le personnage central du livre, la montagne. Souriante. Impitoyable. Et la façon dont elle forme et transforme nos vies minuscules, les enchante ou les engloutit, grogne telle une « énorme bête dérangée dans son sommeil » puis se rendort, comme si pour elle il ne se passait jamais rien. Florence Noiville
Les Huit Montagnes (Le otto montagne), de Paolo Cognetti, traduit de l’italien par Anita Rochedy, Stock, « La cosmopolite », 304 p., 21,50 €.
Récit. « Souvenirs de la marée basse », de Chantal Thomas
Histoire d’eau. Histoire d’elles, Jackie et Chantal, qu’unit autant que la filiation une passion éperdue pour la nage en mer. Sans souci de compétition. Seule compte la liberté du corps, en communion avec les éléments, délesté de toute contrainte, de toute attache. Mais si, pour la mère, l’eau est un refuge, le seul monde où elle ait sa place, aux yeux de sa fille, c’est juste le lieu du ressourcement qui offre l’énergie et la légèreté nécessaires pour faire face.
Des rivages de l’Atlantique (Arcachon) à ceux de la Méditerranée (Nice, puis Villefranche-sur-Mer), Jackie s’évade et Chantal suit la migration, communiant toujours avec cette mère impossible à saisir. Mais, au fil des décennies, alors qu’elle devient la complice bienveillante d’une femme, coquette et distraite, qui ne se résigne pas à la gravité du monde, le regard s’adoucit sur cette « étrangère très particulière qui [lui] est devenue une sorte d’amie ».
Inattendue, la fusion se révèle enfin le jour où, dépassant la proximité physique et la familiarité intemporelle, Chantal surprend sa mère, bataillant seule face aux éléments, vaillante et superbe. « J’ai été traversée par la force mystérieuse de l’amour. Nous ne faisions qu’une. Et qui, d’elle ou de moi, dans le brouillage des tourbillons de pluie, était prête à se laisser emporter par la vague ne comptait pas. » Philippe-Jean Catinchi
Souvenirs de la marée basse, de Chantal Thomas, Seuil, « Fiction & Cie », 224 p., 18 €.
Essai. « Le Champignon de la fin du monde », d’Anna Lowenhaupt Tsing
C’est l’histoire d’un champignon, appelé matsutake, dont raffolent les riches Japonais depuis des siècles, disparu des forêts japonaises à cause de l’exploitation industrielle – cette même exploitation industrielle qui, dans un contexte écologique différent, l’a au contraire fait pousser en masse à l’autre bout du Pacifique, dans les forêts de l’Oregon, dans lesquelles se rue aujourd’hui une foule hétéroclite de cueilleurs.
C’est cette histoire extraordinaire qu’Anna Tsing, anthropologue à l’université de Californie à Santa Cruz, raconte avec talent dans son ouvrage. Le champignon lui permet de dépasser de façon fulgurante la vision communément admise de ce qu’est l’économie, la politique et la science, par une nouvelle approche issue du constat suivant : le capitalisme mondialisé n’est plus seulement un vecteur de progrès de la condition humaine, il est aussi, par l’extension continuelle de sa prédation, celui de la destruction de la planète et de la fragilisation de ses habitants, humains et non-humains.
Néanmoins, au lieu de se contenter de s’opposer à cette destruction, l’auteure invite à « chercher du côté de ce qui a été ignoré, de ce qui n’a jamais concordé avec la linéarité du progrès », à observer ce qui se passe au milieu des ruines laissées par la prédation capitaliste : « Quand on vit dans l’indéterminé, de telles lueurs constituent la politique. » Antoine Reverchon
Le Champignon de la fin du monde. Sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme (The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist Ruins), d’Anna Lowenhaupt Tsing, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Philippe Pignarre, La Découverte, « Les Empêcheurs de penser en rond », 416 p., 23,50 €.