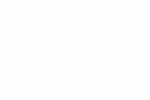En Ethiopie, la colère sourde des Amhara contre le pouvoir

En Ethiopie, la colère sourde des Amhara contre le pouvoir
Par Emeline Wuilbercq (Bahar Dar, Ethiopie, envoyée spéciale)
Depuis qu’une manifestation à Bahar Dar a été réprimée dans le sang, les habitants n’osent plus critiquer le gouvernement, mais certains songent à prendre les armes.
Il y a deux semaines, Tibebe* a passé la journée en prison. Tatouage sur le bras, cicatrices sur le visage, le garçon, trapu, la vingtaine, est un habitué des geôles éthiopiennes. Cette fois, la police l’a surpris en train de consommer du khat. Une drogue illégale aux Etats-Unis et presque partout en Europe, mais pas en Ethiopie, où l’on raffole de ces petites feuilles au goût amer, que l’on mâche pour ses effets stimulants. Mais dans les lieux publics de Bahar Dar, une grande ville à près de 600 km au nord-ouest de la capitale, Addis-Abeba, c’est désormais interdit.
« Quand tu consommes du khat, tu échanges des idées » pas forcément favorables au pouvoir en place, lâche Tibebe, pour qui la raison est claire : les autorités se méfient de ces moments où les hommes se rassemblent. « Ceux qui consomment sont ceux qui dérangent », résume un autre dans une avant-cour fermée par des bâches où des jeunes se cachent pour « khater ». « Ici, tu ne peux pas t’exprimer librement, crache un troisième. Si tu es soupçonné de dire du mal du gouvernement, tu es battu comme un âne et jeté en prison ! »
Attaques à la grenade
En août 2016, Bahar Dar, la capitale de la région Amhara, a été secouée par un mouvement de contestation sans précédent. Des milliers de personnes ont manifesté contre le pouvoir central. Selon Amnesty International, le rassemblement, réprimé dans le sang, a fait au moins 30 morts, qui se sont ajoutés au bilan déjà lourd de la répression des manifestations dans la région Oromia, dans le centre et l’ouest du pays. Les Oromo – « nationalité », selon la terminologie de la Constitution éthiopienne, qui réunit plus de 30 millions de personnes –, se sont soulevés depuis novembre 2015. En tout, près d’un millier d’individus sont morts en 2015 et 2016, selon la Commission éthiopienne des droits de l’homme, liée au gouvernement.
Après une intensification des violences à travers le pays et des incidents dirigés contre les intérêts économiques, l’état d’urgence avait été déclaré en octobre 2016, avec une interdiction de manifester sans autorisation. Malgré sa levée en août, les autorités ont de nouveau interdit, vendredi 10 novembre, les rassemblements en Ethiopie. La décision a été prise dans le but de « prévenir les décès et la destruction des propriétés », a déclaré le ministre de la défense, Siraj Fagessa. Cela fait suite à un regain de tensions dans le pays, notamment en région Oromia : au moins dix personnes ont été tuées, le 26 octobre, à Ambo, à 120 km d’Addis-Abeba, lorsque les forces spéciales de sécurité ont tiré des coups de feu sur les manifestants.
Contrairement aux Oromo, les Amhara, qui sont près de 20 millions, n’ont organisé aucun soulèvement populaire depuis août 2016. Leurs méthodes sont différentes : une série d’attaques à la grenade a touché Bahar Dar et Gondar, autre fief de la contestation. Des mouvements de désobéissance civile ont éclos sporadiquement, des commerçants fermant boutique pour faire grève et les habitants ne sortant pas de chez eux.
Ici, la colère, contenue, se manifeste autrement. Certaines entreprises sont non gratæ, comme la compagnie de bus Selam et la brasserie Dashen, toutes deux affiliées à un parti de la coalition au pouvoir. « Si on te voit boire une bière de la marque Dashen, on va probablement t’insulter et te demander : pourquoi tu achètes une balle ? », explique Melaku, étudiant à l’université de Bahar Dar. A l’ombre d’un imposant figuier, dans la cafétéria en plein air réservée aux professeurs, Melaku, 26 ans, ne parle pas très fort. « C’est difficile, il n’y a pas de liberté d’expression », dit-il.
La peur est partout
C’était l’un des nombreux griefs des manifestants contre le gouvernement, à qui ils reprochaient notamment les violations des droits humains, la corruption et le fait de museler l’opposition, dont plusieurs chefs de file sont actuellement derrière les barreaux. Ils accusaient également le Front de libération du peuple du Tigray (TPLF), qui constitue la base politique de la coalition au pouvoir depuis plus d’un quart de siècle, de favoriser la minorité des Tigréens, et de marginaliser les Amhara et les Oromo, qui en constituent pourtant près des deux tiers.
La haine contre le TPLF touche aussi, par ricochets, le peuple tigréen. A l’université, les relations entre étudiants de différentes communautés se sont dégradées au moment des manifestations, indique Yacob, un étudiant tigréen pour qui des forces extérieures sont à l’origine du soulèvement populaire. C’est la rhétorique du gouvernement, qui condamne régulièrement des « éléments anti-paix » au premier rang desquels l’Erythrée, le frère ennemi, qu’il accuse de soutenir des actions terroristes sur le territoire éthiopien.
Les relations sont moins tendues désormais dans les dortoirs de l’université de Bahar Dar, mais « la peur est réciproque », pense Melaku. Des analystes blâment le type de fédéralisme en vigueur en Ethiopie qui exacerberait le sentiment d’appartenance communautaire et attiserait les conflits.
La peur est présente, partout. Peur d’être emprisonné, peur d’être dénoncé. Mulugeta ne fait plus confiance à personne à Tis Abay, un village à 30 km de Bahar Dar, où des milliers de touristes viennent admirer les chutes du Nil bleu chaque année. Il se méfie des « balances », comme les appelle l’un de ses amis. En Ethiopie, la délation fait partie du quotidien. Elle fonctionne en réseau, une personne étant chargée de contrôler et de rendre compte des activités d’un groupe de cinq dont elle fait partie.
« Une balle dans la tête »
Pour témoigner, Mulugeta se met à l’abri des regards, dans l’obscurité d’un bar où le son de la télévision peut couvrir les voix. Il a passé trois mois dans une prison bondée à Bahar Dar, à dormir à deux dans un lit minuscule, sans accès aux soins. Mais la prison n’était pas le plus dur. Le plus dur, c’est d’avoir perdu son ami Abebe Geremew. « Il était comme mon frère », dit-il.
Abebe est mort l’an dernier. « Une balle dans la tête. » Il était au premier rang de la manifestation d’août 2016. Un cliché de lui, regard déterminé, enveloppé dans un drapeau éthiopien sans l’étoile centrale (ajoutée par la coalition au pouvoir après la chute du dictateur Mengistu), est devenu l’un des étendards de la contestation amhara sur les réseaux sociaux. « C’est un combattant pour la liberté ! », lâche son ami Binyam, un jeune maigrelet.
Aujourd’hui, le fatalisme a pris le pas sur l’audace de ceux qui étaient descendus dans la rue. « Personne ne nous soutient en Occident. Nous sommes trop pauvres pour manifester. Si je suis emprisonné, qui s’occupera de mes frères et sœurs ? », interroge Mulugeta, qui compte sur les pourboires pour gagner un salaire décent. En tant que guide, il touche environ 3 000 birrs (120 euros) par mois. Mais le nombre de touristes s’est réduit comme peau de chagrin, en 2016, à cause des troubles politiques et des avertissements des ambassades aux voyageurs. « Tout est trop cher ici », poursuit-il, avec l’impression de ne pas bénéficier des fruits d’une croissance estimée à 8,5 % en 2017.
Pour autant, si un autre rassemblement s’organise, ses amis et lui n’iront pas. « Plus de drame ! », dit Binyam. « Nous ne voulons pas mourir pour rien. Si nous voulons protester, nous devons prendre les armes », ajoute Mulugeta, qui raconte que plusieurs policiers ont été tués par des riverains dans son village. Début novembre, les autorités auraient arrêté deux membres d’un groupe rebelle interdit, Ginbot 7, qui, selon elles, préparaient des attentats à la bombe dans la région.
Mulugeta, Binyam et leurs amis, eux, ne soutiennent aucun parti d’opposition, aucun groupe armé. « Je déteste juste le gouvernement », affirme le premier. « Les Ethiopiens sont conscients de ce qui se passe, que des gens sont tués, ils sont mieux informés qu’avant », poursuit le second. Il marque une pause. « Le temps viendra… et, à la fin, on combattra. »
* Tous les prénoms ont été changés.