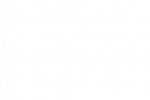A Bruxelles, pas de sanctions en vue pour l’Autriche
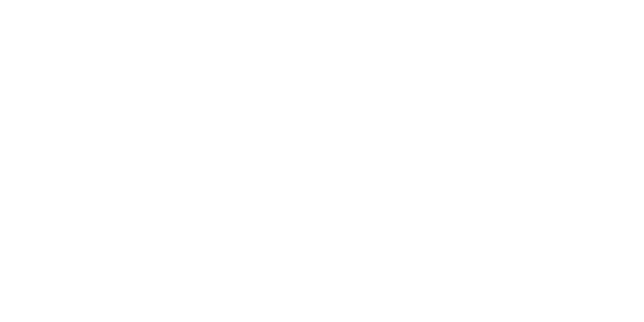
A Bruxelles, pas de sanctions en vue pour l’Autriche
Par Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, bureau européen)
L’Italie s’inquiète des risques « de nationalisme ethnique » au regard du programme de coalition détaillé samedi par l’extrême droite et la droite autrichiennes.
Heinz-Christian Strache et le futur chancelier, Sebastian Kurz, à Vienne, le 16 décembre. / LEONHARD FOEGER/REUTERS
Si elles s’étaient réjouies, cette année, des défaites successives de l’extrême droite lors des présidentielles française et autrichienne et aux législatives néerlandaises, les institutions européennes sont restées muettes après la conclusion d’un accord de gouvernement entre la droite et l’extrême droite à Vienne, vendredi 15 décembre.
Pourtant, certaines propositions du nouveau gouvernement suscitent d’ores et déjà de vives inquiétudes. Le secrétaire d’Etat italien aux affaires étrangères, Benedetto Della Vedova, a mis en garde, dimanche 17 décembre, contre les risques d’un « nationalisme ethnique » pour critiquer l’engagement pris par la coalition autrichienne d’accorder la double nationalité aux habitants du Sud-Tyrol italien : « Ce que l’on entend depuis Vienne n’est pas dans l’esprit européen, c’est une musique nationaliste. » La région a été rattachée à l’Italie en 1919, au grand dam des milieux nationalistes autrichiens.
Différentes organisations juives ont également protesté contre le retour au pouvoir du FPÖ, une formation boycottée par Israël. Le Conseil représentatif des institutions juives de France a ainsi appelé dimanche à une « mobilisation des démocrates » contre le prochain gouvernement autrichien, et constate que « l’extrême droite gagne du terrain en Europe centrale, et personne ne semble s’en inquiéter ».
Dans l’entourage du président Jean-Claude Juncker, on se bornait dimanche à souligner que la première visite officielle du jeune chancelier Sebastian Kurz aura lieu à Bruxelles, mardi 19 décembre. Il y dialoguera notamment avec le président du collège européen et est censé y réaffirmer son engagement en faveur de l’Europe, « facteur de paix et d’intégration », dit son programme.
Bruxelles peut, d’ici là, au moins se satisfaire de la prise de position de la nouvelle coalition formée à Vienne : elle a rapidement exclu, à la demande des conservateurs, tout référendum sur une éventuelle sortie de l’Autriche de l’Union : pas de « Öxit » à l’horizon. « Etant donné le contexte, il faut se contenter de peu », ironise un diplomate.
« Cela promet des discussions houleuses »
La coalition emmenée par M. Kurz va, en tout cas, rejoindre le camp de ceux qui militent pour davantage de subsidiarité (plus de compétences pour les Etats membres) « chaque fois que cela est possible », ainsi que le déclarait samedi le nouveau chancelier. Il prône, en revanche, une coopération plus poussée dans la défense des frontières, confirmant que la lutte contre l’immigration illégale sera sa priorité. Selon un haut fonctionnaire bruxellois, la chose est claire :
« Ses prises de position antérieures pour la fermeture de la route des Balkans, son alliance avec un parti qui dénonce l’invasion de masse et le prétendu risque de guerre civile, la présentation de son gouvernement dans un lieu symbolique de la reconquête de l’Europe centrale par les chrétiens au détriment des Ottomans ou la préférence nationale qu’il affiche… Tout cela promet des discussions houleuses lorsqu’il s’agira notamment de définir une politique migratoire. »
Or, c’est l’un des principaux objectifs au sein de l’UE, qui entend dégager un compromis en juin 2018, peu avant que l’Autriche n’assume la présidence tournante de l’Union, le 1er juillet. Un ralliement de Vienne aux positions très dures des membres du groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie), compliquerait un peu plus la recherche d’une solution.
Si elle s’inquiète de l’arrivée du FPÖ de Heinz-Christian Strache au pouvoir – un événement « véritablement historique » selon la présidente du Front national, Marine Le Pen – l’Union ne songe en tout cas plus aux sanctions qu’elle avait décrétées en 2000, lors de la première participation de ce parti à une coalition avec les conservateurs.
Sanctions sans véritable effet
Les pays membres de l’UE – elle regroupait alors 15 Etats – avaient décidé d’interrompre tout contact bilatéral avec le nouveau pouvoir, de limiter le rôle de ses ambassadeurs et de priver de soutien les candidats autrichiens à des postes dans les organisations internationales. Ces sanctions, sans véritable effet, furent levées sept mois plus tard.
Le gouvernement du chancelier Wolfgang Schlüssel était, lui aussi, parvenu à convaincre Bruxelles qu’il coopérerait de manière « constructive et engagée » au fonctionnement de l’Union. L’extrême droite autrichienne, conduite alors par Jörg Haider, était hostile à l’introduction de l’euro et à l’élargissement.
Pas de quoi convaincre le Belge Louis Michel, ministre des affaires étrangères à l’époque, qui allait devenir commissaire européen en 2004 et avait pris la tête d’une campagne contre Vienne, jugeant notamment « immoral » que l’on aille encore faire du ski en Autriche. M. Michel, actuellement eurodéputé, avait participé à une manifestation anti-FPÖ qui rassembla 15 000 personnes à Bruxelles. Un défilé où l’on notait la présence d’anciens déportés.
Aujourd’hui, interrogé par Le Monde, M. Michel ne décolère toujours pas. « Le problème est que les traités actuels ne nous permettent pas d’obliger des Etats à respecter l’esprit et la lettre du projet européen, explique-t-il. J’espère au moins que, mardi, M. Juncker rappellera fermement nos principes et nos valeurs. »