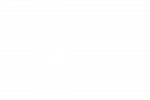« Charlie Hebdo » : trois ans après l’attentat, les journalistes témoignent de leur état d’esprit

« Charlie Hebdo » : trois ans après l’attentat, les journalistes témoignent de leur état d’esprit
Des collaborateurs de l’hebdomadaire satirique prennent la parole avant les hommage aux victimes du 7 janvier 2015. Philippe Lançon explique notamment que le slogan « Je suis Charlie » a « vite cessé de [le] convaincre ».
Mosaïque de graffitis en hommage aux victimes de l’attentat de « Charlie Hebdo » en janvier 2015. / JOEL SAGET / AFP
Trois ans après l’attentat contre Charlie Hebdo par les frères Kouachi, qui ont tué douze personnes dans les locaux de l’hebdomadaire, plusieurs collaborateurs du titre prennent la parole pour expliquer à quoi ressemblent leurs vies depuis le 7 janvier 2015, décrire leurs rapports au journal et au slogan « Je suis Charlie ».
Sur le site de Libération, le journaliste Philippe Lançon livre un témoignage poignant à propos du slogan « Je suis Charlie ». Lui-même victime de l’attentat, gravement blessé à la mâchoire, il explique dans sa tribune que « ce slogan a vite cessé de [le] convaincre ».
Le journaliste de Libé et de Charlie Hebdo juge qu’« au départ (…) “Je suis Charlie” était un cri humaniste, d’effroi et de mélancolie. (…) On se levait pour un principe, pour la vie, pour un principe de vie ». Il déplore que ce slogan a ensuite été détourné en même temps que « l’idéologie s’est installée ».
« Très vite, l’individualisme publicitaire du slogan s’est dilué dans les diverses et inévitables traductions politiques dont il fut l’objet. (…) “Je suis Charlie” est devenu l’étiquette magique qu’on faisait valser au gré de ses intérêts, de ses combats et de ses préjugés ; en clair, une injonction. »
Philippe Lançon critique cette injonction qui « visait à regrouper autant qu’à exclure, à regrouper en excluant (…) Dès qu’un slogan apparaît comme l’arme d’un pouvoir, tous ceux qui se sentent à tort ou à raison désignés par ce slogan, par ce pouvoir, ont un plaisir nerveux à s’y opposer. Résister à l’ordre et au consensus est souvent un point d’orgueil, mais aussi une manière d’exister », explique celui qui écrit pour Libération depuis vingt-quatre ans.
Il martèle qu’il n’a « jamais attendu de qui que ce soit qu’il me dise : “Je suis Charlie”, avant d’évoquer ce que veulent dire ces trois mots pour lui : « “Je suis Charlie” continue donc simplement de signifier pour moi : je veux me sentir libre d’écrire et de lire ce qui me chante, et que les autres bénéficient de cette liberté. »
Cette tribune paraît alors que l’événement « Toujours Charlie, de la mémoire au combat » se déroule samedi 6 janvier aux Folies-Bergère, à Paris. Organisé notamment par le Printemps républicain, l’événement en faveur de la liberté d’expression est vu par ses détracteurs comme une tentative de récupération.
« On ne s’appartient plus totalement »
Gravement touché aux jambes et à l’abdomen, le journaliste Fabrice Nicolino raconte, lui, combien « c’est flippant de travailler à Charlie ». Il a confié à France Info « presque rire » de menaces que ses collègues et lui-même jugent « totalement délirantes », mais que « d’autres [leurs] font penser qu’il y a derrière des gens très sérieux et qui sont capables de passer aux actes. (…) On peut encore se faire plomber par ces crétins ».
« De terribles mesures de protection », « des voitures lourdement blindées », « beaucoup de flics »… Fabrice Nicolino énumère les moyens utilisés pour protéger les journalistes et collaborateurs de Charlie Hebdo. L’hebdomadaire est « en état de siège en plein Paris en 2018 », ce qui provoque une ambiance « fatalement anxiogène », mais « l’ambiance n’est pas sinistre », selon lui. Une « panic room » a été créée, « un endroit ultra-sécurisé où on est censé se précipiter en cas d’alerte », ajoute-t-il.
« Il y a une responsabilité morale et politique à continuer ce journal. On ne s’appartient plus totalement, on appartient à cette lutte séculaire pour la liberté et la démocratie. On ne peut pas se débiner. »
Des déclarations qui recoupent ce qu’a publié Charlie Hebdo mercredi 3 janvier, dans un numéro spécial racontant l’impact d’un traumatisme qui continue de bouleverser profondément son fonctionnement. Le dessinateur et caricaturiste Riss, directeur de la rédaction, y déplore notamment le coût très lourd de la protection des locaux — « entre 1 et 1,5 million d’euros par an, entièrement à la charge du journal », soit l’équivalent de près de 800 000 exemplaires par an.