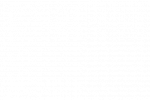« Cette histoire d’esclavage au Bénin, je l’ai apprise à l’école, mais elle ne me rend pas triste »
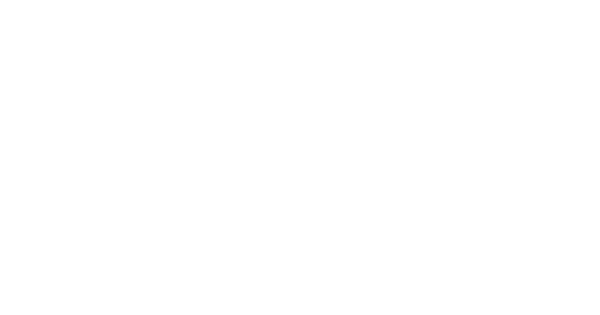
« Cette histoire d’esclavage au Bénin, je l’ai apprise à l’école, mais elle ne me rend pas triste »
Par Pierre Lepidi (envoyé spécial au Bénin)
Une semaine à pied sur les traces des esclaves du Dahomey (3/9). Sur la route de Ouidah, les habitants nous ouvrent leur porte et évoquent l’histoire de leurs « grands-grands-papas ».
La nuit est douce, silencieuse et moite. Après une première étape à Ouassougon sur l’ancienne route des esclaves au Bénin, mon guide Hubert et moi avançons sur une piste de sable quasiment rectiligne. Nous croisons des dizaines d’élèves sur le chemin de l’école, dont Carole, 16 ans, qui marche 12 km par jour pour assister aux cours. Son rêve ? Devenir infirmière.
A Dénou-Lissezin, après un baobab esseulé au milieu d’un champ, nous faisons une première pause. Dans sa buvette, dont le sable est d’une finesse soyeuse, Barthélemy Guitoï prépare une omelette baveuse copieusement garnie d’oignons. « Bien sûr que je connais l’histoire de cette route !, s’exclame-t-il. Je l’ai apprise à l’école et on m’en a parlé dans ma famille. J’en ai moi-même discuté avec mes enfants récemment. Cette tragédie ne me rend pas triste, car elle s’est déroulée il y a très, très longtemps. Cette histoire concernait nos grands-grands… papas. » Barthélemy est étonné par notre projet de rallier Ouidah à pied. La discussion s’engage sur le devoir de mémoire. « Il faut que le tourisme se développe au Bénin, notre économie en a besoin. »
Les indicateurs économiques, calculés loin des champs de maïs et de sorgho que nous traversons au lever du jour, ne disent pas autre chose. Au regard de son indice de développement humain, le Bénin se classe aujourd’hui au 173e rang mondial sur 194 pays recensés. Essentiellement tournée vers l’agriculture, son économie est en grande partie alimentée par le commerce informel avec le Nigeria, au point d’atteindre 20 % du PIB.
Dans les campagnes de l’ancien Dahomey, l’argent ne coule pas à flots, mais il irrigue largement les cultes et les mouvements religieux. En reprenant la piste sablonneuse, sur moins de 500 mètres, nous passons devant l’Eglise du christianisme céleste, l’Eglise d’évangélisation du Christ au monde et l’église évangélique Union renaissance d’hommes en Christ.
Plus loin, trois villageois nous interpellent : « Nous avons débroussaillé le chemin, mais les pluies ont inondé la zone marécageuse. Si vous continuez, vous allez patauger dans la boue jusqu’au nombril… Et il y a des serpents ! A Tchito, mieux vaut suivre la voie de chemin de fer jusqu’à Toffo. »
Nom tatoué sur l’avant-bras
La ligne Cotonou-Parakou (438 km) a été créée au début du XXe siècle, à l’époque coloniale. Depuis une dizaine d’années, elle ne transporte plus de voyageurs mais uniquement du fret (coton, minerais…). Avec une vingtaine de trains par mois, la ligne s’est trouvée au centre d’un long bras de fer juridique entre l’industriel français Vincent Bolloré et l’homme d’affaires béninois Samuel Dossou, PDG du groupe Pétrolin. Le contentieux, qui concerne le projet de boucle ferroviaire de l’Ouest africain entre la Cote d’Ivoire et le Bénin, en passant par le Niger et le Burkina Faso, a été réglé fin septembre 2017 par la Cour suprême du Bénin, qui a tranché en faveur de Pétrolin.
Malgré les zemidjans, les motos-taxis, qui nous obligent à monter sur les rails pour les laisser passer, nous avançons d’un bon pas le long du ballast où aucun train ne circule. Un peu après le village de Kodji, nous croisons une femme et une adolescente qui portent des bassines d’eau sur la tête. Après quelques échanges, elles nous invitent chez elles. Nous traversons les rails, quelques champs de sorgho, et arrivons chez Brigitte Dossa et sa nièce Marthe, une cabane au toit de paille et aux planches ajourées. A l’intérieur, quelques vêtements, des sacs, une marmite et des fruits. « Reposez-vous, dit Brigitte Dossa en nous proposant des bananes. Il fait chaud aujourd’hui. »
Cette femme d’une cinquantaine d’années vend elle-même sa production d’ananas à Parakou (à environ 350 km vers le nord) et même jusqu’au Niger. Comme elle ne sait ni lire ni écrire, Brigitte a fait tatouer son nom sur son avant-bras : « S’il m’arrive quelque chose, on pourra ainsi retrouver mon village. » Comme son mari est zem à Cotonou, elle vit seule dans cette cabane isolée au milieu des plantations. « Je n’ai pas peur, maintenant j’ai l’habitude, fait-elle en haussant les épaules. Les serpents ? J’en vois passer sur la natte. On dit qu’ils ne mordent que les personnes mauvaises, celles qui n’ont pas un cœur pur. »
Brigitte Dossa (au centre) et sa famille habitent le long de la voie de chemin de fer Cotonou-Parakou. / Pierre Lepidi
Torse nu, un homme se présente soudain à l’entrée de la cabane, machette à la main. C’est Gilbert, le frère de Brigitte. Il vit à quelques kilomètres et est venu rendre visite à sa sœur. Aucun des deux ne connaît l’histoire de cette route des esclaves qui passe à côté de la maison. « Mais on raconte que le roi Agadja a envoyé ici des soldats pour capturer des gens et les réduire en esclavage, raconte Gilbert. Le vaudou Dan [dieu des airs et du firmament] se serait transformé en humain. Il est allé au-devant des gardes et leur a préparé des amiwo [une pâte rouge à base de farine de maïs]. Les hommes du roi ont fait demi-tour et ils sont morts à Abomey la nuit suivante. Dan avait empoisonné leur repas pour sauver nos ancêtres. »
Brigitte et Marthe, qui retournent chercher de l’eau au ruisseau qui coule à 500 mètres de la cabane, repartent avec nous. Et alors que nous rejoignons la voie de chemin de fer, Marthe hurle derrière moi : « Un serpent ! Un serpent ! Juste là ! » En passant, je n’ai rien vu. « Ne t’inquiète pas, lui dit Brigitte en descendant dans les fourrés. Comme tu n’as rien de fait de mal, il te laissera tranquille. »
« Vous faites un sacré voyage »
Au bout d’une heure, nous arrivons à la gare désertée de Toffo, où un homme dort allongé sur un banc. Nous remontons une piste cabossée qui débouche sur une route goudronnée. « Les esclaves dormaient à Toffo, me dit Hubert. C’était dans le champ bordé par des arbres, juste là. Ils étaient soignés par des médecins traditionnels et ceux qui ne pouvaient pas marcher étaient amenés lors d’un convoi suivant. » Certains auraient profité de leur convalescence pour s’échapper et se réfugier sur les rives du lac Nokoué, près de Cotonou. On raconte que les cités lacustres de Ganvié et de Sô-Ava, que l’on atteint en pirogue après avoir traversé d’inextricables marécages, ont été créées par des esclaves en fuite.
A la buvette « Jlo Mawu Ton » (« à la grâce de Dieu »), je descends quasiment d’une traite une bouteille de kuwabo (« bonne arrivée »), une eau légèrement citronnée. Catherine Yavon, la cinquantaine, a ouvert son établissement il y a un an. « Je suis veuve depuis un mois, confie-t-elle. J’ai rouvert la buvette il y a seulement trois jours. La vie est si injuste, parfois. » Hubert propose à Catherine que nous dormions ici contre un dédommagement. « Avec plaisir !, répond-elle. Je vais vous montrer la maison familiale qui est à côté et où il y a déjà mon frère. »
Le salon où nous allons passer la nuit est une pièce à tout faire. Il y a un bureau, une télévision, des fauteuils, deux Mobylette et, surtout, deux canapés. « On accrochera les moustiquaires entre le coin du bureau et le rétroviseur de la moto », propose Hubert.
Après une douche, nous retournons au restaurant. « Mon père m’avait dit que cette route était celle des esclaves, raconte Catherine, qui trouve un peu de temps pour s’asseoir avec nous. Je suis triste de savoir que les gens qui sont passés devant chez moi ont souffert. Mais c’était il y a tellement longtemps… Vous faites un sacré voyage et je marcherais bien avec vous jusqu’à Ouidah, mais je dois m’occuper du restaurant. Au menu du dîner, j’ai de l’agou avec de la viande de bœuf et de la sauce d’arachide : ça vous va ? »
L’agou, une pâte d’igname pilé, se mange avec les doigts en la trempant dans une sauce pimentée. A la fin du repas, Hubert extrait de son sac une petite bouteille de Coca remplie de vin de palme. « Nestor [l’ancien maire du village où nous avons dormi la veille] me l’a donnée discrètement », sourit le guide.
Un signe de l’au-delà
Une amitié est en train de naître avec Hubert, dont j’apprécie la culture, l’humour et l’insatiable envie de savoir, de comprendre. Au cours de la soirée, Hubert me confie qu’il a perdu son père en 1991. Moi c’était ma mère, la même année. En comparant les dates de ces événements qui ont marqué nos vies, on réalise que c’était tous les deux un dimanche, à seulement une semaine d’intervalle.
Ce qui pourrait être considéré ailleurs comme une coïncidence peut être interprété au pays du vaudou comme un signe de l’au-delà, un clin d’œil des « forces de l’esprit », comme disait François Mitterrand. Ici, on ne considère pas la mort comme la fin de la vie mais comme un voyage. « Il faut interroger la divinité Fâ, assure Hubert. Je te tiendrai au courant. » Au loin, des orages déchirent la nuit. Je m’allonge sur le canapé du salon et sombre dans un sommeil de plomb.
Sommaire de notre série Une semaine à pied sur les traces des esclaves du Dahomey
D’Abomey à Ouidah, notre reporter a emprunté la route suivie en 1860 par Cudjo Lewis, le dernier esclave de la traite négrière vers les Etats-Unis.