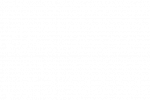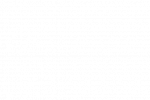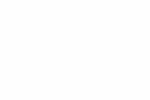Pierre Conesa : « Il me semblait que rien ne justifiait qu’on tienne le régime Habyarimana à bout de bras »

Pierre Conesa : « Il me semblait que rien ne justifiait qu’on tienne le régime Habyarimana à bout de bras »
Propos recueillis par David Servenay
Un ancien fonctionnaire du ministère de la défense revient sur ses tentatives d’alerter la présidence Mitterrand des dangers de la politique suivie au Rwanda dans les années 1990. En vain.
Enarque et agrégé d’histoire, ancien fonctionnaire à la délégation aux affaires stratégiques (DAS) du ministère de la défense, Pierre Conesa avait mis en garde, dans une note de 1993, révélée aujourd’hui par Le Monde, contre les risques de l’engagement français aux côtés du gouvernement rwandais de l’époque qui allait commettre le génocide un an plus tard. Il ne sera pas écouté.
Au sein du ministère de la défense, à quelle époque avez-vous été en contact avec le dossier rwandais ?
Le point de départ, c’est la création de la délégation aux affaires stratégiques qui se constitue après la guerre du Golfe [1991]. Pierre Joxe, ministre de la défense, pense qu’il lui manque deux choses. D’une part un service de renseignement militaire constitué, d’où la création de la direction du renseignement militaire [DRM], mais il veut aussi avoir son think tank, car il ne se satisfait pas du fait que le chef d’état-major des armées dise alors « la stratégie, c’est moi ». Il met donc Jean-Claude Mallet, conseiller d’Etat, à la tête de la DAS et je suis un de ses adjoints. Là-bas, je m’occupe de la zone des crises. Voilà pour l’organisation générale.
Pour le bureau Afrique, je pensais qu’il fallait travailler sur les crises à venir, non sur les crises en cours. On essaie alors de se déconnecter de l’actualité, pour aller sur le futur, en recrutant des vrais connaisseurs du sujet africain, comme le géographe Gérard Prunier. Dès 1993, on travaille sur la Somalie et le Rwanda, en ayant une réflexion sur la prospective des crises en Afrique, en y associant des officiers des troupes de marine et des géographes.
Comment se passe cette réforme de l’appareil de renseignement ?
La DRM a une spécificité qui est le « renseignement d’intérêt militaire », ce qui n’est pas toujours évident à définir mais a une vraie spécificité. Le général Heinrich [qui prend la tête de cette nouvelle structure] empiète donc sur les plates-bandes de la DGSE [direction générale de la sécurité extérieure] et, il se fâche avec ses anciens amis [il a dirigé le service action de la DGSE], car la DGSE se dit pourquoi la DRM ferait mieux que nous ? La deuxième fâcherie d’Heinrich est avec la DAS, qui lui enlève une partie de son pain, car nous avions des budgets de recherche, avec un angle de vue différent. C’est une histoire de pré carré. Pareil avec le Quai d’Orsay, qui se juge concurrencé. Ce sont des querelles de chapelle, mais dans une époque de transition profonde.
Quelle est la première alerte sur le Rwanda ?
C’est le rapport de la Fédération internationale des droits de l’homme au printemps 1993, où les ONG détaillent la planification des massacres de 1992 sur les Tutsi par les autorités rwandaises. Cette dynamique des tueries à répétition me pose un problème : s’agit-il d’un processus récurrent ou d’une explosion temporaire ? Ce qui me frappe, c’est le côté cyclique des massacres, comme régulateur démographique. J’écris donc une note [du 10 avril 1993], en démontant l’argumentaire de notre intervention : l’intérêt stratégique du Rwanda ? Le syndrome de Fachoda, parce que Kagame, parle anglais ? Il me semblait que rien ne justifiait qu’on tienne le régime Habyarimana à bout de bras… C’est une critique frontale de la cellule Afrique de l’Elysée et du dispositif militaire français. Cette note avait pour but de dire : prenons nos distances, car l’Elysée se fourvoie.
Comment est-elle reçue ?
Le cabinet civil du ministre de la défense la reçoit très bien, le cabinet militaire très mal, car elle vient en confrontation avec beaucoup de gens en charge de la politique africaine.
Pendant la crise, que saviez-vous ?
Je me souviens d’une réunion avec le directeur de cabinet de François Léotard, le ministre de la défense, au moment de monter l’opération « Turquoise ». La discussion avec le général Germanos, chef du cabinet militaire, tourne autour de la question : « Comment déployer cette opération ? » Or, le seul individu à avoir une connaissance du pays, de sa dynamique et du terrain, et une approche critique, c’est Gérard Prunier, car, autour de la table, il est le seul à connaître le Rwanda. La première source d’infos dans cette cellule de crise, c’est l’AFP. Autrement dit, la dimension médiatique en fait un sujet politique. Le fossé va se creuser entre la presse et les autorités, car la première soupçonne une opération d’assistance au régime en place, celui des génocidaires.
Après la crise, le 24 février 1995, vous rédigez une seconde note intitulée « Evaluation politico-militaire de la crise du Rwanda ». Quelle est votre intention ?
J’étais amer de constater que les gens qui avaient critiqué ma première note, et portaient une responsabilité directe dans la politique menée avant le génocide, s’en sortaient indemnes. Evidemment, ils étaient soutenus par François Mitterrand. Ma question est donc : les autorités politiques avaient-elles les moyens de savoir ? Avec mon équipe, nous avons repris toutes les notes des services [DGSE, DRM] et les télégrammes diplomatiques, en se demandant quel était le niveau d’information ? Pour éviter le cliché du « ce sont les militaires qui font la politique » et pas les politiques.
Quelle est votre conclusion ?
Ma conclusion est que le processus hiérarchique, à l’Elysée, filtrait la réalité. Le canal d’informations faisait que les notes n’étaient jamais mises directement sur le bureau du président. Mon sentiment est que c’était une crise « annonçable », même si personne n’avait idée de l’ampleur des massacres à venir. De ce point de vue, la DGSE a fait ce qu’il fallait pour attirer l’attention, la DRM un peu moins et les affaires étrangères pas du tout.
Que devient cette seconde note ?
Le directeur s’est opposé à sa diffusion… Alors, je mets mon mouchoir dessus, avec le sentiment amer d’un système qui se drape dans sa dignité.
Quels sont les enjeux aujourd’hui de l’affaire rwandaise ? Quel rôle jouent les politiques ?
Nous sommes dans un système majoritaire et donc le Parlement ne peut pas critiquer trop fortement le gouvernement. Par exemple, on a créé une Mission d’information parlementaire, pas une commission d’enquête avec de vrais pouvoirs d’investigation. Son président, Paul Quilès, a dédouané François Mitterrand, qui ne pouvait pas être responsable. Cette incapacité de la société française à exorciser un passé trouble est terrible. On ne fera pas le bilan politique de Mitterrand de manière objective et froide. Il y a eu une omerta partielle sur le sujet, notamment à cause de ceux qui sont les conservateurs de la mémoire. Nous sommes toujours dans une construction de mémoire historique qui ne sera vraiment étudié que dans cinquante ans, quand les archives seront rendues publiques.
Etes-vous favorable à l’ouverture des archives, réclamée par de nombreux universitaires ?
Oui, je pense que c’est important, en particulier pour que les rapports entre les différents services administratifs ne soient pas pervertis par les supposées responsabilités des uns et des autres. Il y a deux enjeux de société en réalité : la mémoire collective et la judiciarisation des actions de guerre. Cette judiciarisation préoccupe les militaires et je les comprends, mais ce n’est pas une raison pour éviter l’exercice de la mémoire collective. On peut changer le droit des archives et le droit du secret-défense, à condition d’offrir aux gens concernés un processus d’impunité pour ceux qui sont menacés, quand ils ont obéi à des ordres. C’est ce qu’il faudrait faire, pour sortir de l’impasse. La justice ne pardonnera pas, mais il ne faut pas que les exécutants portent la responsabilité des décideurs. La judiciarisation est une dérive.